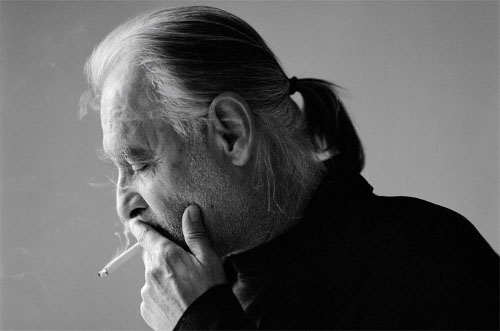
Il l’a dit lui-même : il met un point final à sa carrière avec Le Cheval de Turin, film âprement, terriblement beau, récompensé d’un Ours d’Argent (Grand Prix) à la Berlinale 2011 et qui sort sur une quinzaine d’écrans français cette semaine, en même temps que plusieurs publications sur le cinéaste hongrois et tandis qu’une intégrale lui rendra hommage au Centre Pompidou à Paris. La célébration est tardive, mais éminemment nécessaire. Le premier film de Béla Tarr distribué chez nous fut Les Harmonies Werckmeister en 2003, alors qu’il avait été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en… 2000. Si la distribution de ses films chez nous est chaotique, déjà au milieu des années 1990, on découvre quelques-unes de ses œuvres dans des festivals internationaux et son statut d’auteur culte se construit progressivement, à mesure qu’une poignée de festivaliers privilégiés répètent autour d’eux à quel point ce cinéma-là, hautement radical, est important. Certains parmi eux (dont un certain Gus Van Sant, dont les Gerry et Elephant sont clairement sous influence) donneraient tout le cinéma moderne pour un plan du Tango de Satan ou des Harmonies Werckmeister. Il faut dire qu’un plan, chez Béla Tarr, ça peut durer plus de quinze minutes… Ce cinéma s’offre parfois au spectateur comme une épreuve physique où l’étirement du temps permet de faire tendre notre ressenti émotionnel vers celui même des personnages de loosers cosmiques et plonge dans une torpeur quasi-hallucinée d’où les moments de grâce que Tarr nous offre surgissent avec d’autant plus de puissance. C’est vrai du moins à partir de 1988, où Damnation marque un grand tournant stylistique. En dix ans, le Hongrois est passé du psychodrame social, citadin, filmé à l’épaule (Le Nid familial, Rapports préfabriqués), à un existentialisme atmosphérique, à une durée parfois monumentale, à un « formalisme démoniaque ». Il est clair que cette œuvre dans son ensemble n’est pas d’un accès facile. Pour chaque film de Tarr, et donc particulièrement les cinq derniers longs-métrages, l’expérience de visionnage est unique, très intense, mais elle demande aussi une vraie disponibilité. Quoi qu’il en soit, voilà quelque chose de si différent du cinéma dominant, si beau et terrifiant à la fois, qu’il nous faut absolument en parler lorsque l’occasion nous en est donnée.
Films de la rétrospective :
(la distribution française des films de Béla Tarr étant désordonnée, on retiendra les années de sortie hongroise)
LE NID FAMILIAL
Családi tüzfészek – Hongrie – 1979 – 1h48
RAPPORTS PREFABRIQUES
Panelkapcsolat – Hongrie –1982 – 1h16
ALMANACH D’AUTOMNE
Öszi almanach – Hongrie – 1985 – 1h59 – Compétition Officielle, Locarno 1984
DAMNATION
Kárhozat – Hongrie – 1988 – 1h54
LE TANGO DE SATAN
Sátántangó – Hongrie/Allemagne/Suisse – 1994 – 7h30 – Forum, Berlinale 1994
VOYAGE SUR LA PLAINE HONGROISE
Utazás az alföldön – Hongrie – 1995 – 35min
LES HARMONIES WERCKMEISTER
Werckmeister harmóniák – Hongrie/Allemagne/France – 2001 – 2h25 – Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2000
L’HOMME DE LONDRES
A londoni Férfi – Hongrie/Allemagne/France/Royaume-Uni – 2008 – 2h12 – Compétition Officielle, Cannes 2007
LE CHEVAL DE TURIN
A Torinói Ló – Hongrie/Allemagne/France/Suisse – 2011 – 2h26 – Ours d’Argent (Grand Prix du jury), Berlinale 2011

Le Nid familial, le premier long de Béla Tarr
Un jeune cinéaste engagé et lucide
Béla Tarr, fils d’ouvriers, ouvrier lui-même avant d’enchaîner de nombreux petits métiers, est dans la première partie de son œuvre un cinéaste social et engagé qui entend faire une radioscopie des dérives de la politique communiste hongroise de la fin des années 1970. Très jeune, alors qu’il n’a que seize ans, il réalise un film sur une famille d’ouvriers délogée par la police alors qu’elle survit dans un squat. Il est embarqué par la police et à cause de cette arrestation, il se voit refuser l’entrée à l’université. Forcé de renoncer aux études de philosophie qui l’attiraient, il se consacre à la réalisation de reportages et de films amateurs, et finit par être remarqué par les studios Béla Balázs qui produisent son premier long-métrage Le Nid familial. Les studios Béla Balázs sont une sorte de communauté produisant des films à petit budget. Leur principe fondamental, c’était d’unir « l’avant-garde » et « l’underground », de donner l’opportunité à de jeunes cinéastes de réaliser des films expérimentaux sans le poids de la censure étatique. On s’étonne qu’un film comme Le Nid familial soit, justement, passé entre les mailles de la censure, tant il peint un malaise social, une situation qui paraît aberrante au jeune Tarr : un jeune couple marié qui ne peut s’épanouir et vivre libre. L’histoire tourne autour de la crise du logement qui frappe Budapest à l’époque. Un couple vit dans l’appartement exigu des parents du jeune homme. Tandis que le mari fait son service militaire, la jeune femme essuie chaque jour les remontrances d’un beau-père excédé par cette cohabitation, et rêve de posséder son propre chez-soi. Mais au retour du mari de l’armée, leur couple s’effrite petit à petit tandis que l’espoir de trouver un logement s’amenuise de jour en jour. Un carton ouvre le métrage : « C’est une histoire vraie, elle n’est pas arrivée aux personnages de notre film, mais elle aurait pu leur arriver à eux aussi. » D’emblée, Tarr revendique un aspect documentaire qui caractérise l’un des courants de « l’école de Budapest », un cinéma sociologique réalisé à partir d’études sur le terrain et souvent joué par des non professionnels. Le film décrit la pauvreté, et décortique les rouages absurdes d’une bureaucratie bornée et déficiente : soit ce qui suffit à écraser le quotidien des Hongrois de l’époque.
A la recherche de toujours plus d’indépendance, le cinéaste crée dès 1980 le studio Tàrsulàs avec quelques autres jeunes cinéastes. Il faudra moins de cinq ans pour que Tàrsulàs se voie fermer par les autorités hongroises. De même que son très jeune âge lorsqu’il tourne son premier long-métrage (22 ans), cette création d’un studio alors même qu’il suit encore ses études à l’Ecole supérieure de cinéma et de théâtre de Budapest montre sa précocité. Tarr ressort diplômé en 1981, et dès l’année suivante il sort son premier long-métrage interprété par des acteurs professionnels, Rapports préfabriqués.
Le réalisme socialiste et John Cassavetes
Les contraintes importantes qui caractérisent les tournages des premiers films de Béla Tarr suffisent à donner au style de celui-ci certains contours : Le Nid familial est tourné en quatre jours seulement et Almanach d’Automne (1985) à huis clos dans un vieil et vaste appartement de Budapest. Les gros plans sont nombreux, scrutant les expressions des personnages, et longs, laissant s’installer une tension palpable. A ce niveau, les séquences de repas du Nid familial et de Rapports préfabriqués sont de parfaits exemples : dans le premier, on y voit le « panier de crabes » familial devenir un nid de vipères, à coup de répliques cinglantes, de regards méprisants. Dans le second, le père de famille joué par l’excellent Róbert Koltai regarde sa femme et son fils avec une espèce de fureur, de dégoût, et paraît d’autant plus prêt à exploser qu’il est déjà, si tôt dans la soirée, ivre. L’assouplissement des restrictions du réalisme soviétique dans les démocraties populaires au cours des années 1970 permet au cinéaste d’évoquer les problèmes de la vie quotidienne, et plus encore. Car symboliquement, dès ses premiers opus, c’est un malaise plus général, plus profond qu’il tente de saisir. Tarr tâtonne encore, cherche son style. Mais son maniement de la caméra, extrêmement disponible et mobile, évoque Cassavetes, dans ce sentiment qu’il donne d’être constamment à la recherche de quelque chose. Chez le cinéaste new-yorkais, c’était la circulation d’un peu d’amitié et d’amour dans les rapports entre les protagonistes. Chez Tarr, il semble que ce soit une issue, une échappatoire à cette grisaille terrible du quotidien. La caméra donne l’impression de buter contre les meubles, les murs de des petites pièces dans lesquelles s’entasse la famille du Nid familial. Le réalisme n’est donc pas très socialiste, la vie entassés les uns sur les autres exacerbant les tensions, les rancœurs et les tromperies. Et ces appartements étouffants ne sont finalement rien d’autre que des métaphores d’un pays et d’un système dont les personnages sont prisonniers.

Scène de dispute dans Rapports préfabriqués
Un mal-être au-delà du communisme
Dans Le Nid familial, Béla Tarr est encore très ancré dans la réalité du mode de vie citadin communiste de Budapest. Le métrage s’ouvre sur des instantanés du quotidien, de la rue, du travail à la sortie duquel chacun est soigneusement fouillé. Le tout peut encore être interprété comme une pure critique du régime qui opprime les êtres et les prive du bonheur qu’il prétend, officiellement, leur apporter. Mais peu à peu, les raisons du mal-être patent des personnages des films de Tarr sont de moins en moins évidentes, de plus en plus diffuses, difficiles à cerner parce que trop profondément enfouies en eux. Dès Damnation (1988), le cinéaste ne va plus filmer que des individus fermés au monde, enfermés en eux-mêmes, à peine capables de communiquer et d’échanger avec l’autre. C’est parce que les œuvres plus récentes de Tarr affinent notre regard sur ses premiers opus que l’on y distingue désormais les prémisses de son grand style unique et radical. On peut trouver dans l’amertume du Nid familial un peu de ce désespoir à venir : la moindre parenthèse heureuse dans le quotidien du couple principal connaît un revers. Lorsque les jeunes gens s’amusent enfin dans une fête foraine, les trop nombreuses bières bues et les tours de manège ont leur prix : le mari vomit, tandis que la musique enjouée et illusoire du régime s’estompe lentement, laissant place à une nouvelle séquence d’engueulade familiale. De même que leurs rires, l’espoir formulé par les deux personnages dans les soliloques qui closent le métrage est démenti par leurs larmes de désillusion :


Rapports préfabriqués montre, entre les lignes, un mal-être plus détaché encore des conditions de vie des personnages. On en revient à cette scène de repas où le père paraît prêt d’imploser et à l’envie du personnage de fuir un quotidien qui ne lui suffit pas, sans qu’il arrive à donner de raisons valables à son épouse lorsque, dans une séquence qui ouvre le film et à laquelle on revient plus tard, il fait ses valises sous ses yeux, sans dire un mot. On a tendance, bien sûr, à être en empathie davantage avec la femme puisque – trait saillant d’une inégalité des sexes persistante dans un régime soi-disant égalitaire – son mal-être à elle est davantage réfréné et pourtant plus simplement lié aux sentiments qu’elle éprouve pour son mari. Il y a ce bouleversant dialogue où elle lui avoue sa douleur de le voir partir à l’usine le matin, d’affronter seule la journée, le gamin, les tâches ménagères, l’hypocrisie des voisins qui la surveillent, la bienséance de mise avec tout le monde et qui cache mal le mépris ambiant. Une longue séquence de bal populaire nous évoquera presque les premiers films de Milos Forman (L’As de Pique, 1963, Les Amours d’une Blonde, 1965 et Au Feu les Pompiers !, 1967) mais en plus cruel : plus que jamais s’y jouent le paraître et la séduction, plus que jamais s’y décèlent la frustration, la jalousie et une sorte de spleen d’un autre ordre. Il faut se le dire de toute manière : le cinéma de Béla Tarr est assez peu « appréciable » dans le sens où il ira toujours plus vers la noirceur humaine et le désert des sentiments. Tout critiquable qu’il soit, c’est donc bien ici le mari qui se rapproche le plus du profil-type d’un personnage de Tarr.
Almanach d’Automne aura dès lors, sur ce plan-là et sur d’autres, des airs de transition. L’unité de lieu est cette fois-ci totale et permet donc non seulement une métaphore de la situation hongroise, mais également – et nettement plus que dans les deux films évoqués précédemment – une étude des rapports humains qui donne à l’appartement en question des airs de laboratoire. Les personnages sont observés sous tous les angles, et Tarr pousse la démarche jusqu’à les filmer en plongée et… en contre-plongée à travers un plancher en verre ! Plus que jamais, l’unité de lieu et de temps est au service d’une théâtralité revendiquée. Sauf que celle-ci se voit ici excessivement renforcée par un expressionnisme des couleurs auquel on préfère nettement le noir et blanc que le cinéaste privilégiera par la suite. Tandis que ce noir et blanc récurrent tirera dans les opus suivants tout son sens – précisément – de ses nuances de gris qui disent la morosité de l’existence des personnages, le traitement des couleurs est ici trop programmatique : chacun des cinq protagonistes habitant l’appartement se voit associer une tonalité et la lumière rouge qui vient par moments d’on ne sait où nous évoque les films de Dario Argento. Puis, dans un dernier temps, lorsque le jeu de massacre est terminé et que le temps est comme suspendu, figé dans l’horreur, l’image atteint un stade extrême de délavage.


Dans ce film expérimental, on voit Tarr peaufiner le style de ses œuvres à venir dans de lents travellings flottants ou des gros plans qui nous laissent désarmés face à ce que nous expriment ces « tronches » qu’il aime caster (on retrouvera Hédi Temessy, qui joue la mère, et Miklós Székely, qui joue le mari de l’infirmière, dans Damnation)… On voit d’autant plus clairement un cheminement entre Le Nid familial, Rapports préfabriqués et Almanach d’Automne que les trois opus ont en commun le motif de l’appartement. L’appartement, d’abord, comme lieu de cloisonnement. Les personnages des deux premiers opus avaient malgré tout une certaine liberté. Ils pouvaient quitter le foyer et sortir, ou tout au moins aller travailler dans un bâtiment différent. Dans le troisième, ils sont enfermés tout au long du métrage, condamnés à la déchéance par l’entremêlement mortifère de leurs perversions. Dans Le Nid familial, un jeune couple rêve d’un appartement à lui. Dans Rapports préfabriqués, il l’a, mais s’y déchire, le mari ne tenant plus en place dans un quotidien répétitif et morose, sans saveur. Le couple rêve de quelque chose de plus grand, d’une maison loin des bruits de la ville… Dans Almanach d’Automne, le personnage de l’infirmière et son mari (un prolongement des deux précédents couples) ont eu ce qu’ils voulaient depuis longtemps : une très grande maison bourgeoise, certes « dirigée » par le personnage joué par Hédi Temessy mais dans laquelle ils peuvent évoluer sans entrave. Néanmoins, en plus de la marâtre, ils ont affaire à d’horribles situations. Le fils de la propriétaire est une sangsue qui menace de tuer sa mère dès les dix premières minutes, tandis que le locataire est une pauvre loque, un homme coupé de tout contact depuis si longtemps qu’il en est réduit à se battre avec le fils pour sentir quelque chose. Chacun de ces personnages a quelque chose de faux et trompe quelqu’un, à l’exception de ce vieux bougre bon à rien, peut-être bien rendu alcoolique par un supplément de lucidité : il sait que le monde va à sa perte d’une manière ou d’une autre – comme il l’explique au mari de l’infirmière – mais il aimerait continuer de vivre malgré tout et que chacun fasse de même. Il est le seul à formuler une idée de la vie détachée des histoires triviales sur lesquelles se déchirent les autres protagonistes. Mais, philosophe maudit et incompris, il semble se saouler pour fermer les yeux sur le vice qui gangrène ses semblables. Rétrospectivement, on pourrait même considérer que ce personnage, qui sera exclu de l’espace fermé du film en fin de course, pose un regard sur l’ensemble des figures qui peupleront les films suivants de Béla Tarr. Un regard amer et désenchanté qui n’est pas loin de celui du cinéaste lui-même.
Purgatoire hongrois
Dans Voyage sur la Plaine hongroise, moyen-métrage en forme de balade poétique réalisé pendant le tournage du Tango de Satan avec l’interprète et compositeur du film Mihály Víg, Béla Tarr donne à voir « la face B » de ses œuvres, pour ainsi dire. En filmant en couleur et au format vidéo ce qui servira de décor à quatre œuvres ultra-maîtrisées, tournées en 35mm noir & blanc, le cinéaste rend hommage à son pays et à ses paysages fascinants auxquels il ne fera qu’une seule infidélité à partir de 1988, avec L’Homme de Londres (2007), censé se dérouler en Normandie mais tourné dans le vieux port de Bastia. On se rend compte à quel point il suffit de la filmer en silence et en un plan long de plusieurs minutes pour que la Puszta, cette steppe hongroise presque inhabitée, dégage à elle seule quelque chose d’à priori insaisissable que les œuvres de Tarr tendront pourtant à fixer : l’intensité d’une désolation. Voir ces images est presque essentiel pour considérer ce décor naturel comme personnage à part entière des films que le cinéaste y situe. Ce qui se dégage de la plaine est déjà tel qu’il suffit presque à Tarr d’y déposer un peu de perversion humaine pour que la terre extrêmement sèche ou – en l’espace de quelques jours au début de l’automne – boueuse ressemble à celle d’une parcelle d’Enfer sur Terre. C’est clairement ce que les films de Tarr parviennent à faire, en quelques plans et aidés de seulement quelques partis-pris formels : détacher le plus naturel des décors du réel pour en faire une sorte d’espace théorisé, un monde originaire où les personnages en présence seraient comme les seuls hommes du Terre et dont les relations suffiraient à exprimer ce que le cinéaste-démiurge pense de l’humanité.


L’écrivain alcoolique face à la plaine où résonne un son de cloche d’origine surnaturelle. Dans Le Tango de Satan, la Puszta est plus que jamais une terre mystique.
On pense, dès lors, à la définition que Gilles Deleuze donne du naturalisme au cinéma, dans le chapitre « L’image-pulsion » de son célèbre volume « L’Image-Mouvement » (1983, Editions de Minuit). Un pan du cinéma construit sur un couple étrange : Monde originaire-Pulsions élémentaires. La Puszta correspond bien à ce qui peut marquer ce monde originaire de Deleuze : une zone préservée au caractère informe. « Les personnages y sont comme des bêtes (…). Non pas qu’ils en aient la forme ou le comportement, mais leurs actes sont préalables à toute différenciation de l’homme et de l’animal. Ce sont des bêtes humaines. » (p. 174, op. cit.). Le monde originaire, idée abstraite pour parler d’un endroit où la civilisation est encore peu développée, d’un temps reculé, non précisément situé historiquement ou géographiquement, où les hommes ne s’étaient pas encore construit de normes sociales et comportementales et étaient en proie à leurs seules passions, semble se confondre souvent chez Tarr avec le milieu réel, actuel. Et les hommes être livrés à leur plus bas instinct animal. C’est bien ce que dit la voix-off de l’écrivain dans Le Tango de Satan : « Le soleil se lève pour donner vie à l’ombre, et pour séparer la terre du ciel, l’homme de l’animal, pour briser ce lien embarrassant dans lequel ils se sont enchevêtrés. » De fait, dans plusieurs des films du cinéaste, hommes et animaux reçoivent une attention égale de la caméra : ce sont ces chiens errants, ivres, chétifs, marchant dans les flaques, qui peuplent le hameau de Damnation et avec lesquels finit le personnage principal, ces vaches qui s’échappent de l’étable et traversent la coopérative au petit matin dans le plan-séquence qui ouvre Le Tango de Satan, ces chevaux qui s’échappent d’un abattoir et galopent sur une grande place déserte dans un moment hallucinant du même film, la baleine qui est fait s’agiter les hommes du village des Harmonies Werckmeister et le Cheval de Turin qui donne carrément son titre au film dont il est presque le personnage principal, conscient le premier que la fin du monde approche, filmé en gros plan malgré le mystère, impénétrable par l’homme, de son altérité. Les personnages des cinq derniers longs-métrages de Tarr évoluent ainsi lourdement dans un entre-deux inquiétant, où leur nature même serait aussi incertaine que leur destin, intimement lié à l’idée de Dieu.
Cette évocation récurrente de Dieu dans les films du cinéaste suffit à rendre ceux-ci rétifs à une classification trop rigide suivant les catégories de la théorie deleuzienne. L’idée de Dieu (et de son opposé, le Diable) est présente chez le cinéaste hongrois à partir de Damnation, mais non pas comme absolue, elle est plutôt discutée dans des dialogues théoriques qui tranchent avec les comportements parfois très primaires des personnages. Ceux-ci sont souvent croyants par purs héritage générationnel et tradition géographique. Ils formulent donc de manière récurrente des jugements les uns sur les autres et s’inquiètent du sort que leur réserverait le Tout-Puissant dans l’au-delà. Cette croyance fluctuante et incertaine implique aussi une omniprésence de la notion de sens de l’existence et de l’idée de fin de la vie et de « fin tout court », de fin du monde. Les personnages ont une tendance particulière à chercher à mettre en paroles toutes ces choses qui les hantent et à tenter de définir leur propre statut ontologique, voire de proclamer leur propre sentence ultime. Ainsi le protagoniste de Damnation affirme-t-il : « Toutes les histoires sont des histoires de désintégration. Les héros se désintègrent toujours. Quand ça n’est pas le cas, il s’agit de renaissance. Mais moi, je parle de désintégration irrévocable. ». La noirceur des films de Tarr est encore renforcée par le fait que la trajectoire même des personnages soit commentée au sein du film (par les personnages eux-mêmes ou par une voix-off) de manière implacable. Les humains, chez le cinéaste, ont une conscience tragique de leur place dans l’univers. On atteint des sommets à ce niveau dans la magnifique séquence d’ouverture des Harmonies Werckmeister : Valushka, le poète pseudo-tsigane qui sera bientôt témoin de la chute des hommes du village où il vit, demande dans le bar du coin à quelques joyeux ivrognes de représenter chacun un élément du système solaire, afin qu’ils visualisent la rotation de la Terre autour du Soleil et celle de la Lune autour de la Terre. Dans de pareils moments, d’une poésie rare, l’infini qui dépasse les hommes s’invite dans leur environnement le moins glorieux. Le cinéaste explique : « Valushka a quelque chose à voir avec l’infini, avec l’éternité, parce qu’il vit dans le cosmos, dans les étoiles. Un autre personnage, M. Ezster [un personnage de musicologue qui travaille sur les expérimentations de Werckmeister], n’arrive pas à se résigner au fait qu’il n’y a pas de son pur. A travers les sons purs, lui-même rejoint aussi la notion d’éternité. Il y a une baleine, qui vient de l’océan infini, donc elle fait partie aussi de l’éternité, d’une certaine manière. A côté, il y a des gens affamés qui attendent quelque chose. C’est très simple. »
Très peu de personnages de l’univers de Tarr seront épargnés. Seul L’Homme de Londres tend davantage vers la lumière que vers l’ombre. Le fait que l’action se déroule dans une ville portuaire normande change plus la donne que ne le laisse croise la persistance des traits formels principaux du cinéma de Tarr. Avec les lumières de la ville, celle du poste de surveillance du personnage principal (il surprend des magouilles lors d’un déchargement de marchandises) ou celle des lampadaires, l’espace est découpé en quelques zones importantes, seules éclairées dans la pénombre alentour, depuis lesquelles les personnages s’observent (unilatéralement ou bilatéralement), et les relations entre eux s’en trouvent plus lisibles mais aussi, malheureusement, plus pauvres. Sur le plan de la signification symbolique, c’est clairement le film le plus optimiste du cinéaste. Le seul décor côtier fait que le film est marqué par de nombreuses ouvertures, par l’omniprésence (visuelle ou sonore) de la mer, et donc par la possibilité d’un ailleurs. Le travail sur la lumière aveuglante, presque divine, est également important. Le fondu au blanc final figure vraisemblablement une absolution accordée aux personnages du drame policier qui s’est noué deux heures durant. Mais jamais personne ne s’en sort indemne, car si le héros est pardonné pour avoir été tenté par le magot et avoir abattu Brown par légitime défense, la femme de Brown, le criminel abattu, bénéficie elle aussi de la compassion du cinéaste-démiurge mais demeure esseulée, dans un dernier plan déchirant, le plus beau de cet opus-là.


Ce sont particulièrement Le Tango de Satan et Le Cheval de Turin qui sont directement marqués par cette présence divine et/ou diabolique diffuse propre à la deuxième partie de carrière du cinéaste. Il y a déjà ce titre intriguant et effrayant du premier… Les habitants de la coopérative y voient leur petit théâtre quotidien de la tromperie et du complot bouleversé par l’arrivée de deux personnages qu’ils croyaient morts et que certains voient comme des messies, d’autres comme des envoyés du Démon. Pour nous-mêmes spectateurs, cette annonce de leur arrivée a d’autant plus d’effet qu’elle est concomitante d’un son de cloche d’origine surnaturelle. A la fin, le personnage de l’écrivain aura la confirmation de cette étrangeté : « Au plus près, à huit kilomètres vers le sud-ouest, sur le vieux champ des Hochmeiss se trouvait une chapelle solitaire. Mais non seulement, elle n’avait pas de cloche, mais sa tour avait été détruite pendant la guerre. » Il décidera alors de se barricader chez lui pour attendre la mort, puisque l’Apocalypse paraît imminente. Pour autant, il ne vient jamais à l’idée des personnages d’interpréter ces sons clairs comme ceux d’une rédemption possible, d’un message divin salvateur. Leur conscience est trop malmenée par tous leurs vices pour qu’ils puissent croire à une absolution. C’est ainsi par la fluctuation de leur morale que les personnages s’auto-condamnent en quelque sorte à un entre-deux, au Purgatoire. La même bonne femme qui fait la leçon aux ivrognes dans Le Tango de Satan détrousse quelques séquences plus tard l’un de ses camarades. Dans le même film, on voit les deux hommes qui organisent le délitement de la coopérative prier après avoir achevé de mettre au point leur plan diabolique. Dans L’Homme de Londres, on assassine et on vole, dans Les Harmonies Werckmeister, on va jusqu’au nettoyage ethnique, dans l’esprit sinon dans la lettre.
La dernière tirade de la filmographie de Béla Tarr, dans Le Cheval de Turin, prend alors une résonnance particulièrement ample, comme ce qu’il faudrait retenir des réflexions de toute une œuvre : « Le vent a emporté la ville, il l’a réduite en ruines. Tout est en ruines, tout a été dégradé. Ca n’est pas un cataclysme qui arriverait avec une soi-disant aide humaine innocente. Au contraire, il s’agit du jugement de l’homme, de son jugement sur sa propre nature, sur laquelle Dieu a bien sûr une influence ou à laquelle il participe, si j’ose dire. (…) Ils ont tout pris dans un combat sournois. Quoiqu’ils touchent, ils le déracinent. Ca a toujours été comme ça jusqu’à la victoire finale. » « Ils », il faut bien comprendre que ce sont les hommes dévorés par l’appât du gain dont les personnages de ce film peuvent effectivement se distancier, eux qui ont l’air de vivre dans la marge la plus reculée de la civilisation. Ils subiront néanmoins la fin (littérale) d’un monde précipité dans sa chute par l’arrogance des hommes qui, découragés par le jugement que la religion les obligeait à avoir sur eux-mêmes (on en revient à la non croyance en un salut possible), ont préféré s’adonner à leurs pulsions primaires. Le destin se rappelle donc sans cesse aux personnages, souvent par le motif de la pendule, dont le bruit régulier souligne la répétition mécanique du quotidien des protagonistes autant que le temps qui passe et les rapproche de la fin.
Enfoncés dans la boue par un ciel de plomb
Mais si la décadence triomphe presque toujours dans ses films, il faut garder en tête ce qu’en dit le cinéaste : « Le thème central de mon cinéma est la dignité humaine. Comment se battre pour la préserver, comment on vous force à la perdre. C’est un thème intemporel et universel car je crois que, partout dans le monde, chacun doit se battre pour cela. On dit souvent que mes personnages sont des marginaux, qu’ils existent en dehors du système. Je renverse toujours la question. Pourquoi pensez-vous qu’ils sont marginaux ? Je crois au contraire qu’ils représentent la majorité. C’est la bourgeoisie, les tenants de l’argent, qui sont minoritaires et marginaux. La solitude de mes personnages n’est pas à confondre avec de la marginalité. Ce n’est que l’expression de la réalité de l’être humain. Vous naissez seul, vous vivez seul et vous mourez seul. » (source : ToutLeCine.com). Des propos qui collent particulièrement à la toute fin de son œuvre, les dernières minutes du Cheval de Turin – nous y reviendrons. Commençons par noter que, de fait, les figures de l’œuvre de Béla Tarr ont de sacrées circonstances atténuantes ! Le décorum est presque toujours reconduit de manière identique d’opus en opus : quelque part sur la plaine hongroise (ou ailleurs, peu importe), quelques bars miteux et enfumés où une couche épaisse de boue se forme peu à peu sur le sol, un hasardeux dancing où s’enivrer non seulement de palinka (l’eau de vie typiquement hongroise) mais aussi de musique, les étendues sans fin de la steppe, rendues bouillasseuses par des pluies diluviennes ou balayées par un vent si fort qu’il vous rendrait fou (c’est ce qu’on soupçonne dans Le Cheval de Turin), écrasées par un ciel de plomb. Le quotidien n’est fait que de gestes répétés. Dans Damnation et Le Tango de Satan, les allers et retours entre le comptoir du bar et la fenêtre depuis laquelle on guette sans cesse un évènement qui ne vient jamais sont si importants que l’on ne s’étonne même pas qu’un plan-séquence s’ouvre, dans les deux films, sur les chopes entassées sur l’égouttoir du bar ! Le Cheval de Turin (images ci-dessous) pousse plus loin que jamais cette aliénation du quotidien en étant construit uniquement sur des répétitions et de légères différences. Les jours se ressemblent presque exactement : lever, s’habiller, palinka pour le petit déjeuner, chercher l’eau au puits, tenter de sortir le cheval et la charrette, manger une patate bouillie qu’on épluche à la main en se brûlant, se déshabiller, dormir.


Béla Tarr suggère donc bien, par ses choix de décors et de motifs récurrents, que le seul horizon qu’ont ses personnages, c’est la désolation, et que cela justifierait presque leur perversion, les pulsions malsaines qui les rongent, même dès le plus jeune âge. L’exemple par excellence est tout trouvé, avec un personnage d’enfant, presque le seul de toute l’œuvre de Tarr. Estike, la gamine du Tango de Satan torturerait-elle son chat si elle avait autre chose de mieux pour s’occuper et surtout si ses aînés lui donnaient un autre exemple plutôt que s’adonner à la prostitution (pour ses deux grandes sœurs) ou à des desseins plus sombres (pour son frère, qui lui vole l’argent qu’elle était parvenue à économiser) ? Lorsque les personnages des films ne parlent pas de Dieu ou de fin du monde, ils commentent le désespoir de leur quotidien. La mère de la petite Estike, justement, commente par exemple de la manière la plus crue qui soit les activités de prostitution de ses deux filles aînées : « Quand les gens de la ferme seront partis, elles baiseront le sol ». Autant que lorsqu’un personnage déclame soudain un verset de la Bible, ces phrases terribles ont sur nous un effet dévastateur, d’une grande violence, en ce qu’elles semblent parvenir à avilir encore davantage le quotidien déjà peu reluisant des personnages. « Tu rentres dans cinq bars pourris chaque jour. Tu t’écroules dans ton lit le soir. Tu ne peux pas rester ici, à boire de la liqueur pas chère. Tout ce que ça te fait, c’est t’abrutir. Ça détruit ton cerveau, ça fait gonfler ton foie. » dit le barman au personnage principal de Damnation. Celui-ci expliquera plus tard dans le film qu’il a un jour dit à la femme qui l’aimait qu’elle le dégoûtait, juste pour voir ce que ça changeait de le dire. Chez Béla Tarr, les mots frappent, font mal, parce qu’ils assomment et enfoncent un peu plus encore les personnages dans le sol boueux sur lequel paraît se dérouler leur vie entière. Les hommes, comme le protagoniste de Damnation, ont besoin de tester leur impact sur le monde. Ils n’ont pas grand-chose à perdre après tout, et s’abandonnent ainsi à leurs pulsions de destruction, que l’on percevait déjà, plus ou moins réfrénées, chez le père de famille de Rapports préfabriqués.
Les sommets de lyrisme qu’atteignent les dialogues de Tarr, ce sont ces phrases qui, avec la même solennité que lorsqu’il s’agit de Dieu, formulent le désespoir quotidien, dans Damnation : « Le brouillard envahit tout, pénètre dans les poumons. Il envahit ton âme », ou encore dans Le Tango de Satan : « La pluie intérieure, vous la connaissez ? Elle vous lave les organes. Elle vient du cœur et inonde le foie, l’estomac, la rate et les reins. Je suis complètement trempé. » Dans ces mondes où les enfants se suicident, où les écrivains attendent la mort, où les hommes boivent, dansent, et s’oublient, et les araignées, patiemment, recouvrent tout de leurs toiles (dans Le Tango de Satan, deux chapitres évoquent ces araignées qui, en tissant leur toile partout, donnent aux hommes des signes de leur propre torpeur), une poignée de personnages, plus lucides que les autres, sont témoins du chaos. Valushka (1), dans Les Harmonies Werckmeister en est même à la fois le témoin et l’organisateur – puisque c’est lui qui, à la demande d’une femme influente dont il ne connaît pas les intentions (Hanna Schygulla, souveraine, comme toujours), répand dans le village l’idée d’une milice qui ramènerait l’ordre en procédant à une épuration ethnique. Dans le même film, le musicologue, Ezster (2), constate horrifié les ravages de la folie humaine. Dans Damnation, c’est l’employée des vestiaires du bar Titanik, jouée par Hédi Temessy, qui cite au protagoniste tout un passage de l’Ancien Testament et le met en garde contre la déliquescence du monde. Et – plus puissant que tout le reste, forcément – c’est la petite Estike (3) qui, dans Le Tango de Satan est témoin de la décadence des adultes et va jusqu’à décider de quitter ce monde qui ne lui promet rien.



Beaucoup de choses sont résumées dans ces quelques phrases du personnage de Damnation : « Je n’ai prise sur rien. Ce sont les choses qui s’accrochent à moi. On veut que je sois témoin du misérable effort que chacun fait pour parler avant qu’il ne s’affaisse dans sa tombe. Pas de temps pour les mourants. ». Béla Tarr tend manifestement à occuper une position similaire à celle de ce personnage. Qu’il nous y contraigne d’une manière ou d’une autre fait à la fois la gageure et la difficulté d’accès de son cinéma.
Un « formalisme démoniaque »


Le Tango de Satan : danser jusqu’à l’écroulement
Les personnages du Tango de Satan, mais plus généralement ceux des films de Béla Tarr, sont les proies terrifiées ou – pire – désespérément calmes d’un effondrement du monde, comme le dit le personnage de l’écrivain dans le film en question : « Ce qu’ils craignent le plus, c’est un ménage cosmique. ». Il est encore un acteur/témoin de ce processus, puisqu’il écrit et commente dans ses carnets tout ce qu’il observe à longueur de journée dans la coopérative mais qu’il finira lui-même par se barricader chez lui pour attendre la Fin. Ce double-statut, c’est à peu près celui que le cinéaste nous assigne de fait, à nous spectateurs. Son style, à partir de Damnation permet à la fois une implication dans l’action (ou dans la non-action) et une distance vis-à-vis d’un système narratif et intellectuel mis en place dans ce qu’il faut bien appeler des « films-monde », du moins dans le cas du monumental Tango de Satan, long de 7h30 ! On en vient aux notions de longueur et de lenteur qui sont bien entendu au cœur de ce cinéma. Elles rendent assez compréhensible le fait que Béla Tarr ait vu son premier film distribué en France seulement en 2003 (Les Harmonies Werckmeister, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes en… 2000). Jusqu’alors, son œuvre n’était connue que d’une poignée de festivaliers privilégiés qui l’avaient déjà rendue culte dans le milieu cinéphile. De fait, une œuvre telle que Le Tango de Satan, l’une des plus longues de l’histoire du cinéma, dont Tarr tenait à ce qu’elle soit vue d’un seul trait, pose des problèmes en matière même de réglementation des projections de film. Et, forcément, elle met le spectateur à l’épreuve jusque sur le plan physique. Il y a dès lors une correspondance entre cette épreuve proposée au spectateur et celle vécue par les personnages à l’écran. On pense ainsi à ces très longues marches à travers la steppe, filmées en un unique travelling, dans Le Tango de Satan ou Le Cheval de Turin (c’est vrai aussi pour le cheval, dans le plan d’ouverture, voir extrait ci-dessous), ou à cette séquence de danse insensée du premier opus, où de longues minutes durant, on regarde les paysans ivres morts s’agiter, se frotter les uns aux autres, se repousser violemment, tomber par terre… pour finalement les retrouver au petit matin affalés sur les tables du bistrot, tandis qu’entre-temps a eu lieu le suicide d’une enfant, sûrement précipité par le fait qu’elle ait justement surpris cette décadence terrible à travers la fenêtre.
La sensibilité du cinéaste, ce « formalisme démoniaque » dont parle Jonathan Rosenbaum, qui porte aussi bien sur les plans très serrés que sur des compositions abstraites, mais en tout cas sur de longues prises, ouvre sur l’écran une autre dimension, un monde graphique, onirique à sa manière, souvent profondément accablé, entre cauchemar et réalité, où « la déréliction des personnages, losers cosmiques noyés dans la boisson, atteint des abîmes d’une médusante beauté » (Vincent Ostria). Cette incarnation jusqu’à l’abstraction nous plonge dans une sorte de léthargie visionnaire et désespérée qui n’est pas très éloignée – et c’est le but recherché – de l’état des personnages et peut-être même de celui du cinéaste lui-même, qui contemple et met en scène à sa manière la lente décrépitude des archaïsmes hongrois.


Dans Le Tango de Satan comme dans Le Cheval de Turin, des personnages plongés dans la torpeur regardent le monde en espérant qu’un évènement décisif pour eux y surgisse enfin.
Tarr explique ainsi son goût pour le plan-séquence : « J’aime d’abord sa sophistication. Sans doute en réponse à ce que j’appelais précédemment les films bandes-dessinées, c’est-à-dire entièrement construits comme une succession de vignette et de plans qui ne durent pas plus de 30 secondes. Le plan-séquence évite aussi une ligne unique de narration. Il permet de mettre à l’écran en même temps la complexité, la totalité et la richesse du récit. Mais je ne pratique pas ce genre de mise en scène juste pour le plaisir esthétique, mais pour la tension qu’il procure. Y compris chez les comédiens qui ne peuvent pas sortir de la scène. Et puis il permet de montrer ce que l’on ne voit plus au cinéma, comme une personne qui écoute par exemple. » (source : ToutLeCine.com).


Cette longueur des plans-séquences (parfois plus d’un quart d’heure) permet d’intensifier la résistance du réel aux personnages. Le décor, parfois quasi-apocalyptique comme dans Damnation (images ci-dessus), précède l’entrée des corps dans cadre et persiste après leur sortie, offrant une vision non seulement désolée par essence (vélo abandonné, chiens errants, ordures prises dans une terre bouillasseuse, et toujours cette pluie), mais au sein de laquelle l’homme n’est même plus important. La longueur des séquences augmente aussi jusqu’au point de non-retour la potentialité de l’action, créant parfois une grande tension : le personnage du film que l’on vient de citer se rase en gros plan. Ne va-t-il pas finir comme le personnage de The Big Shave (1967), le célèbre court-métrage de Martin Scorsese ? Ces deux cas de figure principaux ont en commun de mettre en relief la pesanteur tellurique du corps humain. Plus l’action s’étire en longueur, plus – par empathie – l’effort qui l’accompagne est communiqué au spectateur. On peut percevoir ici un lointain écho du cinéma de John Cassavetes, qui aurait influencé Tarr dans ses jeunes années. A ce plan purement visuel, il faut ajouter l’importance du travail du son qui ne fait qu’aller plus encore dans ce sens. Il est frappant, alors que les premiers films du cinéaste reposaient en grande partie sur une prise de son réaliste, de découvrir les premières images de Damnation où l’on trouve déjà cette bande-son atone, une sorte de grondement qui émanerait de toute chose, et qui sera utilisé maintes fois par Tarr. Le plus intéressant, c’est de voir qu’un travail similaire est accompli au niveau des voix des acteurs. Celles-ci sont systématiquement postsynchronisées – parfois au prix d’un décalage flagrant avec les mouvements de la bouche, notamment dans L’Homme de Londres – et ont dès lors l’air de venir, elles aussi, d’outre-tombe. C’est ce parti-pris technique, aussi, qui explique que les dialogues aient un tel impact, le volume des voix étant parfois délibérément relevé par rapport aux bruits alentours. Certains bruits, précisément, sont mis en valeur sur la bande-son jusqu’à en devenir presque abstraits. Ainsi de la pluie omniprésente, des roues de charrettes qui s’enfoncent dans la boue, ou de cette même scène de rasage dans Damnation, où le bruit du rasoir sur la peau et celui qu’il fait lorsque le personnage le tape sur le lavabo pour en enlever les poils deviennent assourdissants, extrêmement dérangeants, décuplant ainsi la tension voulue d’une séquence à priori anodine sur le papier.
Tandis que tout ce travail formel peut dans certaines séquences donner l’impression de figer le temps dans la terreur (la séquence de l’enterrement dans Le Tango de Satan), le recours ponctuel à la musique peut le figer dans la grâce. Elle est là, aussi, la récompense de l’épreuve d’abandon physique que le spectateur accepte de vivre : dans ces moments suspendus où le cinéaste touche au sublime, à quelque chose qui vaut autant par ce qu’il est en soi que par la manière dont il a été amené. On pense en particulier aux Harmonies Werckmeister, qui est peut-être le film de Tarr le plus beau esthétiquement et en tout cas celui que l’on conseillerait pour se frotter pour la première fois avec ce cinéma, parce qu’il offre de plus nombreux moments esthétiquement frappants et touchants que les autres films du réalisateur. Le plan où Valushka fait le tour de la baleine (précédé par le suspense de la révélation de l’animal par le cirque ambulant) et celui où les insurgés du village venus s’en prendre aux malades d’un hôpital tombent nez à nez avec un vieil homme maigre et font alors subitement demi-tour sont deux exemples :


A l’opposé, L’Homme de Londres est étrangement dénué de tels passages. Peut-être parce que le matériau de base que Tarr y a à illustrer n’est pas le même que d’habitude. Ici, c’est un roman de Simenon. Généralement, c’est un scénario ou un roman de László Krasznahorkai.
Un autre exemple de « moment de grâce » – a fortiori musical – serait ce beau plan-séquence de Damnation (le second dans l’extrait) où, dans un même mouvement, la caméra balaye un espace peuplés de paumés qui se cachent le visage entre les mains comme pour ne plus être témoin de leur propre médiocrité, et sublime la chanteuse qui, toute mélancolique qu’elle soit elle-même, leur offre un peu de sublimation de leur propre spleen :
Mais la musique peut aussi accompagner un mouvement plus abstrait, moins celui de la caméra que celui d’un (pan de) film entier. La partition que Mihály Víg compose pour Le Tango de Satan accompagne parfois les seuls paysages déserts et prend alors des airs de symphonie de la désolation humaine, concourant elle aussi à nous faire voir dans ce « film-monde » comme un résumé de la vie du Terre (de ce qu’en pense Tarr du moins).
« Kész », « It’s done »
Dans Le Cheval de Turin, la musique accompagne bien le mouvement global qui anime l’œuvre, celui de la répétition. Reposant sur quelques notes reprises infiniment, la partition de Víg s’allie à la construction rigide du film en plusieurs journées répétitives pour rendre intelligible au spectateur le motif du cercle. Depuis Damnation, avec la sortie de l’environnement urbain ou des appartements clos, la caméra de Béla Tarr s’est éloignée des corps. Finie, l’intimité des premiers temps, comme l’écrit Stéphane Bouquet, « maintenant, ce sont les hommes dans le décor qui intéressent le cinéaste, des hommes aussi tristes que les pierres ou la terre sale. Pourtant si le style a changé, la claustration demeure. Les humains restent prisonniers de leur destin, pauvreté, alcoolisme, violence politique ou amour malheureux. Simplement, en ouvrant l’espace, Béla Tarr a inventé de nouveaux moyens pour faire sentir l’enfermement. » Le plus évident tient à la structure des récits qu’il construit. Rapports préfabriqués avait déjà, dès 1982, une construction cyclique, puisque la séquence de la dispute du couple marié qui ouvrait le métrage revenait à la quasi-fin sans que l’on sache vraiment si l’on vient de voir un flash-back ou si la construction narrative était plus complexe. Le Tango de Satan et sa structure en boucle, où deux mêmes journées sont montrées plusieurs fois mais en se centrant successivement sur différents personnages, est l’exemple de plus grande ampleur. Il y a également la ronde alcoolisée, interminable et magnifique, qui clôt Damnation. « C’est là une façon, une des façons seulement, qu’a Béla Tarr de nous dire qu’on est enfermés et qu’on n’en sortira pas » écrit à juste titre Bouquet. Dès l’ouverture du Le Cheval de Turin, la musique tourbillonnante, la caméra qui décrit des quasi arcs-de-cercle autour du cheval, revenant à son niveau puis le re-dépassant sans cesse, comme pour annoncer la structure cyclique du film à venir, le vent qui rend fou, l’ancrage tellurique des éléments (la charrette qui avance difficilement), l’effort physique : tout est là.
Séquence d’ouverture du Cheval de Turin
La particularité de ce dernier opus annoncé comme tel, c’est que la structure cyclique s’emballe, paraît se fendre pour prendre de la profondeur, pour précipiter les personnages dans le gouffre ultime. La chose est d’autant plus visible qu’ici, le spectateur n’a quasiment que cette structure narrative à observer, le film étant le plus radicalement épuré, le plus brut de son réalisateur. On s’en était offusqué lorsqu’il l’avait annoncé en février dernier parce que l’on y voyait avant tout des raisons économiques, mais on comprend mieux à présent pourquoi Béla Tarr a décidé que ce film serait son dernier. Il choisit, pour conclure son œuvre, de pousser son art dans ses derniers retranchements, en quelque sorte de le presser très fort une bonne fois pour toute afin d’en extraire l’essence. Dans un espace désert, un cocher infirme (Janos Derzsi vu dans Les Harmonies Werckmeister et en criminel dans L’Homme de Londres), sa fille qui l’aide (Erika Bók, qui incarnait déjà la petite Elsike dans Le Tango de Satan et Henriette dans L’Homme de Londres), le cheval qui les fait vivre et les lie avec la civilisation lointaine. Le cheval flanche, tout s’écroule. Il flanche parce qu’il sait sa fin prochaine, il sent avant les humains une fin du monde qui vient certes d’ailleurs, de quelque ville qui serait la proie des ambitieux, des malhonnêtes, des prêts-à-tout, mais qui ne les épargnera pas pour autant. Ici encore, on trouve cette espèce de personnage surplombant, qui se détache un peu par le haut du commun des mortels par sa conscience particulièrement aiguisée de la place de l’homme dans l’univers et de l’état d’avancement de la société. Mais il vient, débite sa vision du monde plus vite encore que dans les précédents opus du cinéaste, et s’en va. Un groupe de tsiganes passe prêt de la bicoque, menace potentielle. Le lendemain, le puits est inexplicablement asséché. Le cheval refuse toujours d’avancer. Un vent inouï emporte presque tout. La répétition du quotidien est entravée, le cercle brisé. Ne reste que l’ultime lutte contre les ténèbres, le vide, dans une ultime séquence (celle d’un film, celle d’une carrière) qui revient à l’essentiel : la peur du noir, l’étouffement du son (on repense à l’écrivain du Tango de Satan qui croyait que son ouïe s’affaiblissait, alors que c’était le Dernier Silence qui l’enveloppait). Si l’on a bien appris un mot en hongrois en découvrant ces quelques films précieux, c’est bien « Kész », « c’est fini ». « It’s done », se plaît à répéter Béla Tarr aux journalistes qui l’interroge sur les raisons de sa retraite. Tout est dit. Rarement le cinéma a vu fin de carrière plus cohérente, plus terriblement belle.




1 Comment
À lire, le tout petit (mais très bon) bouquin de Jacques Rancière : « Bela Tarr » (qu’il a publié à l’occasion de cette retro)