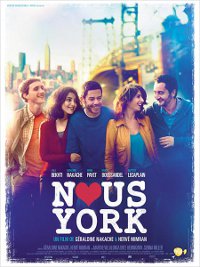Après le film noir avec
Brick et le
caper movie avec
Une Arnaque Presque Parfaite, Rian Johnson s’essaie à la science-fiction. Pour cet exercice, il s’offre un
high concept pour le moins passionnant. Joe (Joseph Gordon-Levitt) est un
looper, un tueur à gage exécutant des personnes trop gênantes que ses commanditaires lui expédient depuis le futur. Un boulot « simple » et grassement rémunéré jusqu’au jour où son contrat implique de tuer son lui futur (Bruce Willis). Sur sa première moitié, le film offre tout ce que l’on peut espérer du projet. La voix-off pose rapidement les règles, les composantes du film noir donnent un aspect réjouissant à l’entreprise et certains mécanismes font preuve d’inventivité (la communication par l’intermédiaire de cicatrices et d’autres sévices). Toutefois, il s’avère difficile de conserver cette dynamique sur toute la durée sans retourner à des ficelles de cinéma d’action plus lambda. A l’image d’un contexte glissant petit à petit du film noir au western, le film voit alors ses préoccupations dériver vers les implications émotionnelles de son sujet. Là où on s’attendrait à ce que le reste du long-métrage joue sur l’interaction entre Joe jeune et Joe âgé, le scénario ne leur laisse que très peu de scènes ensemble. Bien que leurs deux parcours soient liés, ceux-ci se suivent en parallèle pour créer une peinture dramaturgique sur le paradoxe du héros. Le jeune Joe mène une vie insouciante, sans attache et finalement vide de sens. Il économise pour vivre peinard à l’étranger mais n’a aucun but au-delà de ça. Sa vie est tellement précaire qu’elle est constamment sur le point de vaciller. De nombreux mouvements de caméra traduiront cette instabilité. C’est d’ailleurs par l’un d’eux que sera introduit un flashback relatant les souvenirs du vieux Joe. Celui-ci mènera ainsi une vie de débauche infantile avant de rencontrer tardivement l’amour. Le rapport de force viendra du fait que le vieux est incapable de raisonner le jeune sur ses erreurs. Avec la même ténacité, le premier fera tout pour retrouver le bonheur qui lui fut enlevé alors que le second n’hésitera pas à tenter de le tuer pour conserver son existence aussi creuse soit-elle. Deux trajectoires différentes mais deux individus identiques qui, chacun de leur côté vont remettre en cause qui ils croyaient être. En traquant sa version âgée, le jeune rencontrera des personnes lui faisant prendre conscience de sa médiocrité et revoir ses priorités. Quant à l’ancienne version, il fait abstraction de l’humanité qu’il a acquit pour accomplir sa tâche. Le point culminant de son trajet sera sans nul doute ce meurtre dont l’exécution froide et mécanique renvoie à
Terminator. Au-delà de cette scène et du thème du voyage dans le temps, Johnson n’hésite pas à citer le classique de James Cameron en reprenant son essence. Autrement dit, il met de côté une mythologie spectaculaire mais trop coûteuse à dépeindre (guerre contre les machines chez Cameron, domination télékinésique à la
Akira chez Johnson) pour se concentrer sur sa genèse et ses ramifications. En juxtaposant ce background avec la confrontation de son double personnage, Johnson crée un axe dramaturgique complexe et fort percutant. Du coup, si le rythme de la seconde moitié est assez lancinant, celui-ci est amplement pardonné.
– Matthieu Ruard –

Il y a maintenant près de trente ans, Tim Burton fut mis à l’écart du studio Disney pour avoir gâché temps et argent dans des projets inutilisables comme le court-métrage
Frankenweenie. Depuis, l’eau a coulé sous les ponts. Le réalisateur de
Beetlejuice a eu le loisir de devenir culte, culte et respecté, puis conspué mais toujours culte. Après le giga-succès de son
Alice Au Pays Des Merveilles, plus question pour la boite de tonton Walt de brider l’imagination de l’enfant prodige si réprimandé précédemment. Les motivations de Burton quant à demander au studio de financer aujourd’hui la version longue de
Frankenweenie apparaissent assez floues. Opération pour démontrer au plus récalcitrant des spectateurs qu’il n’a pas changé ? Utilisation de sa position pour une vengeance somme toute personnelle envers le studio ? Qu’importe les raisons comme toujours. Le plus problématique dans l’idée de faire un long-métrage avec
Frankenweenie vient du fait d’étirer l’histoire d’une demi-heure à quatre-vingt-dix minutes. Pastichant l’œuvre de Mary Shelley et sa célèbre adaptation cinématographique par James Whale, Burton mettait en scène un enfant nommé Victor qui va réanimer son chien fraîchement décédé. Un acte qui déchaîne les foudres de la petite communauté banlieusarde, celle-ci prenant à cœur de chasser cette monstruosité contre-nature. L’histoire de
Frankenweenie présentait en ce sens des limites adéquates au format court. Dans
Frankenstein, la créature est touchante par son pathétisme et la haine incontrôlable que lui voue le monde. Elle n’en demeure pas moins menaçante et d’une force pouvant se révéler authentiquement dangereuse. Le fidèle compagnon ressuscité de
Frankenweenie est la gentillesse incarnée et la seule menace pèse sur les réactions d’un voisinage aveugle. Or, il est difficile de tenir la mesure sur tout un film avec uniquement celle-ci en moteur. Logiquement, le long-métrage pêche dans sa manière de contourner le problème. Reproduisant avec un soin presque maladif les scènes et éléments visuels du court-métrage, la nouvelle version y multiplie les personnages secondaires et gonfle son univers en sacrifiant son rythme au passage. Néanmoins, ces coups de mou n’enlèvent pas la passion initiale de Burton envers son sujet. Libre de ses actes, Burton ne laisse jamais l’émerveillement de la stop-motion entrer en contradiction avec le macabre de son histoire et s’adjoint un visuel respectant toutes les ficelles horrifiques. Transitions aux effets de montage expressionnistes et N&B inquiétant à l’appui, le film reconstitue toute la force de ses œuvres qui inspirèrent Burton. Le point culminant et principale modification à l’histoire initiale sera en ce sens le climax. Par un tour de passe-passe narratif discutable, les expériences de Victor ne provoquent plus juste la résurrection des morts mais la recréation d’icônes du fantastique (créature invisible, Dracula, momie, Gamera…). Artificiel mais la réjouissance de l’entreprise est bien là. D’une certaine manière, cela démontre que
Frankenweenie trouve son intérêt dans une forme ultra-maîtrisée et non dans des thématiques que le cinéaste a déjà su mieux traiter ailleurs.
– Matthieu Ruard –
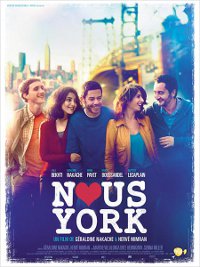
Depuis quelques années, une nouvelle tendance du cinéma populaire français s’est dessinée : le « film de potes ». Rien de neuf : cela a toujours existé. Mais si l’on utilise les guillemets, c’est pour illustrer à quel point le genre a fini par perdre de sa substance pour devenir une incroyable pompe à fric. La recette est désormais simple : prendre une petite troupe d’acteurs
bankable (également amis dans la vie), les réunir dans un endroit top classe, créer une alchimie immédiate entre eux pour que celle-ci puisse virer très vite à l’eau de boudin, et enrober le tout d’une thématique sociale ou existentielle pour que le public sorte de là en se disant «
Waow, c’était très profond ». Il y a deux ans, la critique s’était largement divisée sur
Les petits mouchoirs de Guillaume Canet, entre ceux célébrant un film générationnel dans la lignée des films de Claude Sautet et ceux qui hurlaient au trip bobo gavé de clichés vaudevillesques. Mais dans le cas de
Nous York, le fossé n’existera sans doute pas. Que l’équipe du sympathique
Tout ce qui brille soit coupable d’une purge pareille suscite même la colère, tant on se borne à croire qu’à la suite du succès-surprise de leur film, la fine équipe emmenée par Hervé Mimran et Géraldine Nakache n’avait pour seul désir que de claquer la thune de leurs producteurs dans un trip narcissique. Ici, nous voici donc à New York, terre de tous les espoirs : cette image plus éculée tu meurs est le point de départ du pitch, puisque trois amis y débarquent pour retrouver leurs deux copines d’enfance, qui ont visiblement réussi dans la vie. Mais bien sûr, c’est faux : la première vit dans un loft à 300 patates parce qu’elle est la bonne à tout faire d’une actrice casse-burnes, et la deuxième comble les trous en apprenant le français à des retraités. Et comme ces cinq imbéciles sont aussi soudés que frimeurs, ils vont tous se manger le mur : les uns claquent tout leur fric pour finalement se retrouver à sec, les autres oublient peu à peu leurs illusions pour retomber sur Terre, et patati et patata… Mais le pire, c’est qu’avant ça, le film frise le néant sans la moindre honte : sujet inexistant, écriture bâclée, humour au point mort, acteurs qui se vannent quand ils ne se font pas des politesses, engueulades à gogo pour des motifs stupides, séquences qui remplissent du vide avec du creux (leitmotif visuel : les cinq matent l’East River en silence, et c’est très chiant), et pire encore, un décor jamais exploité. En effet, pour la bande, le côté
cool de New York consiste à bouffer gras, à repérer des coins vus dans des séries télé, à passer d’un endroit à l’autre sans jamais se poser et à gueuler « Obama » toutes les cinq minutes (euh, ça, j’ai toujours pas pigé…). Logique : le seul but pour eux, c’est d’utiliser l’appareil photo (ou la caméra) pour bien montrer qu’ils sont là, qu’ils sont trop contents et que la vie est trop-cool-mais-pas-toujours-quand-même. Le spectateur, lui, se fait tellement chier qu’il a vraiment l’impression d’être pris pour un cochon de payant. Pour un film qui était supposé emmener le public dans une balade cool et conviviale, il n’y a rien de pire.
To the… exit ?
– Guillaume Gas –

Jason Blum est un homme heureux. En quelques années, le producteur de
Paranormal Activity s’est construit un petit château confortable dans le royaume de l’horreur. Depuis le succès (incompréhensible) du film d’Oren Peli, le bonhomme a mis un point d’honneur à investir dans le genre avec succès (tout au moins commercialement). C’est qu’il s’emploie à se baser sur de bonnes vieilles méthodes : un budget limité à quelques millions de dollars, des réalisateurs avec une certaine réputation à qui on promet une liberté d’action sur laquelle ils ne cracheraient pas (Rob Zombie, Barry Levinson, Joe Johnston), une promotion mettant en avant une filiation fictive avec
Paranormal Activity… Une formule peu originale mais simple et efficace avec une rentabilité quasi-assurée. Mais tout aussi profitable soit l’équation, celle-ci n’est pas infaillible surtout si on se penche sur la qualité artistique des produits finaux. Or, de manière surprenante, les résultats sont loin d’être des péloches exécrables à défaut d’être inoubliables. Si
Insidious s’était avéré un divertissement sympathique et rondement mené, nul doute que c’était grâce au talent de James Wan (
Saw) à la caméra. On ne pariait pas forcément plus sur
Sinister avec Scott Derrickson (
L’Exorcisme D’Emily Rose) aux commandes. Pourtant, l’effort qu’il fournit est pour le moins attachant.
Etonnamment, Sinister entretient un certain nombre de rapports avec Insidious que ce soit dans sa forme (construction en quasi-huis clos pour satisfaire aux conditions budgétaires) et son fond (peinture d’une figure paternelle en complète déconnexion avec une famille qu’il doit protéger). A l’image d’un Wan se concentrant sur une exécution brillante de jump-scares éculés, Derrickson se penche sur une horreur primaire. Son cinémascope convoque régulièrement la peur de l’obscurité et les légions de bruits inquiétants d’invoquer l’angoisse face à l’inconnu. Des mécanismes simples et honnêtement exécutés. Mais le véritable intérêt de Sinister se trouve dans l’incarnation de sa menace. Emménageant dans une maison pour écrire sur le crime qui y fut commis, le héros découvre un lot de bobines super 8. Chaque film montre l’assassinat d’une famille et s’avère marqué par la présence d’un être démoniaque. Par là, Derrickson construit son récit sur une plaisante réflexion sur le pouvoir de l’image. Convoquant le spectre de Blow-Up, le metteur en scène dévoile un héros scrutant l’image et recherchant des indices en s’immisçant dans la moindre parcelle de celle-ci. La finalité diffère bien sûr du film de Michelangelo Antonioni. Par son argument fantastique, Sinister montre un héros qui finit par pénétrer au cœur même des images qu’il scrute. Il ne jouit plus de la sécurité du spectateur et son existence se calque petit à petit sur les motifs des snuff movies qu’il visionne. Derrickson construit cela par d’intéressantes touches donnant un semblant d’atmosphère dérangeante. Ce travail appliqué sur le rapport à son support, Derrickson prend même soin de l’utiliser pour construire son personnage principal lorsque celui-ci regarde d’anciennes vidéos d’interviews montrant la version idéalisée de lui-même.
Le revers de la médaille est qu’à force de jouer sur des peurs basiques, le film marque de sérieuses limites. Malgré ses efforts, Derrickson n’a pas le talent d’exécution de Wan. Il balance ainsi son lot d’effets banals plus ou moins agaçants (la bande-son agressive accompagnant chaque film super 8), construit parfois des scènes justes embarrassantes (Ethan Hawke déambulant dans sa maison entouré par des ch’tis enfants morts invisibles) et se permet des facilités aberrantes (le héros pointe un indice crucial sur l’accomplissement des meurtres et l’oublie complètement par la suite). Une batterie de casseroles qui vient nous rappeler le caractère voulu juste divertissant par la production. Au moins, cet objectif bêta est bien atteint.
– Matthieu Ruard –
Articles similaires