
D’où diable est venue cette idée farfelue comme quoi le nouveau film d’Andrew Dominik ne serait rien d’autre qu’un ramassis de pompages des plus grands maîtres du polar ultraviolent ? Le réalisateur de L’assassinat de Jesse James serait-il atteint de Refningite, de Scorsesetésie ou de Tarantinostérose au point d’oser reproduire en live tout ce qui a fait la patte de ces génies ? Ou alors, doit-on ces craintes à une bande-annonce trompeuse ou au bide monumental que le film vient de se manger outre-Atlantique ? En fait, la seule référence que l’on pourrait noter serait celle d’un cinéaste pour qui l’extrême ralenti serait gage d’audace artistique (Snyder ou Bekmambetov, je vous laisse choisir), et le plus rassurant, c’est qu’elle ne concerne qu’une seule scène du film : un meurtre filmé au ralenti avec gros plans sur les douilles, sur les giclées de sang, les vitres qui se brisent, les impacts, etc… Alors que ça ne sert ici à rien. Mais passons, car le film n’est finalement rien de ce qu’il laissait supposer. Pour tout dire, on jurerait presque que sa présence en compétition à Cannes viendrait de sa caractéristique principale : au premier plan, une banale (et pas très intéressante) histoire de tueur à gages chargé d’éliminer trois bouseux débiles qui ont braqué un tripot, et en arrière-plan, un pays pauvre et délabré, économiquement ruiné, où l’argent est devenu la seule règle (ici, tout n’est que business) et où un discours politique faussement rassurant ne cesse d’aboyer son hypocrisie à travers la radio ou la télévision (toujours présente dans un coin du cadre). Pas la peine de râler sur la supposée minceur du scénario, tant celle-ci ne fait que renforcer le propos du film : tandis que les médias se voilent la face sur l’Amérique profonde, cette dernière ne cesse de rester au point mort, avec ses personnages à la ramasse, ses chômeurs camés qui s’embarquent dans de sales draps pour un peu de fric, ses gangsters minables qui se complaisent dans un rôle qu’ils ne maîtrisent pas et ses commerçants prêts à tout pour ne pas se retrouver à la rue. Du coup, entre une mise en scène éblouissante qui combine le travelling avec la fixité, des dialogues qui ne soulèvent que du banal (on y parle de tout et de rien, parfois pour rien) et des éclats de violence qui tanguent presque vers la farce à la Coen, le film touche juste, peut-être au point de s’imposer comme l’un des rares films de l’année à aborder aussi bien la schizophrénie des Etats-Unis d’aujourd’hui. Dans le rôle d’un tueur conscient de voir dans cette nation moins un état d’esprit qu’une pompe à fric, l’excellent Brad Pitt va même jusqu’à remuer le spectre de Killer Joe, dont Cogan peut aisément s’imposer autant comme un complément que comme le petit frère. En plus sage.
– Guillaume Gas –

Même de la part de la réalisatrice de ce Fish Tank (2009) qui nous avait tant remué, on n’osait imaginer une fresque en costumes aussi éloignée de toute idée d’académisme. Andrea Arnold parvient même à nous faire nous interroger sur les moyens cinématographiques les mieux à même de transposer à l’écran l’essence du romantisme. Pour s’en tenir aux sœurs Brontë, le format large et les cadrages réglés du film qu’André Téchiné a consacré à ces dernières ou du Jane Eyre de Carry Fukunaga (adapté de Charlotte, la sœur aînée d’Emily) également sorti cette année paraissent nettement moins à même de rendre compte du feu des passions amoureuses une fois que l’on a découvert Les Hauts de Hurlevent. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la cinéaste conserve son identité artistique tout en passant du drame social contemporain à la fresque historique, et la clé est là. Elle explique elle-même n’avoir jamais eu le projet de mettre en scène de film en costumes mais avoir eu l’impression que c’était le roman qui la choisissait, comme une évidence. Plus que de s’y soumettre, elle s’approprie sans complexe le matériau de base, décidant par exemple d’appuyer l’altérité du personnage de Heathcliff – suggérée par quelques éléments du roman – en en faisant un Noir, ou de se concentrer sur certains pans du long récit de Brontë sans chercher l’exhaustivité. Ce qu’elle adapte bénéficie ainsi une force d’incarnation incroyable. Plus qu’une romance organisée autour de rebondissements dramatiques appuyés, c’en est une à fleur de peau qu’elle livre, entièrement suivie comme un ballet des sensations plein de douleur et empreint d’une poésie macabre qui a tout de romantique. Grâce à de merveilleux acteurs aux mimiques et aux gestes desquels on est littéralement suspendu, Andrea Arnold sait faire fleurir une véritable poésie visuelle sur le plus boueux des sols. Tourné presque intégralement en lumière naturelle, caméra souvent portée, le film semble se donner comme but de représenter le plus précisément possible les états d’âme de ses protagonistes, et avant tout de Heathcliff dont il adopte principalement le point de vue – l’audace de l’adaptation est donc poussée jusqu’au bout. Or ces états émotionnels trouvent leurs conditions dans le cadre spatial qui en est le théâtre : cette lande du titre, cette nature à laquelle le montage donne parfois une importance égale à celle des personnages, dans un geste qu’on qualifierait de malickien si les animaux n’étaient pas omniprésents pour rappeler la sauvagerie de l’expérience humaine, l’apprêté des sentiments amoureux non transformés en actes. Les plans de coupes sont nombreux à venir figurer le ressenti des amants sacrilèges : une rosée goutant sur la mousse des sous-bois, des branches nues agitées par le vent ou une pluie torrentielle sont autant de représentations de la rêverie ou de la douleur dont Arnold densifie l’évocation de la relation purement factuelle entre ses personnages. Jusqu’à livrer l’un des plus beaux films d’amour de cette année – qui n’en manque pas.
– Gustave Shaïmi –

L’un des pièges les plus terribles concernant les grands cinéastes, c’est de signer un jour ce qui constituerait leur film-somme, au risque de voir tous leurs films suivants subir l’inévitable comparaison ad vitam aeternam. Cinéaste espagnol parmi les plus géniaux du moment, Alex de la Iglesia n’échappe pas à ce triste sort : alors que l’euphorie et la violence de Balada Triste ne parviennent toujours à s’effacer de notre cortex, il était inévitable qu’Un jour de chance passe pour un film mineur. Sans compter qu’avec ce nouvel opus, le cinéaste revenait à sa recette fétiche : la farce hilarante et corrosive où la société espagnole bouffe ses tapas par les narines à force de s’en prendre plein les canines, tandis que le public se gave de fous rires et d’un regard acide sur le monde contemporain. Rien de nouveau, donc ? Là où le film déroute un peu, c’est sur l’exploitation première de son pitch : avec cette histoire d’un chômeur au bout du rouleau, accédant à la célébrité suite à un spectaculaire accident durant l’inauguration d’un musée, tous les ingrédients étaient réunis pour signer un film sardonique sur l’Espagne d’aujourd’hui, offrant ainsi la parole aux victimes de la crise et stigmatisant l’avidité des plus riches. Sauf qu’à la place (et ce n’est pas plus mal, après tout), Iglesia ne vise qu’à s’amuser, prend un plaisir vicieux à se lâcher dans l’agressivité et met tout le monde dans le même panier : les journalistes fouineurs en quête d’un gros scoop, les politiciens prêts à noyer le poisson pour ne pas ruiner leur carrière, les maires obsédés par le tourisme, les anonymes prêts à filmer la souffrance d’autrui pour les vendre ensuite à la presse, les agents cupides prêts à tout pour multiplier les zéros, les médecins plus ou moins incompétents, et même le héros, prêt à exploiter son propre malheur en échange d’un boulot ou d’une grosse somme d’argent. Tout cela au cœur d’un vaste amphithéâtre de l’époque Romaine, où cette smala de curieux avides se presse pour admirer la cruauté et la mort en action. A travers ce raccourci cinglant de la société espagnole, la recette favorite du cinéaste ne varie donc pas d’un iota, mais sa mise en scène paraît toutefois moins inspirée qu’avant. Même la caricature qu’il évitait si facilement autrefois en se basant sur un univers baroque ou décalé pointe ici parfois son nez, ne serait-ce qu’en raison d’un premier degré qui s’incruste de temps en temps. Mais sa rage et sa méchanceté, si rares et si galvanisants, n’ont strictement rien perdu de leur puissance, et c’est tout ce que l’on attendait de lui.
– Guillaume Gas –
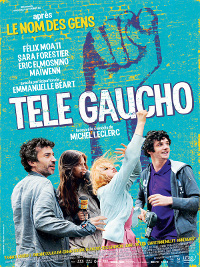
Y a comme un truc qui cloche dans l’affaire. C’est quand même bizarre : on s’est gondolé de rire plus d’une fois, on a passé un bon moment dans une salle de cinéma, on n’a pas particulièrement l’impression de s’être ennuyé, et pourtant, dès que le générique de fin fait son apparition, on fait la grimace. Pourquoi ? N’avait-on pas eu d’intenses fous rires devant Le nom des gens ? N’avait-on pas jubilé devant la prestation d’acteurs complètement dingues, dont une Sara Forestier totalement déglinguée ? N’avait-on pas eu la sensation de tenir enfin une comédie française qui équilibre aussi bien le rire et le fond ? Ben oui, mais pour son nouveau long-métrage, Michel Leclerc a complètement raté son objectif, la faute à un équilibre pour une fois absent et une flemmardise assez effarante dans la mise en scène. Au vu du sujet (une bande de provocateurs anarchistes à la tête d’une chaîne de télé indépendante dans les années 90), le mixage entre fou rire et politique pouvait donner lieu à un nouveau coup de maître, du moins si Leclerc avait pris la peine de conserver un axe narratif au lieu d’en éparpiller une bonne vingtaine sans jamais choisir. Le fait est que l’on passe tellement d’un sujet à l’autre, d’une idée à l’autre, d’un personnage à l’autre, que l’on ne sait finalement plus ce que le film est censé illustrer. Satire impitoyable de la société ou des anarchistes ? Récit d’initiation d’un jeune homme qui rentre dans le monde adulte ? Ode aux nantis de la société ? Pamphlet anticonsumériste ? Ou alors grosse pochade sur une bande d’allumés qui foirent leur révolution dans les grandes largeurs ? Mystère… Et si les fous rires sont légion, ils ne sauvent en rien le film à force de le faire ressembler à une suite de sketches sans rapport les uns avec les autres. Ne reste alors qu’une poignée d’acteurs qui s’éclatent dans leur coin : si Eric Elmosnino tire son épingle de jeu en composant un véritable lézardé de la cafetière, on s’agace de retrouver Sara Forestier, pourtant si talentueuse d’habitude, en train de nous refaire le coup de la décervelée qui ne pige rien à rien et qui vit (et agit) en décalage avec ceux qu’elle côtoie. Rien à dire de plus sur Télé Gaucho, si ce n’est que le côté foutraque d’un film, s’il peut parfois servir la cause d’un sujet, peut aussi devenir un terrible handicap.
– Guillaume Gas –
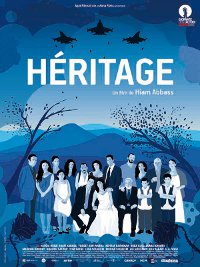
On admire beaucoup Hiam Abbas, devenue en l’espace d’une quinzaine d’années seulement l’actrice du monde arabe (elle est née en Galilée mais d’une famille palestinienne) la plus mondialement célèbre de l’histoire du cinéma. Mais lorsqu’elle dit avoir appris auprès de cinéastes importants avec lesquels elle a tournés et qui lui avaient donné la responsabilité de gérer des équipes d’acteurs amateurs arabophones, on rigole doucement. Cela ne la rend pas cinéaste pour autant. Si les interprètes de la fratrie d’Héritage sont effectivement bons, ils ne le sont presque jamais assez pour donner à l’histoire qu’ils servent quelque relief que ce soit. Il faut dire qu’ils ne sont pas aidés : entre un père veuf et malade, un aîné croulant sous les dettes, un candidat aux élections municipales qui trompe sa femme, un médecin stérile, une fille taiseuse et une autre éprise de liberté (Hafsia Herzi), seules quelques petites « rencontres » sont ménagées. On pourrait rajouter qu’en guise de rôles secondaires, on compte un politique israélien corrompu et une libanaise chrétienne reniée par les siens après son mariage avec un Musulman. Ou encore préciser que les quatre-vingt-dix minutes de métrage se déroule sur fond de guerre, de mariage et d’élection. Eh ben voyons. A deux-trois scènes près, cette multiplication des (profils à) problèmes ne débouche jamais sur un scénario digne de ce nom, pensé en termes d’enjeux et de rythme. L’envie de l’actrice-réalisatrice de profiter de sa renommée pour donner un écho à des enjeux sociétaux propres à ses origines est honorable sur le papier. Sa mise en pratique en est simplement des plus excessives, et au final un vrai ratage. On ne liste pas les problèmes de société comme on liste ses courses.
– Gustave Shaïmi –

Quelques mois seulement après les magnifiques Enfants Loups, Ame & Yuki de Mamoru Hosoda, dont on vous promet de vous reparler à leur sortie dans les bacs, un autre film – français cette fois – vient rappeler que l’animation n’a pas besoin d’être complexe pour être prenante. On ne s’étonne nullement d’entendre Benjamin Renner, premier réalisateur arrivé sur le projet, citer Miyazaki et Hosoda parmi ses maîtres. Non pas qu’on ait quoi que ce soit contre le rendu numérique des Cinq Légendes, récente et belle surprise des studios Dreamworks. Mais voilà : le dessin au crayon comme base d’un travail d’animation peaufiné par la suite en recourant à des techniques informatiques offre, dans sa simplicité et toute la science du trait précis qui y préside (c’est tout le paradoxe), une pureté de la représentation des émotions (les visages des personnages du film de Peter Ramsey étaient parfois bâclés). Il faut voir comment, en simplifiant le trait des dessins originaux de Gabrielle Vincent, les réalisateurs rendent les visages de leurs protagonistes au moins aussi touchants qu’ils ne l’étaient déjà dans les célèbres albums pour enfants. L’apparition progressive des premières images via plusieurs esquisses, la liberté des traits de crayon apparents sur fond blanc, celle de la simplification du défilement d’un décor lors d’une scène d’action ébouriffante ou encore celle d’une séquence abstraite sur la célébration du printemps (un hommage à Fantasia confié à un animateur spécifique) sont autant d’aveux faits durant le film même du plaisir qui a été pris à son processus d’élaboration (on trouve, sur le plan narratif, une mise en abyme du dessin qui va dans ce même sens). Ils ne sont en rien des obstacles à l’immersion dans le film, largement assurée par la beauté de l’histoire et des dialogues, signés Daniel Pennac. Les plus jeunes y recevront une belle leçon d’éveil civique à travers une parabole sur la tolérance et y entendront peut-être pour la première fois le mot « société » (dans un si beau contexte, quel chance !). Les plus grands y trouveront même, amusés ici ou touchés là, les échos de dérives sécuritaires étatiques ou plus directement un discours s’insurgeant contre le conformisme social. On ne décroche jamais d’un récit parfaitement mené auquel la grâce du visuel (ce rendu « pastel » permis par un logiciel de traitement numérique est incroyable !) donne une ampleur bohème supplémentaire. En animation comme ailleurs, pas besoin de se faire complexe pour être prenant, pour nous embarquer dans un univers fantaisiste et nous émouvoir. Il suffit pour cela de savoir bien raconter les histoires.
– Gustave Shaïmi –
