
Lorsqu’il est souvent dit et répété que Lyon est la ville du cinéma, ce n’est pas seulement pour radoter, c’est aussi pour rappeler à quel point la capitale de la région Rhône-Alpes reste le lieu de toutes les rencontres et de toutes les sensibilités artistiques, permettant à chacun de découvrir de nouveaux talents et de se forger autant que possible sa propre culture de cinéphile. Cette année, le cinéma Comoedia de la ville offre une nouvelle fois cette occasion en or avec ce qui s’est imposé comme le rendez-vous incontournable des amateurs d’un cinéma à la fois libre et différent.
Après avoir organisé pendant trois ans l’Etrange Festival de Lyon, l’association bénévole ZoneBis entame un nouveau chapitre de cette rencontre annuelle dédiée au cinéma dit « alternatif », et remet les compteurs à zéro : si le festival change de nom (Hallucinations Collectives), tout a été multiplié par deux. Le nombre d’avant-premières, le nombre de séances, la durée du festival, ainsi qu’une grande nouveauté non négligeable : la présence d’un jury très éclectique, composé de quatre personnalités du cinéma, destiné à juger une compétition composée de huit films et de huit courts-métrages.

Composition du jury
– Eric Valette, réalisateur français (Maléfique, Une affaire d’Etat, La proie)
– Catriona McColl, actrice fétiche de Lucio Fulci
– Frédéric Thibault, journaliste, programmateur de films et expert du cinéma d’exploitation
– Romain Le Vern, journaliste sur Excessif et Critikat (et sosie d’Orlando Bloom !)
Compétition Longs-métrages (le vainqueur est indiqué en bleu) :
– The Loved Ones (Sean Byrne)
– Bedevilled (Jang Cheol-soo)
– Cadavres à la pelle (John Landis)
– Balada Triste de Trompeta (Alex de la Iglesia)
– Tucker & Dale fightent le Mal (Eli Craig)
– J’ai rencontré le diable (Kim Jee-woon)
– Symbol (Hitoshi Matsumoto)
– Heartless (Philip Ridley)
Compétition Courts-métrages (le vainqueur est indiqué en bleu) :
– Mrdrchain (Ondrej Svadlena)
– Brutal Relax (Adrian Cardona, Rafa Dengra & David Munoz)
– The external world (David O’Reilly)
– Chloe and Attie (Scooter Corkle)
– Through the night (Lee Cronin)
– La petite mort (Jan Gallasch)
– Otologie (Marc Ory)
– Ich bin’s Helmut (Nicolas Steiner)
Autres évènements
– La présence de l’acteur Richard Allan, venu dédicacer son livre « 8000 femmes »
– La double séance Carte blanche à Mad Movies, présidée par Fausto Fasulo
– Le chapitre Nouvelles visions, constitué de deux films autoproduits et inédits en salle
– Plusieurs thématiques : Ozploitation, La bombe dans tous ses états, Serial-killers, Troma…
– Une séance de minuit, avec le cultissime Perdita Durango d’Alex de la Iglesia
– Une séance interdite, avec La femme objet de Frédéric Lansac
– Une séance pour (grands) enfants, avec Howard The Duck de William Huyck
– Le Cabinet des curiosités, avec le rarissime Parents de Bob Balaban
– Un documentaire
– Deux expositions artistiques, ainsi que divers stands de BD, DVD, affiches, etc…

LES NUITS ROUGES DU BOURREAU DE JADE
Julien Carbon et Laurent Courtiaud – France/Chine – 2011 – Séance d’ouverture
Après avoir officié comme scénaristes pour Tsui Hark et Johnnie To (on leur doit le scénario du très intéressant Running out of time) ainsi qu’à des postes divers pour d’autres cinéastes asiatiques, Julien Carbon et Laurent Courtiaud auront finalement mis en commun leurs forces et leur passion cinéphile commune pour réaliser un premier long-métrage dont les audaces et les qualités formelles tranchent aisément avec le reste de la production contemporaine. Les amateurs d’horreur pure et d’intrigue à suspense risquent d’être déçus, tant le film joue sans cesse avec les attentes du public : il y sera certes question d’une vague intrigue autour d’un mystérieux poison ancestral (censé multiplier les sensations de douleur et de plaisir), mais l’intérêt du projet tient moins dans ce que ses images racontent que dans les sensations qu’elles génèrent. Moins film de genre stricto sensu qu’œuvre fétichiste sur la montée du plaisir, Les nuits rouges du Bourreau de Jade sidère par sa virtuosité, son look sophistiqué, ses audaces visuelles et graphiques, son goût du baroque, ses mouvements chorégraphiés et son absence totale de discours théorique. Juste un énigmatique jeu de piste dont le rythme apparemment serein, présent sur toute la durée du métrage, atteint très vite son apogée dans une poignée de scènes gore tétanisantes qui excitent autant qu’elle révulsent.
Entièrement dominé par une Carrie Ng au charme vénéneux, le film réussit également la fusion absolue entre les sensibilités cinéphiles de l’Orient et de l’Occident, comme la rencontre élégante et baroque entre Jean-Pierre Melville et Takashi Miike. Jamais avares en idées transgressives et toujours exemplaires pour soigner leur mise en images, les deux réalisateurs ne se refusent rien, font preuve d’une liberté artistique assez dingue tout en donnant au résultat une vraie beauté visuelle. Et aboutissent, in fine, à une expérience de cinéma aussi rare que précieuse, explorant l’univers sombre des fantasmes SM avec un plaisir non dissimulé et largement partagé par celui qui, en son âme et conscience, accepte d’en ouvrir les portes. Avec ce premier essai diaboliquement excitant, Julien Carbon et Laurent Courtiaud s’imposent en fétichistes géniaux.
>>> Lire la critique complète du film

MANIAC
William Lustig – Etats-Unis – 1980 – Théma « Serial-killers »
Au royaume des films-choc ayant subi les foudres d’une censure impitoyable, le film le plus célèbre de William Lustig ne serait certainement pas le moins bien placé au banquet. Considéré pour beaucoup comme le summum de l’horreur sur pellicule (notamment en raison de son affiche mythique), Maniac reste encore aujourd’hui à la hauteur de sa fameuse réputation, rejoignant ainsi de nombreuses œuvres du cinéma d’horreur des années 80 (Zombie et Massacre à la tronçonneuse, entre autres) sur le terrain du film de terreur hyperréaliste, quittant le giron du surnaturel pour s’aventurer dans des eaux bien plus dérangeantes. Initié dès le départ par l’acteur Joe Spinell (également co-scénariste) et réalisé dans des conditions proches du cinéma-guérilla, le film dérange et terrifie par son absence totale de jugement et sa neutralité à toute épreuve : Lustig se contente d’illustrer un scénario simple (une suite de meurtres, avec les causes et les conséquences), en retranscrivant autant que possible le cheminement intérieur du tueur qui les a engendrés.
Plongée radicale au cœur d’une aliénation mentale qui dérive peu à peu vers la folie suicidaire, Maniac donne à l’horreur un visage humain avec un souci de réalisme qui frise en permanence avec le documentaire. Autant dire qu’en terme de scènes-choc, le film greffe dans la tête du spectateur une bonne dizaine de scènes mémorables, dont le point d’orgue reste la courte-poursuite dans le métro. Pour le reste, rarement un film n’avait autant construit sa puissance et sa réussite que sur sa bande-son : outre des sonorités stridentes de Jay Chattaway et le souffle de Joe Spinell qui contribuent d’emblée à susciter un vrai malaise, le travail sur le son rejoint les partis pris de mise en scène de Lustig, consistant à épouser l’intimité mentale et sentimentale d’un psychopathe. Plonger dans les méandres d’un cerveau malade, hanté par un passé traumatisant et dévoré par des pulsions incontrôlables : voilà ce que propose Maniac. Et surtout, voilà ce qu’aucun autre film ne serait capable de retranscrire aujourd’hui avec autant de force.

PIQUE-NIQUE A HANGING ROCK
Peter Weir – Australie – 1975 – Théma « Ozploitation »
Il est des films qui vivent en vous, qui vous hantent pendant longtemps, qui suscitent un mystère si intense qu’il continue de faire des effets secondaires quelques jours après la projection. Pique-nique à Hanging Rock fait partie de ces films, en plus d’être aujourd’hui célèbre pour avoir été la principale source d’inspiration de Sofia Coppola pour son premier film Virgin suicides. On voit bien ce qui a pu séduire la réalisatrice : une réalisation douce et hypnotique qui sublime de jeunes et jolies filles élevées dans un environnement aux codes stricts, pour finalement les abandonner au cœur d’un mystère irrésolu. On ne coupera pas au suspense en indiquant de quoi il en retourne chez Peter Weir : lors d’un pique-nique près d’un énorme rocher réputé dangereux, trois jeunes filles et leur professeur disparaissent sans aucune explication après s’être aventurées au cœur du rocher. Un peu comme des anges de Boticelli échappant à la gravité terrestre, comme dans un rêve, pour finalement partir ailleurs, là où le rationnel s’effrite. Car, oui, il faut parler de « rêve » à propos de ce film hallucinant, à travers lequel Peter Weir suspend le temps et bouscule en permanence notre perception des choses.
La disparition dont il sera ici question restera un mystère dont la clé semblera s’être envolée pour toujours, d’autant que la piste du surnaturel et de la métaphysique n’est jamais très loin. De plus, derrière ce mystère impénétrable, si Weir évoque avant tout le mystère de l’adolescence sous un angle symbolique, il trouve surtout l’occasion d’aborder le conformisme de l’époque, étouffant si fort la jeunesse et ses envies de liberté que celle-ci en arrive à larguer les amarres. Mais vers où ? La Terre ? Le ciel ? Ailleurs ? Le film ne propose aucune réponse cartésienne et épouse une forme d’épure totale : de la moindre note de musique (impossible d’oublier son célèbre thème à la flûte de pan) jusqu’à la prestation des actrices, en passant par la beauté monumentale des images et l’incroyable travail sonore qui fut effectué, Pique-nique à Hanging Rock est une invitation au rêve, un conte à la fois doux et cruel, sensible et intemporel, qui procure les mêmes sensations qu’une séance d’hypnose. Cela remonte à plus de trente ans, et depuis, Peter Weir n’a jamais fait mieux. Un chef-d’œuvre, ni plus ni moins.

THE LOVED ONES
Sean Byrne – Australie – 2009 – Compétition officielle
En plus des traditionnelles avant-premières d’œuvres en manque de distributeurs, le festival Hallucinations Collectives offre surtout l’avantage de découvrir en avance un grand nombre de films de genre déjà acclamés dans divers festivals. Cette année, le festival de Gérardmer est à l’honneur, puisque pas moins de quatre films présentés en compétition dans ce festival sont révélés au grand public. Le premier de la sélection sera The Loved Ones, survival australien déjà acclamé un peu partout et présenté comme le pendant sadique de Jennifer’s body. La comparaison est assez juste, surtout quand on voit à quel point le film de Sean Byrne se plait à user d’un canevas de teen-movie pour se livrer à un torpillage des apparences. Et comme tout bon film sur l’adolescence part en général d’une frustration quelconque, c’est un sentiment d’indifférence qui semble pousser une fille timide à kidnapper, séquestrer et torturer le plus beau garçon du lycée.
Bon, en même temps, c’est clair que voir une psychopathe en robe rose bonbon en train de torturer un acteur de Twilight à coups de perceuse peut faire figure de plaisir coupable non dissimulé, d’autant que la majorité des scènes-choc (le film est souvent d’une ultraviolence inouïe) ont de quoi faire bondir le cinéphage de son siège. Or, très vite, ayant bien caché son jeu, le réalisateur passe au niveau supérieur : dès que les festivités s’annoncent et que la famille de la détraquée révèle toute sa perversité sous-jacente (on notera une pointe d’inceste), le film effectue un virage à 180°, faisant alors tout pour inverser les rôles et contredire les apparences, y compris dans son illustration en parallèle du bal de fin d’année (un « nerd » invite une pseudo-gothique sexy au bal, laquelle se révèle être plus sensible que prévue). Très malin dans son approche d’une adolescence aussi paumée dans ses repères que dans ses désirs, The Loved Ones constitue un croisement idéal entre le film d’horreur sadique et la mélancolie maladive propre au cinéma de John Hughes.

BEDEVILLED
Jang Cheol-soo – Corée du Sud – 2010 – Compétition officielle
Bêtement rebaptisé Blood Island pour son exploitation DTV en France, Bedevilled fut le vainqueur du Grand Prix au dernier festival de Gérardmer. Et au bout du compte, comme ce fut le cas là-bas ou à Cannes, le film n’a pas manqué de créer des réactions variées. S’inscrivant malgré lui dans cette tradition récente du film de vengeance à la sauce coréenne (auquel viendra se rajouter J’ai rencontré le diable de Kim Jee-woon), le film prend de nouveau place dans une société gangrénée de l’intérieur par la lâcheté et l’hypocrisie, ici métaphorisée par une île où une petite communauté de fermiers vit en totale autarcie, coupés du monde moderne, et où se rend une citadine désireuse d’échapper au stress de la vie quotidienne. Sauf que son congé prolongé va se révéler infernal, la belle découvrant l’existence d’une micro-société décadente où règnent en masse la sauvagerie et le machisme, sans oublier quelques relents d’inceste et de sadisme répugnants. Alors quand l’une des femmes se lasse d’être humiliée et violée, l’usage de la faucille se révèle vite adapté pour autre chose que la cueillette des patates… Le moins que l’on puisse dire, c’est que, pour son premier film, Jang Cheol-soo a chargé la mule. Peut-être trop à vrai dire, et c’est là que réside le seul reproche que l’on pourrait faire au film : à force de trop se focaliser sur le schéma binaire qu’il met en place, entre une pauvre victime réduite à l’état de punching-ball et des fermiers infects dont les seuls traits de caractère se limitent à être lâches et violents, le réalisateur rabaisse son sujet au niveau d’un vigilante manichéen et délaisse trop vite la dimension sociologique qui pouvait se dégager d’un drame aussi horrible (hormis lors de son final).
Toutefois, même en étant trop exacerbé dans sa méchanceté (le film va souvent très loin dans l’insoutenable), Bedevilled s’avère en revanche irréprochable sur tout le reste : mélange des genres clairement assumé (poésie et violence se côtoient parfois dans la même scène), pureté de la mise en scène, maîtrise formelle absolue, casting impeccable, décors magnifiques, photo sublime, et surtout, un regard à la fois tendre et violent sur le monde, soufflant parfois le chaud et le froid dans la même scène, qui rappelle sans trop de difficulté le cinéma de Kim Ki-duk. En cela, le film n’a pas volé son Grand Prix au festival de Gérardmer. Et à tout prendre, les qualités l’emportent largement sur les défauts. On enrage tout de même de constater qu’avec un peu plus de nuance dans le propos, on aurait pu côtoyer un très grand film.
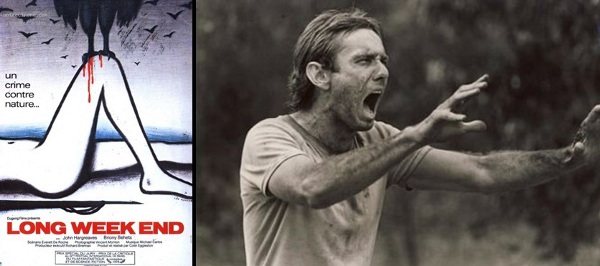
LONG WEEKEND
Colin Eggleston – Australie – 1977 – Théma « Ozploitation »
La nature n’est pas notre amie. Une idée qui, en plus d’expédier les thèses rousseauistes dans les orties, fut largement mise en avant aux yeux des écologistes lors de la sortie de Délivrance, au début des années 70. Quelques années plus tard, un jeune cinéaste australien se réapproprie l’idée en l’inscrivant dans un canevas classique de films à suspense tout en intensifiant l’ambiguïté par la mise en perspective de l’invisible. Le pitch : un couple en difficulté s’offre une escapade au bord de la mer pendant quelques jours, et le séjour va progressivement se transformer en cauchemar. Ainsi est né Long weekend, tentative intéressante de série B écolo où l’humain se confronte à une nature qu’il s’approprie à sa guise, jusqu’à en subir les terribles répercussions. Visiblement conscient de l’importance du non-dit dans la mise en place d’un mécanisme de terreur diffuse, Colin Eggleston privilégie une absence totale d’identification de la menace potentielle, alternant plans rapprochés (pour la captation de la terreur ou d’une éventuelle menace) et plans larges (pour la mise en espace de l’homme face à la nature), et captant, tout au long du récit, une succession de petits détails dont l’accumulation vire peu à peu au malaise.
Certaines références sont ainsi conviées au détour de quelques scènes (dont une qui rappelle étrangement Les oiseaux). On pourra évidemment tiquer devant un couple d’acteurs pas toujours à l’aise dans leurs rôles respectifs, ainsi qu’un grand nombre de maladresses dans la caractérisation de leurs personnages (par moments, ils sont si transparents qu’on peine à s’intéresser à leur sort), mais, dans sa volonté de concevoir un suspense dont l’origine s’avère insondable, le réalisateur s’en tire plutôt bien. A noter que, très récemment, on aura même eu droit à un remake modernisé avec Jim Caviezel, signé par un autre jeune réalisateur australien, Jamie Blanks (Insane, Urban legend). Une photocopie sans grande nouveauté, mais qui, par un casting autrement plus crédible et étoffé, doublé d’un travail remarquable sur la photographie (d’où la mise en valeur d’une nature aussi hostile que sauvage), en arrive presque à égaler l’original.
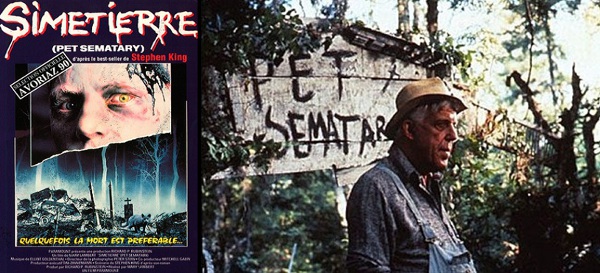
SIMETIERRE
Mary Lambert – Etats-Unis – 1989 – Carte blanche à Mad Movies
Premier film de la catégorie Carte blanche à Mad Movies de ce festival, Simetierre reste une œuvre-phare du genre horrifique. A l’origine de ce film, il y a bien sûr un roman aussi macabre que traumatisant, qui aura peuplé les nuits blanches d’un grand nombre de lecteurs sur toute la planète, le tout élaboré par un Stephen King au sommet de son talent. Sauf qu’entre King et le 7ème Art s’est souvent installée une étrange relation amour/haine, le bonhomme n’étant pas du genre à apprécier que les adaptations cinématographiques de ses pavés s’écartent un peu trop du matériau original. Ainsi donc, déçu par la relecture kubrickienne de Shining ainsi que par les échecs de Cujo et de Salem, Stephen King décida de superviser lui-même l’adaptation de Simetierre, d’une part en exigeant que son scénario soit suivi à la lettre, d’autre part en plaçant une réalisatrice malléable aux commandes du projet, Mary Lambert (le clip du sulfureux Like a prayer de Madonna, c’était elle).
Narrant comment une famille paisible, installée dans une maison construite à côté d’un ancien cimetière indien, se retrouve confrontée à la résurrection de tout être enterré dans ce cimetière, le film mérite clairement sa réputation de film terrifiant et dérangeant : en privilégiant une approche adulte du surnaturel et en bâtissant entièrement sa narration sur la génération de peurs primales de plus en plus fortes, sans jamais oublier de jouer avec les attentes du spectateur, Mary Lambert conçoit un train fantôme de très haute volée, aux cadres et à la mise en scène parfaitement élaborés, et dont l’efficacité reste toujours aussi intacte plus de vingt ans après sa sortie en salles. Peu de temps après l’énorme succès du film, Mary Lambert en profita pour bricoler un Simetierre 2 de sinistre mémoire, peu avant de faire sombrer sa carrière dans l’anonymat général.

PANIC SUR FLORIDA BEACH
Joe Dante – Etats-Unis – 1993 – Théma « La bombe dans tous ses états »
Rares sont les films qui dégagent un tel amour du cinéma, un mélange des genres aussi maîtrisé, un point de vue aussi gonflé sur l’interconnexion entre le réel et la fiction, et surtout, un regard touchant sur le pouvoir de l’imagination face aux horreurs du monde. Tristement tombé dans l’oubli au cours des années suite à son énorme échec en salles, Panic sur Florida Beach s’apprête à revenir sur le devant de la scène grâce à une sortie en Blu-Ray (prévue en juin 2011). Une bonne occasion de redécouvrir ce très grand film culte signé Joe Dante, aujourd’hui paria à Hollywood suite aux bides successifs de Small Soldiers et des Looney Tunes passent à l’action. Une comédie jouissive qui prend place sur une petite ville de Floride, vivant sous la menace imminente d’une nouvelle guerre mondiale suite à l’affaire des missiles de Cuba, où un réalisateur de séries B horrifiques (incarné avec gourmandise par un John Goodman impérial) présente sa nouvelle production au jeune public, en y ajoutant quelques nouveautés censées rendre la séance plus… animée.
Les cinéphiles auront reconnu le clin d’œil complice envers le mythique William Castle, maître de la série B et inventeur des séances à attractions, auquel Joe Dante offre ici le plus beau des hommages. Film très mélancolique derrière son humour souvent dévastateur, Panic sur Florida Beach cristallise avec finesse les angoisses d’une société américaine de plus en plus paranoïaque et, en expédiant le politiquement correct dans les orties (ce qui rappelle la dimension corrosive que le cinéaste mettait déjà en place dans Gremlins), célèbre le pouvoir de l’art comme antidote à la paranoïa généralisée. Et surtout, à travers ses mises en abîme et ses audaces constantes (repérez bien Naomi Watts dans l’un de ses tous premiers rôles), le résultat finit même par avoir la dimension d’une vraie attraction qui fait retomber le spectateur en enfance. Surchargé en personnages attachants et en situations cocasses (lesquelles n’excluent pas d’autres niveaux de lecture), ce petit bijou de comédie subversive permit à Joe Dante de livrer son œuvre la plus personnelle. Peut-être même la plus aboutie, aussi…

CALIBRE 9
Jean-Christian Tassy – France – 2011 – Nouvelles visions
Depuis plusieurs années, un des excellents points du festival Hallucinations Collectives a toujours été de donner leur chance à des films en difficulté, sans distributeur ni système de production classique, conçus dans des conditions proches du cinéma-guérilla par de vrais passionnés non dénués d’idées et de talent. Le problème, c’est que trop souvent, les œuvres en question ne réussissent pas à acquérir une vraie réputation, si ce n’est au travers de quelques réseaux de fans hardcore. Et parfois, pire encore, les résultats ne sont clairement pas à la hauteur. En témoigne ce Calibre 9, incontestablement le film le plus décevant de ce festival, et témoin direct d’un véritable malentendu perdurant depuis quelque temps sur le cinéma de genre hexagonal.
Déjà, on pourra gueuler à nouveau contre cette façon de désincarner un film en se référant de façon trop forte au cinéma de genre américain, le film n’ayant au final aucune identité précise. Ensuite, en plus d’avoir la tronche de Jason Statham, l’acteur principal n’arrive jamais à crédibiliser son rôle de costard-cravate rebelle, téléguidé par un flingue abritant l’âme d’une pute décédée (!) et désormais poussé à nettoyer sa ville de toutes les pourritures politiques qui y règnent. Sur ce postulat digne d’un mauvais ersatz du carrément chtarbé Hyper tension, Jean-Christian Tassy ne manque certes pas d’idées visuelles, mais à force de rendre illisible chaque scène d’action, de structurer ses plans n’importe comment (le monteur et le chef opérateur étaient visiblement dopés à la Red Bull), d’enchaîner les dialogues poussifs et d’enfermer son récit dans une idéologie pseudo-anarchiste qui confine au grand n’importe quoi, le résultat fait peine à voir. Rien à sauver de cet actionner toulousain, si ce n’est un générique de début à la beauté graphique assez évidente.
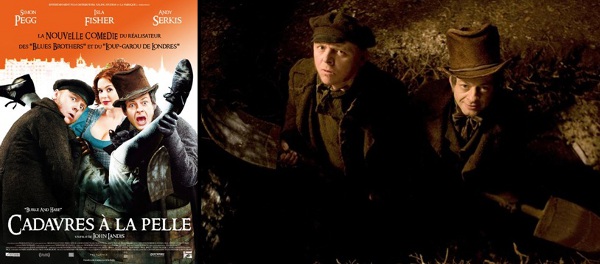
CADAVRES A LA PELLE
John Landis – Royaume-Uni – 2010 – Compétition officielle
Cela faisait un bon moment qu’on était sans nouvelles de John Landis, absent des écrans de cinéma depuis Susan a un plan et Blues Brothers 2000, qui remontaient tout de même à plus de douze ans. C’est donc avec une certaine curiosité qu’on le retrouve aujourd’hui avec ce qui s’annonçait comme le renouveau de la comédie macabre british. Rien que le casting suffit à mettre la bave aux lèvres : le grand Simon Pegg, l’acteur qui sait jouer Gollum ou Haddock sans montrer son vrai visage (Andy Serkis), la femme de Borat (Isla Fisher), quelques pointures du cinéma britannique (dont Tom Wilkinson) et une poignée de has been déterrés du cimetière (dont Tim Curry). Pourtant, si ce film constitue une sacrée déception au sein de ce festival, ce n’est pas vraiment le fait d’être littéralement hors sujet par rapport au reste de la sélection. Non, c’est surtout parce que le résultat s’avère plus proche du pitoyable remake de L’auberge rouge que du récent Sweeney Todd revisité par Tim Burton.
Malgré les efforts de ses acteurs qui semblent faire ce qu’ils peuvent pour ne pas sombrer dans la léthargie, impossible de s’intéresser ne serait-ce qu’une demi-seconde à cette intrigue d’escrocs qui, devenus tueurs par la force des choses, montent un commerce de cadavres destinés à servir de cobayes pour la médecine. Quelques références à l’Histoire surnagent de temps en temps (le film est inspiré d’une histoire vraie), mais il en faudrait bien plus ça pour ne pas voir dans cet échec l’équivalent d’un mauvais sketch des Nuls, sans l’ironie ni le côté régressif. Juste un film trop sage et trop plat qui ne fait jamais rire, voilà tout. Pour finir, ô suprême outrage, le scénariste a commis la bêtise de retranscrire à la lettre près la meilleure réplique de toute l’histoire du cinéma, délivrée par Robert Englund dans le foutraque 2001 Maniacs : « Un jour, j’ai fait confiance à un pet, et je me suis retrouvé couvert de merde ! ». Ne pas être capable d’arriver au niveau d’une vraie comédie macabre, c’est une chose, mais se chercher une légitimité en pompant des nanars débiles, c’en est une autre.

BALADA TRISTE DE TROMPETA
Alex de la Iglesia – France/Espagne – 2010 – Compétition officielle
Le retour aux sources n’est jamais une donnée acquise, et encore plus dans le cas des cinéastes acclamés au niveau planétaire pour leur style si particulier. Pour un cinéaste aussi culte qu’Alex de la Iglesia, c’était surtout l’occasion de revenir sur le devant de la scène après un film jugé trop impersonnel, Crimes à Oxford, enquête pseudo-hitchcockienne qui lui aura mis à dos une bonne partie de ses fans. Et au vu de la monstrueuse réputation que se traînait son nouveau long-métrage, de l’enthousiasme reçu dans divers festivals (Tarantino avait ardemment défendu le film à Venise) jusqu’à ses innombrables nominations aux Goyas, le pari semblait largement gagné d’avance. Aucune surprise : Balada Triste de Trompeta est une œuvre si énervée et exténuante qu’il est impossible d’en sortir indemne. Un monument absolu de comédie et de tristesse qui convoque tous les genres et fait passer son spectateur par tous les états possibles.
Synthèse hallucinante de toute l’œuvre du cinéaste espagnol, le film reprend l’argument de base d’un de ses précédents films (le cultissime Mort de rire, narrant déjà la rivalité entre deux artistes) pour livrer le portrait triste et décadent d’une société schizophrène. En choisissant d’intégrer l’univers du cirque pour enfants et de suivre l’affrontement de deux clowns pour l’amour d’une acrobate aux mœurs étranges, Alex de la Iglesia s’est aventuré sur un terrain que l’on devine très personnel, explorant la terreur du régime franquiste à travers une succession de scènes tétanisantes, donnant vie à des images empreintes de références aux contes enfantins et au surréalisme, et n’hésitant jamais à donner à ses deux clowns rivaux la dimension de deux êtres sans passé ni enfance, contraints de rester figés dans leur tristesse derrière un maquillage artificiel. A l’instar de Guillermo Del Toro avec Le Labyrinthe de Pan, le cinéaste convoque l’imaginaire comme seule porte de sortie aux horreurs du monde, mais va encore plus loin que son comparse en faisant preuve d’une tristesse absolue, de temps en temps étayée par quelques fulgurances décalées qui renforcent paradoxalement le pessimisme du récit. Des œuvres qui dégagent une telle liberté de ton et qui osent aborder la marche funèbre du monde sous un angle aussi unique, ça n’arrive qu’une fois tous les cinquante ans. Avec ses meilleurs films, Alex de la Iglesia tutoyait déjà les sommets. Désormais, il vole tel un faucon, avec la ferme assurance de ne jamais redescendre. Respect !
>>> Lire la critique complète du film

PERDITA DURANGO
Alex de la Iglesia – Espagne/Etats-Unis – 1997 – Séance de minuit
Pour compléter de façon parfaite l’avant-première de Balada triste de trompeta, le festival Hallucinations Collectives aura eu l’excellente idée de diffuser le cultissime Perdita Durango, sans doute le film le plus taré d’Alex de la Iglesia, présenté à (très) juste titre en séance de minuit durant le festival. Riche idée, puisque ce film, considéré un peu à tort comme une fausse suite de Sailor & Lula (l’héroïne apparaissait dans le film de Lynch, sous les traits d’Isabella Rossellini), se déguste comme une bonne téquila : avec du sel, du piment, du citron, des glaçons et pas mal de cojones ! Cocktail déjanté et imprévisible de sexe, de drogue, de violence, de polar, de western décalé, de sorcellerie et de clins d’œil cinéphiles, Perdita Durango est l’exemple-type du film mal élevé et très incorrect qui fonce pied au plancher sans jamais dévier de ses objectifs transgressifs.
Peu importe l’intrigue, narrant la fuite en avant d’un couple de tueurs kidnappant deux ados débiles pour en faire les victimes d’un rite sorcier, l’intérêt du film réside avant tout dans son jusqu’au boutisme, dans la démesure d’une mise en scène qui ose les scènes-chocs et les ruptures de ton sans jamais craindre les répercussions. Si l’on voulait schématiser, disons que le film donne l’impression de voir un film de Rob Zombie, mais où l’équipe technique aurait un peu trop forcé sur la téquila. Pour autant, le film n’est pas une totale réussite, le cinéaste ayant souvent trop de mal à canaliser son énergie et créant de temps à autre quelques trous narratifs très dispensables. De plus, aussi surexcités soient-ils, Rosie Perez et Javier Bardem peinent à rendre leurs personnages aussi jouissifs qu’on ne l’aurait souhaité, et il est parfois difficile de regarder le film autrement qu’à distance, sans réelle implication dans ce gros délire sur pellicule. Il n’empêche que, de sa scène d’ouverture aux allures de publicité Schweppes jusqu’à son final sacrément énervé, ce polar cartoonesque reste une vraie découverte pour tous les fans d’un cinoche hardcore et agité comme une bonne téquila au citron.

HOWARD, UNE NOUVELLE RACE DE HEROS
William Huyck – Etats-Unis – 1986 – Séance pour (grands) enfants
On ne sait pas trop quelle genre de drogue George Lucas avait fumé pour se lancer dans la production d’un nanar pareil, mais une chose est sûre : ça devait être de la bonne ! A l’instar de l’hilarant Hudson Hawk avec Bruce Willis, Howard prouve avant tout que les années 80 auront été un joyeux réservoir à portnawak, mais sans que leur singularité les pousse vers autre chose que la porte de sortie. Car si le film de William Huyck reste célèbre dans l’histoire du cinéma, c’est davantage pour avoir connu un bide assez considérable (lequel aura d’ailleurs conduit à l’endettement de Lucas) que pour son intérêt cinématographique, finalement très pauvre. Alors, le portnawak, c’est souvent chouette à regarder, mais si Howard ne l’est clairement pas, c’est parce qu’il n’est jamais réellement drôle. Trop sage pour être fou, trop enfantin pour assumer sa folie nanardesque, cette adaptation d’un comic-book de Marvel reste sans cesse le cul entre deux chaises, hésitant clairement entre le film pour enfants et le nanar assumé à destination d’un public plus âgé (on y pointe quelques références sexuelles). Et puis, à quoi bon une durée de deux heures si l’intrigue tourne souvent en rond pour rien ? Pour finir, entre une Léa Thompson assez fade et un Tim Robbins qui devait sûrement avoir des factures à payer, même le casting est à l’image du film : un peu à la ramasse.

LAST CARESS
François Gaillard & Christophe Robin – France – 2011 – Nouvelles visions
L’année dernière, le festival avait accueilli un premier film entièrement autoproduit, conçu par deux grands fans de giallo et élaboré avec un souci de l’esthétisme particulièrement prononcé. Ce petit film, intitulé Blackaria, avait fait un certain effet, révélant en François Gaillard et Christophe Robin une paire de jeunes cinéastes pour qui le style et les idées peuvent suffire à contrer les inconvénients d’un budget digne de la Soupe Populaire. Les revoilà de retour un an plus tard avec Last Caress, présenté ici dans sa copie de travail, et qui, heureuse surprise, ne laisse planer aucun doute sur les progrès qu’ils ont effectués durant cette année. Limitant son intrigue au cadre d’un château luxueux où une poignée de jeunes adultes sont menacés par un tueur à la recherche d’un mystérieux tableau, ce huis clos érotico-sanglant regorge de références au cinéma de Lucio Fulci et de Mario Bava, avec, comme pour Blackaria, une réelle propension pour le plan qui tue, le détail fétichiste, le gore brut de décoffrage et la sensorialité à toute épreuve (renforcée par la bande-son géniale de Double Dragon).
Bon, on ne va pas non plus jouer les hypocrites, l’autre qualité de Last Caress réside aussi dans la plastique affolante de ses jeunes actrices, et visuellement, la dimension érotique du résultat s’avère très émoustillante. Mais même si la gratuité pointe son nez, on sent toujours le bonheur de filmer du « beau », de créer un objet visuellement travaillé (certains cadres sont à tomber) et de vaincre les contraintes d’un budget lilliputien par une succession de fulgurances qui titillent les sens. On aura beau refaire les mêmes reproches qu’à Blackaria (références trop écrasantes, image DV un peu trop flashy, etc…), on mettra tout cela sur le compte de l’enthousiasme et d’un budget trop léger. De toute façon, au vu du potentiel artistique dont ils font preuve, nul doute que François Gaillard et Christophe Robin ont encore de beaux jours cinématographiques devant eux.

TUCKER & DALE FIGHTENT LE MAL
Eli Craig – Canada – 2011 – Compétition officielle
Au vu du pitch, on pouvait s’attendre à tout, mais certainement pas à ça. Sous son apparence de film d’horreur débile pour rednecks, le premier film du jeune réalisateur canadien Eli Craig est tout sauf un énième produit calibré pour fans de films d’horreur crétins. Beaucoup plus lucide et subtil qu’il ne le laisse paraître, Tucker & Dale fightent le Mal est surtout une pure comédie horrifique, peut-être même ce qui s’est fait de plus hilarant dans le genre depuis Zombieland et Shaun of the dead. Le genre de surprise qui fait l’effet d’une petite bombe, surtout quand, après un prologue assez insignifiant laissant craindre un sous-Vendredi 13 pour ados boutonneux, le réalisateur rentre dans le vif du sujet et se lâche dans une succession de morts hilarantes et de situations cocasses, lesquelles vont surtout prendre le contre-pied absolu du slasher traditionnel et opérer avec intelligence un virage à 80° par rapport aux clichés du genre.
Prenant place au sein d’une forêt des Appalaches, avec tout ce que cela suppose de rednecks inquiétants, de maisons abandonnées et de péquenauds se baladant la tronçonneuse à la main, le film suit la virée d’une bande d’ados californiens et stéréotypés, tous aussi cons les uns que les autres, qui, pris d’une paranoïa totale pour cet environnement stigmatisé par les rumeurs et les films d’horreur (quiconque a vu Délivrance ou Massacre à la tronçonneuse aura compris où je veux en venir), s’imagine que deux innocents bûcherons, rencontrés sur une station-service et venus passer leurs vacances dans une cabine au bord d’un étang, sont des tueurs en série sadiques. On ne grillera surtout pas tout ce qui suivra (histoire de conserver l’effet de surprise), mais sachez juste que vos zygomatiques vont êtres mis à très rude épreuve : en choisissant de brouiller les cartes en permanence et d’inverser les rôles sur l’opposition adolescents/rednecks, désormais globalisée par un nombre incalculable de films d’horreur (Détour mortel, Wolf Creek, Cabin fever et j’en passe…), Eli Craig s’éclate à pasticher les codes du genre sans jamais faire passer ses personnages pour des caricatures. En outre, les quiproquos et les méprises s’enchaînent à une telle vitesse que l’on finit presque par envisager le film comme une dérivation rigolote de la saga Destination finale. Et on le répète : c’est tellement fun et hilarant qu’il y a là-dedans de quoi redonner la patate à un mort !

PARENTS
Bob Balaban – Etats-Unis – 1989 – Cabinet des curiosités
Hormis pour les cinéphages bornés, le nom de Bob Balaban n’évoque pas forcément grand-chose au grand public. Pourtant, le bonhomme est à la fois un acteur reconnu (Alice, Rencontres du troisième type), doublé d’un producteur souvent très inspiré (on lui doit l’excellent Gosford Park de Robert Altman). Seule sa carrière de réalisateur n’est, en revanche, pas encore très connue, et au vu de ce film culte quasiment oublié de tous, c’est plutôt regrettable. Sorte de Blue velvet pour enfants, Parents explore la paranoïa d’un jeune enfant quasi autiste pour ses parents, qu’il soupçonne de dissimuler un terrible secret derrière leur apparence de couple charmant et exemplaire. Avec un tel postulat, il était évident que Balaban allait s’attaquer à un démontage en règle du mythe galvanisé de l’american way of life, doublé d’un pur film de terreur autopsiant le mythe de la famille américaine pour le pervertir de l’intérieur. Qu’on se rassure, c’est le cas, et c’est finalement un peu plus que cela. Par analogie, osons dire que Parents serait presque le pendant horrifique d’un film de Douglas Sirk, où le monde normatif et idéal conditionné par l’Amérique yankee deviendrait, sous le regard d’un enfant solitaire, le théâtre d’une horreur souterraine.
La force du film est d’être constamment sur le fil du rasoir entre clarté et incertitude, créant la peur par de simples décadrages et des mouvements à la lenteur millimétrée, jusqu’à donner au réel la dimension d’un étrange cauchemar. Si certaines scènes créent une angoisse assez impressionnante, c’est finalement l’ambiguïté du récit (hormis lors d’un final clairement décevant) qui accroit la réussite du film, aidée en cela par la partition d’Angelo Badalamenti qui donne au film une dimension lynchienne assez bienvenue. Côté casting, si Randy Quaid et Mary Beth Hurt assurent avec brio leurs rôles de parents diaboliquement ambigus, il est hallucinant de constater à quel point le jeune Bryan Madorsky arrive, de façon incompréhensible, à passer de la peur à la tristesse sans jamais réellement modifier ses expressions faciales, surpassant du même coup ce que Haley Joel Osment avait su incarner dans Sixième sens. Acclamée lors de sa présentation au festival d’Avoriaz en 1989 (où il remporta le prix de la critique), voici une perle méconnue du genre, dont l’invisibilité durant toutes ces années apparait comme une injustice terrible.

THE ADVOCATE FOR FAGDOM
Angélique Bosio – France – 2011 – Documentaire
Qui est réellement Bruce LaBruce ? Un punk absolu ? Un anarchiste de droite ? Un artiste libéral et révolutionnaire ? Ou un simple acteur porno gay à la démarche provocatrice ? Contre toute attente, et malgré la somme assez hallucinante de témoignages recueillis par la réalisatrice Angélique Bosio pendant un an, ce documentaire ne prétend pas apporter de réponse définitive. L’accumulation de points de vue (John Waters, Harmony Korine, Richard Kern, Gus Van Sant et bien d’autres) développe ici diverses pistes captivantes sans imposer de vérité absolue. On sent en permanence une vraie contestation dans les dires et les actes de cet artiste controversé, capable de citer aussi bien Jean Genêt que Jean-Luc Godard dès qu’il s’agit d’établir un lien entre sexe et politique, la motivation de LaBruce pour faire du porno étant purement politique. Forcément, le documentaire n’hésite pas à étayer sa réflexion sur le mouvement gay en y ajoutant quelques extraits particulièrement crus (surtout des films très sexués réalisés par LaBruce lui-même, dont le cultissime Hustler white) et de rares images d’archives sur le mouvement « queer », mais la démarche de sa réalisatrice serait plutôt de capter l’âme d’un artiste en guerre souterraine contre la société, prêt à défendre une idée pour ensuite la contredire dès qu’elle commence à s’institutionnaliser. A bien des égards, on pourrait pratiquement y voir un vrai manifeste de la pensée punk, même si l’ensemble manque parfois de structure et d’argumentation dans les propos.

J’AI RENCONTRÉ LE DIABLE
Kim Jee-woon – Corée du Sud – 2010 – Compétition officielle
Cela fait toujours assez con de débuter une critique par un avertissement, mais comme la projection sur grand écran du dernier Kim Jee-woon n’est pas du genre à nous faire sortir de la salle sans avoir subi quelques dommages collatéraux, autant y aller franco : cet authentique uppercut sur pellicule est à déconseiller fermement aux âmes sensibles, et à l’inverse, renferme en son sein tous les ingrédients nécessaires pour procurer une jouissance totale chez les spectateurs les plus téméraires. Revenge-movie nihiliste et extrême dans tous les sens du terme, J’ai rencontré le diable prétexte d’un canevas de vigilante classique (un flic poursuit un serial-killer, responsable du meurtre de sa femme) pour livrer une autopsie radicale et tétanisante d’un monde moderne aussi triste que pourri de l’intérieur, avec le même regard désespéré et la même crudité graphique que chez des cinéastes comme Soi Chaeng ou Park Chan-wook.
Aucune morale ne prend place dans ce thriller sec comme un coup de boule, où les deux monstres sacrés du cinéma sud-coréen (Lee Byung-hun et Choi Min-sik, tous deux au-delà des superlatifs) s’affrontent dans une succession de scènes-chocs, souvent d’une ultraviolence insensée, le tout filmé et mis en scène avec une maestria digne des plus grands. Usant d’une immersion totale, étirant son récit minimaliste comme un élastique pour le lâcher toujours au bon moment, alternant les moments de calme et de fureur au sein d’une atmosphère lugubre à souhait, J’ai rencontré le diable s’impose, aux côtés du terrifiant Bedevilled, comme l’une des rares œuvres en provenance du pays du Matin Calme capables de siffler autant le chaud que le froid durant toute la projection. Avec, ici, un supplément en or : la joie de savourer des instants de violence inouïs comme la sensation d’avoir atterri sur le terrain de chasse d’un cinglé. Comme si le cinéaste, démiurge démoniaque tordant les fils des pantins qu’il prend plaisir à manipuler, jouait avec nos nerfs dans le seul but de nous faire vivre littéralement l’enfer. En sortant de la salle, on a encore la marque de la baffe.
>>> Lire la critique complète du film
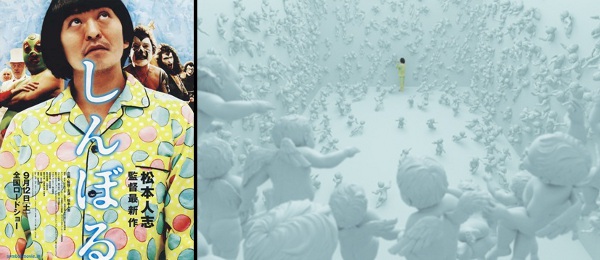
SYMBOL
Hitoshi Matsumoto – Japon – 2010 – Compétition officielle
L’ovni du festival ! En regardant les extraits, on ne savait clairement pas à quoi s’attendre. En sortant de la projection, c’est encore pire : qu’est-ce que c’est que ce film ?!? En fait, la sensibilité artistique de Hitoshi Matsumoto, considéré au Japon comme l’égal de Takeshi Kitano (à savoir un réalisateur doublé d’une star de la télévision nippone) et clairement influencé par la culture geek (bandes dessinées, comics, poésie, jeux vidéos…), est directement liée au programme ubuesque proposé par Symbol, deuxième long-métrage du bonhomme après l’inédit Big Man Japan. Inutile de raconter le pitch, déjà parce que tout le film repose sur l’effet de surprise, enfin parce que ce serait une vraie tannée de prétendre avoir compris quoi que ce soit à l’intrigue. Pour faire simple, disons qu’un type en pyjama se réveille dans une pièce fermée et vide, aux parois lisses et blanches, dont les murs sont ornés de plusieurs protubérances phalliques. Et pendant ce temps, au Mexique, tandis que les enfants partent à l’école, un catcheur masqué, épaulé par une nonne sexy, s’apprête à affronter son nouvel adversaire dans une salle pleine à craquer… Voilà.
Très éloigné d’un objet nonsensique gorgé de mises en abyme pirandelliennes (à l’instar du génial Rubber de Quentin Dupieux), Symbol est avant tout une œuvre ludique qui prend son temps pour dérouler en parallèle deux intrigues n’ayant strictement aucun rapport l’une avec l’autre. L’univers du film, à la fois farfelu et poétique, se déploie comme une toile de Magritte, avec une succession assez jouissive de moments surréalistes (quoiqu’un peu trop répétés) et un symbolisme qui, derrière un hermétisme apparent, devient très vite la clé du propos. Dès que son héros tente de s’enfuir de son huis clos blanc en usant de tout ce qui se trouve à sa portée, Hitoshi Matsumoto illustre de façon astucieuse le concept du jeu vidéo (surtout ceux de type « point & click ») en y mêlant un imaginaire proche de la bande dessinée japonaise pour enfants, jusqu’à une chute assez gonflée rappelant le final du 2001 de Kubrick. Le spectre du film arty a beau pointer trop souvent son nez, on reconnaîtra que l’inventivité et la fraîcheur de l’ensemble suffisent à créer un léger sentiment de confort pour le spectateur. Parfois très drôle, souvent très vain, Symbol est une curiosité à réserver aux amateurs de bizarreries filmiques.

HEARTLESS
Philip Ridley – Royaume-Uni – 2009 – Compétition officielle
Philip Ridley n’est pas ce que l’on peut appeler un cinéaste pressé : avec à peine trois films en trente ans, on pourrait carrément voir en lui un nouveau Terrence Malick. Son retour en force s’est fait très récemment avec Heartless, déjà projeté dans divers festivals où il aura fait sensation, mais qui, égaré entre l’horreur faustienne et le drame social, ne sait pas toujours sur quel pied danser. Sur de nombreux aspects, cette sombre relecture du mythe de Faust, adaptée à un jeune photographe désireux d’accéder à la beauté parfaite afin de pouvoir rencontrer l’amour, ne manquera même pas de renouer avec le spectre d’un film comme Donnie Darko, déjà insurpassable pour capter la mélancolie adolescente au sein d’un univers égaré entre une réalité peu reluisante et une flopée de références branchées. Ici, Ridley ne roule pourtant pas sur la même route que Richard Kelly : l’univers de son film est sombre, inquiétant, peuplé de personnages inquiétants et de délinquants à visages de monstres qui tuent sans aucune forme de morale. Un contexte dans lequel son héros, véritable gueule d’ange dont la tâche de naissance en aura finalement fait le prototype du freak mal dans sa peau, évolue en quête d’un espoir quasi impossible. Mais lorsque le Diable surgit avec une offre alléchante, la tentation est trop forte…
Tout le problème de Heartless découle de ce moment-clé du récit : dès l’instant où le héros (excellent Jim Sturgess) accepte de retrouver une apparence normale en échange d’un terrible sacrifice, le film hésite clairement entre le film de genre stricto sensu (lequel use des artifices visuels sans ménagement) et l’introspection maladive (où tout est censé fonctionner sur la retenue). A tout casser, les instants intimistes entre le héros et son entourage suffisaient largement pour capter le mal-être d’un adolescent en quête d’absolu, et du coup, le mixage avec des symboles assez incongrus (que vient faire cette gamine indienne dans cet univers british délabré ?) et une imagerie gothique à la The Crow ne fonctionne clairement pas. Et lorsque tombent une paire de flashbacks bouleversants, lesquels achèvent de rendre le film totalement limpide, on se rend compte qu’on l’avait vu venir à des kilomètres, le film étant à l’arrivée très prévisible et convenu. Reste une mise en images soignée, un casting parfait, une ambiance souvent flippante, et surtout, une magnifique bande-son qui renforce l’émotion de certaines scènes. A ce titre, Heartless mérite largement le détour.

2019 APRES LA CHUTE DE NEW-YORK
Sergio Martino – Italie – 1983 – Théma « La bombe dans tous ses états »
Aaaah, qu’il était bon de vivre dans les années 80 ! Déjà parce que le cinéma n’était pas encore synonyme de fainéantise pour la plupart des producteurs (enfin, pas tous…), ensuite parce qu’il était encore possible d’aller voir en salles des films fabriqués pour quasiment moins cher que le prix du ticket. En témoigne une flopée de bouses à la cool, commises par de grands maîtres italiens comme Bruno Mattei ou Sergio Martino, lesquels n’auront eu de cesse de toucher à tous les genres, de manger à tous les râteliers, pourvu que ça puisse surfer sur le succès des films américains et que ça prenne l’allure d’un gros milkshake pas cher. 2019 après la chute de New York fait clairement partie de cette catégorie : pour faire court, ça reprend le scénario de New York 1997, ça pompe l’imagerie punk de Mad Max 2 (en 100 fois plus cheap, cela va s’en dire), ça recycle quelques empreints à La planète des singes ou Death Race 2000, et au final, on filme tout ce gros bazar avec un budget équivalent à la recette quotidienne d’une prostituée ridée de 70 balais.
Autant dire qu’avec un tel nanar, Sergio Martino a fait les grands plats dans les petits pour que le résultat suscite un fou rire souvent incontrôlable : des nains très gentils, des hommes-singes qui veulent assurer leur descendance, un acteur principal au look de mannequin slip-et-chaussette pour catalogue La Redoute, un tableau de Picasso à côté du bureau d’un dictateur débile, une Barbie Dominatrice en guise de méchante, le dernier espoir de l’humanité (une femme à poil, donc) retenu en sécurité dans un sarcophage en verre inviolable (en fait, on fait glisser la vitre, et hop, ça s’ouvre !), des costumes trouvés sur le bord d’une autoroute, des scènes d’action encore plus cheap qu’un numéro de cirque, du modélisme miniature en guise de décors post-apocalyptiques (avec quelques coups de fumigène pour faire croire que tout a cramé), des miliciens de carnaval qui galopent sur des chevaux avec leurs panoplies ridicules, et surtout, comme souvent dans ce genre de film, la grosse réplique qui tue (« Est-ce mal d’être un nain ? »). En définitive, inutile de chercher le premier degré devant un spectacle aussi con, mais vu que l’action ne s’arrête jamais, on ne s’ennuie pas. Quasiment nul, mais tout de même assez drôle : du bis italien, quoi !

INSIDIOUS
James Wan – Etats-Unis – 2010 – Séance de clôture
Les réactions terrifiées des spectateurs dans la plupart des festivals récents étaient bel et bien fondées. Autant être direct dès le départ : Insidious s’impose comme le film le plus flippant de l’année. En s’attaquant au schéma balisé de la ghost-story à la japonaise (mais sans gamine aux cheveux longs, ça change !), James Wan réussit l’exploit d’en redynamiser la forme, d’en redéfinir les contours, d’en retravailler les codes tout en conservant un schéma narratif on ne peut plus classique (une famille emménage dans une baraque d’où surgissent des bruits de plus en plus terrifiants), et tout ceci avec une faculté d’immersion rarement ressentie depuis le Darkness de Jaume Balaguero. Peu importe l’intrigue, déjà vue en mieux dans une trentaine de films similaires. Peu importe le casting, assez fade malgré la présence d’acteurs hollywoodiens rodés (Patrick Wilson et Rose Byrne). Et peu importe les ficelles dramatiques, élaborées une fois de plus autour d’un mystère familial qui s’avèrera finalement être à l’origine des terribles phénomènes qui vont se déclencher pendant 90 minutes de pure terreur.
Comme il l’avait démontré avec Death sentence, James Wan aura su se démarquer de la saga Saw (dont il fut l’initiateur) afin de soigner davantage sa mise en scène, quitte à expérimenter de nombreuses techniques de filmage, comme en témoignait l’incroyable poursuite en plan-séquence de son précédent film. Pour cette fois, sans doute limité par le cadre exigu d’une maison de banlieue, il s’agissait pour lui d’élaborer de nouvelles idées de filmage. La réussite d’Insidious provient entièrement de ce détail : une caméra qui colle à ses personnages afin de capter leurs angoisses et leurs sentiments, de longs travellings qui accentuent l’angoisse en même temps qu’elles prennent le point de vue d’un témoin invisible, une ambiance nocturne qui doit tout à un savant mélange de suggestion et de variations ombres/lumières. Même lorsqu’il s’agit de créer le sursaut par de simples jump-scares, l’effet fonctionne terriblement parce que Wan se plait également à jouer sur les échelles de plans, rendant la menace présente dans chaque coin du cadre et renouant avec une forme d’angoisse directement liée à nos peurs les plus primales. De la première à la dernière seconde, la séance de flippe est intense, insidieuse, insoutenable. Pour finir le festival sur une grosse impression, on n’en espérait pas tant.

8 Comments
Je n'ai vu que The Loved Ones et Insidious jusqu'à présent.
Le premier est une très bonne surprise, inventif et jouissif, porté par des acteurs talentueux
Quant au deuxième, c'est un vrai coup de coeur, j'aurais rarement autant flippé devant mon écran. C'est peut-être classique, mais qu'est-ce que c'est bien fait (on ne ressent jamais la maigreur du budget). Voilà le vrai paranormal activity!
Petite correction, Last Cares a été shooté en HD via l'appareil photo Canon5D et non en DV.
Donc si le grain fait vraiment pensé à celui de Blackaria, ce n'es pas cette fois dans un bute de "cache misère" (ce qui avait quand même du charme) mais bel et bien une vrai intention artistique.
Sinon je d'accord avec tout ce qui a été écrit, mais je trouve juste dommage de ne pas avoir parler des courts métrages ni de l'ambiance du festival (la fréquentation par exemple, même si l'on s'éloigne de coté critique et analyse).
@Quentin :
C'est vrai que la qualité de l'image faisait énormément penser à BLACKARIA. Cela dit, avec l'appareil Canon5D, on a eu quand même RUBBER, qui était quand même sacrément beau visuellement. Dans LAST CARESS, j'ai pas du tout eu l'impression que c'était fait avec cet appareil, mais si tu le dis, je te crois volontiers.
Puis l'étalonnage n'as pas été totalement finalisé dans la version présenté donc à voir en DVD (pis on peut aussi dire qu'en terme de réal, par rapport à Rubber, c'est pas vraiment la même court)
Oser traiter 2019 de nanard… c'est louable pour une chair innocente, mais ce serait dénigrer tout le savoir-faire (très artisanale certes) d'une équipe soudée et expérimentée (c'est ça le bis rital). La preuve: même si le scénario et littéralement pompé sur N-Y 97, la plupart du reste n'est pas à balancer à la poubelle. Sous leurs costumes complètement cheap, les acteurs s'en sortent très bien; les décors en cartons rendent plutôt bien à l'écran (merci à Giancarlo Ferrando!); tu l'as dit, on s'emmerde vraiment pas, preuve de la qualité du montage et même du scénario (même si Gastaldi nous a habitué à mieux -> Mon nom est Personne, ou Torso, entre autres). Bref, au final, sous couvert d'un univers cheapesque, vous le prenez comme un nanard, mais vous vous trompez, et c'est bien dommage. C'est une question de charme et de saveur, on l'aime pour ses petits défauts, mais il faut au moins respecter ces artisans!
@Lynch971 :
Quand je parle de "nanar", ce n'est pas forcément péjoratif, la preuve étant que j'ai bien rigolé pendant le film et que, comme tu l'as remarqué, je ne me suis pas ennuyé une seconde. Après, contrairement à toi, je n'irai pas jusqu'à dire que le montage et le scénario sont plein de qualités (le premier est parfois assez aléatoire, le second est plein de pompages en tous genres), mais on sait ce que l'on va voir en dégustant un film comme 2019, et certaines choses sont parfois à hurler de rire. A titre de comparatif, je préfère infiniment un VIRUS CANNIBALE signé Bruno Mattei ou le DOOMSDAY de Neil Marshall : le premier est peut-être le summum du nanar gore hilarant, et le second est infiniment mieux soigné que 2019 (dont il reprend pas mal d'idées et de détails scénaristiques).
"Hitoshi Matsumoto, considéré au Japon comme l’égal de Takeshi Kitano". Pas du tout. Ils boxent carrément dans deux catégories différentes, Matsumoto n'est absolument pas considéré comme l'égal de Kitano. Sinon dommage que vous n'ayez pas accroché à SYMBOL. Moi j'ai bien aimé.