

Composition du jury
– Bruno Forzani, réalisateur français (Amer, L’étrange couleur des larmes de ton corps)
– Gérard Kikoïne, réalisateur et monteur français (Parties fines, Dr Jekyll & Mr Hyde…)
– Christophe Lemaire, journaliste, défenseur incontournable du cinéma bis.
– Frédérick Raynal, concepteur de jeux vidéos (Alone in the dark, Little Big Aventure…)
Compétition Longs-métrages (le vainqueur est indiqué en bleu) :
– Citadel (Ciaran Foy)
– El Cuerpo (Oriol Paulo)
– The Land of Hope (Sono Sion)
– Berberian Sound Studio (Peter Strickland)
– The Collection (Marcus Dunstan)
– Home Sweet Home (David Morley)
– Modus Anomali (Joko Anwar)
Compétition Courts-métrages (le vainqueur est indiqué en bleu) :
– Un monde meilleur (Sacha Feiner)
– Suicide Manual (Lee Seung-hyuk)
– Lonely Bones (Rosto)
– Record/Play (Jesse Atlas)
– Hotel (José Luis Aleman)
– Who is Avid Pekon (Patrik Eriksson)
– Men of the Earth (Andrew Kavanagh)
– Plug & Play (Michael Frei)
Evènements cinématographiques
– La présence des réalisateurs Ciaran Foy et David Morley, venus présenter leurs films respectifs.
– La présence du réalisateur Nicolas Boukhrief, venu présenter les trois films consacrés à sa Carte Blanche, ainsi que le controversé Assassin(s) lors d’une séance-débat.
– La thématique « Blancs, sales et méchants », constituée de trois films.
– La thématique « Evanescente innocence », constituée de trois films.
– L’hommage rendu au cinéaste italien Michele Soavi, avec la projection de deux de ses films.
– Le Cabinet des curiosités, avec la projection de quatre films aussi cultes que méconnus.
– La séance de minuit, avec Henry : Portrait of a serial-killer de John McNaughton.
Autres évènements
– Le lancement de la 4ème Jam de la Game Dev Party, placée sous le signe du cinéma et destinée à la création de jeux vidéos indépendants, par équipe, sur une période de 48 heures.
– Les deux conférences « Histoire du jeu vidéo » et « Jeu vidéo & Cinéma », respectivement menées par Douglas Alves et Alexis Blanchet.
– La projection inédite de Macon County Line, suivie d’une conférence avec Maxime Lachaud, essayiste et journaliste français, spécialiste de la culture white trash.
– La lecture de textes tirés de l’œuvre du romancier Harry Crews, figure centrale de la culture white trash.
– La table ronde sur le phénomène white trash (débat animé par Alban Jamin, enseignant en études cinématographiques).
– Le concert Hallucinations Auditives, avec Lucio Bukowski.
– L’exposition Blancs, sales et méchants, constituée de travaux de sept artistes internationaux.
Un très grand bravo à…
– Cyril « El Maestro » Despontin, véritable Grand Manitou du festival, pour avoir animé l’ensemble des manifestations et les projections de films avec autant d’humour, de passion et d’enthousiasme.
– Fausto Fasulo, Eric Peretti et Nicolas Boukhrief pour leurs excellentes présentations de la plupart des films présentés durant le festival.
– Toute l’équipe des bénévoles de l’association ZoneBis, pour leur implication et leur disponibilité.
– Toute l’équipe du cinéma Comoedia de Lyon, pour avoir permis d’organiser les projections dans les meilleures conditions possibles.
Compétition longs-métrages

CITADEL
Ciaran Foy – Irlande – 2012 – Séance d’ouverture + Compétition officielle
Déjà présenté hors compétition au dernier festival de Gérardmer, ce premier long-métrage d’un jeune réalisateur irlandais nommé Ciaran Foy n’était pas à proprement parler celui que l’on attendait le plus. Malgré tout, la présence en séance d’ouverture d’un tel film sur lequel on ne savait pratiquement rien, doublé d’une affiche aussi intrigante que les quelques extraits visionnés ici et là sur la toile, suffisait amplement à aiguiser notre curiosité. Hélas, en dépit de qualités de fabrication indéniables, le résultat se révèle à des kilomètres de la supposée œuvre coup de poing, susceptible de malmener son spectateur pour une durée indéterminée. On le regrette d’autant plus que Citadel se révèle être contre toute attente une œuvre très personnelle, dans laquelle un violent incident, vécu par le réalisateur lui-même, sert de point de départ à une plongée sans oxygène dans un enfer urbain angoissant. Le pitch est simple comme bonjour : un jeune père de famille, rendu agoraphobe suite à l’agression de sa femme par une bande d’enfants mystérieux et ultraviolents, se confronte à son tour à ces mêmes agresseurs, visiblement déterminés à lui ravir sa progéniture par tous les moyens possibles.
Si le cadre urbain menaçant et l’idée des enfants tueurs peuvent évoquer aussi bien Heartless de Philip Ridley que Chromosome 3 de David Cronenberg, la référence qui frappe d’emblée durant toute la première moitié du film serait davantage celle de Roman Polanski (période Répulsion), ne serait-ce que pour l’idée de suivre un personnage malade et triste, réfugié dans un petit appartement à l’abri du monde extérieur et craignant la moindre petite intrusion. Une fausse alerte, en réalité : si le réalisateur réussit d’abord plutôt bien à développer une atmosphère stressante et à retranscrire la sensation d’agoraphobie par un travail assez bluffant sur la lumière et le son, il peine à l’amener vers un niveau de lecture plus symbolique qui aurait pu en décupler l’impact psychologique, où la menace intrusive n’aurait été qu’une vue de l’esprit résultant d’un profond traumatisme. A vrai dire, on s’aperçoit même que l’objectif n’était pas là : dès l’arrivée d’un prêtre nerveux, le film supprime le moindre trouble au profit d’un didactisme exaspérant, justifie l’existence de la menace par un sous-texte sociopolitique à deux balles (pour résumer, ces enfants tueurs sont des « démons » qu’il faut éliminer à tout prix) et bâcle ses enjeux dramatiques par un message convenu que l’on croirait extrait d’un mauvais épisode de Chair de poule (en gros, contrôle-toi pour mieux te libérer de tes peurs). Tout ça pour ça ? Oui. Sans compter que le travail sur le sound-design ne sert qu’à installer une succession de jump-scares qui, à la longue, finissent par ne plus susciter le moindre frisson. Forcément, ce n’est jamais très agréable de démarrer un festival sur une grosse déception, mais hélas, c’est la règle du jeu.

EL CUERPO (THE BODY)
Oriol Paulo – Espagne – 2012 – Compétition officielle
Histoire de rester le plus respectueux possible vis à vis des spectateurs qui vont prochainement le découvrir, il serait judicieux de ne rien dire à propos de The Body si ce n’est le traditionnel message de promo : ne lisez rien sur le film, ne regardez pas le trailer, le film est excellent, nos amis ibériques restent les champions du genre, faites-nous confiance, allez-y les yeux fermés, etc… Hélas, festival et avant-première oblige, on va devoir se forcer. Du coup, si vous n’avez pas encore vu le film, soyez prévenus que la suite de ce paragraphe va entrer un peu plus en détail dans son contenu scénaristique… Vous êtes toujours là ? Scénariste des Yeux de Julia (où officiait déjà la sublime actrice Belen Rueda), Oriol Paulo signe avec The Body un premier long-métrage une fois de plus sous influence européenne, que ce soit la filmo de Clouzot pour l’idée d’un mystère narratif prenant finalement le spectateur à revers ou la période britannique d’Hitchcock pour son goût d’un suspense distillé à toutes petites gouttes tout au long d’un récit diabolique. Comme le suggère le titre, tout part d’un corps, celui d’une riche femme d’affaires, dirigeante d’un groupe pharmaceutique décédée d’un infarctus brutal. Lorsque son cadavre disparait de la morgue quelques heures seulement après son décès, une enquête est ouverte, amenant un inspecteur de police coriace à soupçonner le jeune époux de celle-ci. Que se passe-t-il ? On n’en dira pas plus, trop soucieux de laisser au spectateur le soin de vivre les surprises incessantes qui jalonnent les 107 minutes du récit. On se contentera de préciser que le scénario, charpenté de main de maître, alterne en permanence les révélations d’indices avec une efficace série de flashbacks qui font mine d’éclairer le récit pour mieux en révéler au final toute la perversité sous-jacente. D’une rare élégance formelle, la mise en scène joue à merveille de ses cadres et de ses mouvements de caméra pour placer son audience dans une position équivalente à celle du protagoniste, jeune époux ambigu dont la culpabilité n’a de cesse que de se renforcer au fil des scènes. Jusqu’à un ultime coup de théâtre, aussi diabolique qu’imprévisible, qui achève en beauté le jeu de pistes. Certes, dans l’ensemble, The Body ne va pas plus loin qu’un exercice de manipulation unilatérale, mais dans sa facture et dans la limite de ses ambitions, il pourrait bien devenir une référence dans les années à venir.

THE LAND OF HOPE
Sono Sion – Japon – 2012 – Compétition officielle
Cinéaste underground par excellence, Sono Sion est surtout l’un des plus énigmatiques du Japon, distillant au travers de films ancrés dans des genres multiples de fortes réflexions sur le mal-être adolescent (Suicide Club) ou la quête de l’égarement (Guilty of romance), sans pour autant délaisser la dimension énervée, voire extrême, de ses récits. Si l’on ajoute à cela le fait qu’il tourne désormais plus vite que l’éclair depuis une bonne dizaine d’années, détrônant au passage le stakhanoviste Takashi Miike sur ce point, on peut même y voir l’un des plus beaux étendards du cinéma japonais contemporain. Reste que lorsque l’on évoque la carrière de Sion, on oublie parfois de citer son implication particulièrement forte au sein du collectif artistique Tokyo GaGaGa, dont la plupart des manifestations consistaient à réciter des poèmes sur le spleen en pleine rue (pour la petite histoire, Jean-Jacques Beineix en avait filmé un extrait pour son documentaire Otaku). Derrière la vitrine de l’hystérie et de la colère réside une émotion à fleur de peau : la démarche punk de Sion pourrait donc se résumer à cela. Du coup, le voir s’attaquer à la tragédie post-Fukushima ne surprend qu’à moitié. Le résultat, lui, déroute à plus d’un titre. On y suit la vie d’une famille unie autour de son patriarche vieillissant, au cœur d’un petit village proche d’une centrale nucléaire. Lorsqu’un violent tremblement de terre se manifeste suite à l’explosion de celle-ci, les autorités déclenchent l’alerte et, afin de limiter le danger de radioactivité, tracent un périmètre de sécurité qui coupe le village en deux. Une scission qui s’impose aussi au sein de la famille : les parents âgés décident de rester au domicile, tandis que leur fils et son épouse décident à contrecœur d’être évacués.
Cette séparation, Sono Sion parvient ici à l’incarner en une belle métaphore visuelle : des pieux qui, utilisés par les autorités pour créer une ligne de sécurité, annoncent déjà la frontière qui séparera les individus jusqu’à leur faire ressentir le difficile poids de l’exode (lequel se traduit aussi au cœur de la bande-son). Le problème, c’est qu’elle tend aussi à scinder le film lui-même en deux ou trois sous-intrigues qui, une fois réparties à des endroits géographiques différents, ne s’équilibrent presque pas : en passant d’une histoire à l’autre sans accorder le moindre équilibre de durée sur l’une ou sur l’autre, le récit a tendance à virer au brouillon au point que le sujet du film finisse par échapper au spectateur. Pour ne rien arranger, si Sion est souvent réputé pour faire des films très longs, les 133 minutes de celui-ci ne rendent pas justice aux émotions suscitées par le récit, alourdissant chaque dialogue par des détails superflus et étirant parfois le temps sans réelle justification (il aurait fallu couper une demi-heure de métrage). On a beau sentir chez le réalisateur son envie de créer une réflexion sur le statut du nucléaire (danger réel ou sécurité hypothétique ?), de remettre en question le choix cornélien de l’exode dans une situation d’alerte ou de construire un récit entièrement guidé par les émotions de ses personnages, il rame sur les trois tableaux par manque de rigueur. Pour autant, les décors apocalyptiques du Japon sont hallucinants de beauté, la musique épouse les vibrations des êtres (malgré quelques petits excès dans les violons) et certaines idées visuelles ne manquent pas de puissance symbolique (dont l’arbre entouré de fleurs, symbole d’un idéal bientôt condamné à finir en cendres). Tout cela suffit amplement à rendre The Land of Hope beau et poignant, mais de la part d’un cinéaste aussi audacieux que Sono Sion, il est clair qu’on en attendait plus.

BERBERIAN SOUND STUDIO
Peter Strickland – Royaume-Uni – 2012 – Compétition officielle
Au centre de cette compétition jalonnée d’œuvres plus ou moins méconnues, il s’agissait sans aucun doute du film le plus attendu du festival, ne serait-ce qu’au regard de son concept et de ses promesses d’une expérience sensorielle de très haute volée. A l’arrivée, malgré un Prix remporté sans grande surprise en bout de course, la déception fut considérable. Le problème est toujours le même, à vrai dire, dans ce genre de film-concept : explorer une idée prometteuse n’implique pas forcément que celle-ci va tenir le coup sur une heure et demie de métrage. Ici, c’est donc le son qui constitue l’élément pivot de la narration, à travers l’histoire de cet ingénieur du son anglais (joué par Toby Jones, aperçu dans La Taupe) débarquant en Italie afin de superviser le mixage sonore du dernier giallo d’un réalisateur italien. Ce film, nommé The Equestrian Vortex, on ne le verra jamais à l’écran, si ce n’est au détour d’un générique expérimental qui remplace celui du film que nous voyons. Aucune image ne filtrera. Seuls des bribes d’informations surgiront au détour d’une voix sur le contenu narratif des séquences, mais c’est tout. Ce qui intéresse le réalisateur n’est donc pas tant le film en soi que les éléments qui composent la bande sonore : une pastèque que l’on découpe pour illustrer une décapitation, une courge que l’on jette au sol pour refléter une tête éclatée, les mains qui s’agitent dans un aquarium pour retranscrire un effet de noyade, les doublures-cri qui hurlent dans une cabine de postproduction, le jeu sur les variations de bruitage effectuées par le héros depuis la table de montage, etc… Tout cela sous les yeux d’un ingénieur du son angoissé par l’idée de travailler sur un film d’horreur, et voyant peu à peu son travail prendre une tournure très étrange.
Le but de tout cela n’est pas de révéler vulgairement la façon dont un film va prendre vie grâce au son, mais au contraire de démontrer à quel point la bande sonore d’un film peut suffire à influer sur le cortex du spectateur, le laissant ainsi dans de parfaites dispositions sensorielles pour se construire lui-même le film dans sa tête. Sur ce point, on n’oubliera pas que de nombreux films d’horreur (dont Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper) tiraient déjà l’intégralité de leur impact sensoriel d’une bande-son expérimentale qui compensait aisément l’absence d’images gores, tout en laissant au public l’impression d’avoir vu l’innommable par une maîtrise diabolique du montage, tant visuel que sonore. Reste que cette cuisine mentale concoctée dans les coulisses finit ici par abattre son jeu sur les synapses du spectateur au bout de vingt minutes : le concept a vite fait de s’épuiser comme un citron pressé trop vite (et sans beaucoup de pulpe à la base) une fois que les règles ont été posées (en gros, se focaliser sur le son tout en observant le regard des doubleurs et le découpage des scènes sur papier). Du coup, face à une idée déjà essorée, que faire pour relancer l’intérêt ? La double solution de Peter Strickland est édifiante de maladresse : d’une part, sa caméra se concentre sur des personnages tous aussi caricaturaux les uns que les autres (les Anglais sont des conformistes coincés du cul, les Italiens sont des connards obsédés et imbus d’eux-mêmes, etc…) pour combler le manque de propos, et d’autre part, le scénario dérape sur la pente du trip mental lorsque le héros voit son cerveau partir en vrille, écartelé entre son mal du pays, l’absence de sa mère et cet univers italien dans lequel il se sent mal à l’aise. Au détour de quelques plans lynchiens sans intérêt, dont un pompage pas très malin du plan final de L’antre de la folie et un « Silencio » qui amorce la descente du héros dans son monde intérieur, le récit finit par perdre pied sans en tirer le moindre propos, nous laissant ainsi sur le bord de la route. Un peu à l’image du dernier plan du film : une silhouette qui contemple fixement un écran d’une blancheur abstraite. Mieux vaut revoir le génial Blow Out, qui, lui, utilisait le raccordement entre le son et l’image comme outil théorique et trompeur, propice aux émotions les plus fortes.

THE COLLECTION
Marcus Dunstan – Etats-Unis – 2012 – Compétition officielle
Au beau milieu de tous les ersatz pitoyables cherchant à surfer sur le succès mondial de la saga Saw, le bien nommé The Collector avait plutôt bien réussi à se démarquer grâce à un soin tout particulier apporté à sa réalisation, à un Scope d’une beauté hallucinante et à de surprenantes idées de meurtres émaillées tout au long d’un pur récit de série B. Et tout ça sans lumière verte, sans accélérés pourris et sans complaisance excessive dans le gore. Pas mal pour le jeune Marcus Dunstan, pourtant connu comme le scénariste des trois derniers Saw, dont la success-story hollywoodienne risque fort de se poursuivre en fanfare avec le futur Pacific Rim de Guillermo Del Toro (dont il est l’un des scénaristes). En attendant, il en a profité pour bricoler une suite à son premier film, reprenant plus ou moins là où The Collector s’était arrêté. Rappel des faits : on y suivait la descente aux enfers d’Arkin, un cambrioleur pris au piège d’une luxueuse maison qu’il souhaitait braquer et dans laquelle un serial-killer incroyablement sadique (surnommé le « Collectionneur ») s’était appliqué à installer une folle liste de pièges mortels. Au final, le générique se lançait au moment même où Arkin, croyant s’être sorti de cet enfer, se retrouvait à son tour pris au piège de ce tueur masqué. The Collection démarre donc par une folle séquence de charcutage au cœur d’une rave-party improvisée, où une bonne centaine de jeunes finissent en steak tartare dans un déluge démentiel de barbaque, et où ce cher Arkin, retenu prisonnier dans une caisse du tueur, réussit à s’enfuir de justesse avec l’aide d’une adolescente (qui, elle, finit par être kidnappée à son tour). Fin du calvaire pour lui ? Non, ce n’est que le début. Etant désormais le seul survivant et connaissant mieux que personne le fonctionnement du tueur, il se retrouve forcé d’épauler une équipe de militaires surarmés, engagés par le père fortuné de l’adolescente pour retrouver cette dernière, et de retourner à nouveau dans l’antre du tueur.
D’un point de vue purement subjectif, on ne sait pas trop quoi dire d’intéressant sur The Collection, si ce n’est que le concept finalement assez simple et modeste du premier film (qui s’apparentait presque à une version gore de la dernière demi-heure de Maman j’ai raté l’avion) a cette fois-ci laissé la place à un énième jeu de piste sans surprise, dont la description pourrait se limiter à la phrase « du sang, mais pas de tripes ». Comprenons par là qu’au lieu de chercher à tuer le concept du premier film tout en fouillant davantage la personnalité du tueur (qui, avouons-le, restait jusque-là un peu énigmatique), Dunstan ne s’est finalement pas trop foulé, limitant son récit plus basique tu meurs à l’élimination progressive de plusieurs personnages pris au piège de la tanière du serial-killer. Quant à ce dernier, de plus en plus cruel et méthodique, la simple visite de son antre glauque n’aide pas réellement à y voir plus clair sur ses motivations, si ce n’est au détour de quelques plans où les cadavres qu’ils collectionnent finissent en morceaux dans des bocaux ou en vagues constructions abstraites à peine dignes de figurer au MoMA. Du coup, Dunstan s’est retrouvé pris au piège du syndrome Saw 2, à savoir rejouer la carte du faux changement dans l’éternelle continuité, quitte à en faire des caisses dans le sadisme, à multiplier les invraisemblances du récit (dont un final auquel on ne croit pas une seule seconde) ou à achever son suspense sur un inévitable cliffhanger, annonçant ainsi une prochaine suite. Rien n’a changé, donc. Et même si l’ennui ne s’invite pas (enfin, pas toujours) au coeur de ce musée des horreurs, l’idée de refaire une nouvelle visite ne nous met pas forcément en joie.

HOME SWEET HOME
David Morley – France – 2013 – Compétition officielle
En 2009, avec son premier film Mutants, David Morley s’était imposé comme l’un des jeunes espoirs du cinéma de genre français, utilisant un canevas simple de survival en milieu infecté comme prétexte à une vraie œuvre émotionnelle, entièrement guidée par les émotions de ses deux personnages et baignée dans une liste d’influences digérées avec brio (de Cronenberg à Fresnadillo en passant par Carpenter). Depuis l’échec tragique de ce film en salles, un étrange silence radio avait fini par entourer ce jeune réalisateur. Contre toute attente, on le retrouve aujourd’hui avec Home Sweet Home, petite production indépendante tournée en langue anglaise au Canada avec un budget tout aussi modeste et une poignée d’acteurs inconnus. La présentation de ce film en avant-première mondiale était donc l’un des gros événements du festival. Mais une fois que les 81 minutes du métrage laissent place au générique de fin, une toute autre impression aura vite fait d’envahir la quasi-totalité de l’audience dans la salle : celle d’avoir perdu son temps devant ce qui pourrait presque s’apparenter à un vaste puits sans fond. Au risque d’être trop direct, on ne va pas y aller par quatre chemins : Home Sweet Home n’est pas un film. Du moins pas dans le sens où on devrait l’entendre, à savoir une entité à part entière qui contiendrait un scénario, une ambiance, une ou plusieurs thématiques, des enjeux dramatiques, des velléités de mise en scène, etc… A la base, le synopsis se révèle si limité qu’il pourrait tenir sur une moitié de confetti : un tueur masqué pénètre dans le domicile d’un couple lambda, prépare ses pièges et attend patiemment que ses futures proies reviennent pour leur faire vivre une nuit de cauchemar. Et… c’est tout ? Ben oui.
Bon, on a déjà vu bien plus minimaliste comme point de départ, mais en général, ce genre de postulat servait de base pour orienter ensuite un récit basique vers des pistes narratives bien plus audacieuses. Ici, Morley se fout littéralement de la gueule du public en étirant sur 1h21 un pitch qui pourrait à peine suffire à peupler un court de dix minutes. On vous résume la situation : après une bonne demi-heure chiante à mourir où le psychopathe visite la cuisine et la salle de bains, bloque les fenêtres dans la chambre à coucher et fait caca dans les toilettes en oubliant de tirer la chasse (ce qui, vous me l’accorderez, est absolument passionnant), on a droit au cinquième épisode de Paranormal activity, focalisé sur un couple de bobos à la fois très beaux et très bêtes, qui se chamaillent gentiment, qui parlent de tout et de rien (et toujours pour rien), avec monsieur qui regarde le match de foot à la télé pendant que madame enfile une tenue sexy, sans se douter une seule seconde qu’un cinglé s’est caché quelque part dans leur baraque. Et au terme d’une poignée de jump-scares aussi nases que chez Oren Peli, le tueur passe à l’action, élimine le mari en deux temps trois mouvements, attache la fille au radiateur de la chambre et s’assoit dans un coin du couloir. Pour meubler les vingt minutes qui restent, Morley se contente d’un jeu de pistes consternant et sans aucune finalité, passant d’une scène à l’autre en enchaînant les aberrations (notamment lorsque la belle tente de faire marcher un flingue en allant chercher les clés à la cave !), jusqu’à une scène finale qui fait figure de délivrance… Psychologie, thématique, enjeux ? Euh, connais pas… On ne demandait certes pas la lune, mais au moins un survival efficace qui tienne en haleine, voire un twist final qui apporterait un plus. Mais force est de constater que le réalisateur n’avait juste rien à filmer et encore moins à raconter. Plus proche d’une bande démo que d’un vrai thriller, Home Sweet Home a beau faire preuve d’une maîtrise plus affirmée du cadre et du montage chez David Morley, une telle maîtrise se révèle profondément exaspérante lorsqu’elle ne sert qu’à enrober du néant cinématographique sous un joli paquet cadeau. Pour le coup, on peut vraiment crier au foutage de gueule.

MODUS ANOMALI
Joko Anwar – Indonésie – 2012 – Compétition officielle
Dernier film de la compétition, Modus Anomali jouissait déjà d’une belle réputation d’œuvre-choc après être passé dans différents festivals, en plus de s’inscrire dans la lignée du nouveau cinéma indonésien (dont des cinéastes comme Gareth Evans et les Mo Brothers ont pu se faire les meilleurs représentants). Tourné en huit jours au cœur d’une vaste forêt dans des conditions très difficiles (au point d’envoyer le chef opérateur à l’hôpital dès la fin du tournage !), le film reprend un canevas de survival énigmatique, révélant ses informations au compte-gouttes en laissant planer le mystère jusqu’à une révélation-choc, un peu à l’image d’un film comme Eden Log. Le concept est d’ailleurs à peu près le même que chez Franck Vestiel : un homme émerge d’une tombe creusée au milieu d’une vaste forêt plongée dans la nuit, sans savoir où il est ni qui il est, et tente de survivre à une série d’attaques et de menaces qui se manifestent à chaque nouveau lieu visité. Le seul indice apparent intervient au bout de dix minutes de métrage, lorsqu’un petit chalet forestier totalement désert se présente à lui : cet homme était visiblement en vacances avec sa femme et ses enfants, et ces derniers ont visiblement disparu tandis que sa moitié a été éliminée par un mystérieux tueur à l’arme blanche… En révéler davantage serait trahir la finalité du scénario, plus cruel et manipulateur qu’il n’en a l’air. On se contentera de préciser qu’à l’image du Tropical Malady d’Apichatpong Weerasethakul, le film de Joko Anwar construit un récit bicéphale, élaborant dans un premier temps une logique de pur survival jusqu’à une scène centrale qui réoriente le récit sur une autre piste tout en déconstruisant notre perception initiale du scénario. Dans l’idée, la maîtrise technique du cinéaste est évidente, ne serait-ce qu’au travers des plans-séquences, mais cette virtuosité se révèle bien trop vaine, d’une part parce que l’immersion perd beaucoup de sa force par un filmage en temps réel qui s’étire trop en longueurs inutiles (ce qui rend la partie survival très ennuyeuse), d’autre part parce que la dramaturgie n’est jamais assez active pour nous impliquer dans le récit (elle le sera d’ailleurs encore moins lorsque le récit révèlera sa face cachée). Au final, avec ce récit faussement anxiogène, on reste dans une situation un peu similaire à The Body (qui restait toutefois beaucoup plus maîtrisé) : cette année, les deux seuls films de cette compétition officielle à sortir un peu du lot n’ont pas été ceux qui favorisaient le plaisir d’une expérience immersive et hallucinée, mais ceux dont la seule finalité résidait dans une pure manipulation narrative, visant à anéantir chez le spectateur de toute sensation de vertige et d’incertitude par un twist vicieux et roublard. Pas l’impression la plus agréable que l’on aurait aimé conserver en définitive, c’est certain.
Compétition courts-métrages

UN MONDE MEILLEUR
Sacha Feiner – Belgique – 2012
Premier court-métrage à inaugurer la compétition des courts-métrages, Un monde meilleur plaçait déjà la barre très haut pour cette catégorie. Réalisé par Sacha Feiner, jeune réalisateur belge réputé pour une série d’animation baptisée World in progress qui peignait déjà un futur quasi orwellien, ce petit film de 23 minutes suit la descente aux enfers d’un fonctionnaire zélé, employé comme délateur au cœur d’un régime totalitaire qui, un soir de fête, s’effondre d’un coup sec. Le début d’une descente aux enfers absolue pour ce personnage borné, forcé de voir son monde déshumanisé à la THX 1138 se transformer peu à peu en prairie verte digne de celle des Télétubbies. Réalisé avec un soin extrême apporté aux décors (malgré un budget que l’on imagine limité) et rempli de gags très bien amenés sur l’aliénation de l’individu, ce court-métrage laisse entrevoir un vrai talent de cinéaste. A suivre de très près.

SUICIDE MANUAL
Lee Seung-hyuk – Corée du Sud – 2012
L’année dernière, Lee Seung-hyuk fut le grand vainqueur de la compétition courts-métrages avec le brillant A function, où la réussite scolaire en Corée du Sud se voyait revisitée sous un angle horrifique brillamment exploité. Vivre ou mourir, tel était le dilemme auquel était alors confrontée une jeune écolière. Dans Suicide Manual, le monde du travail est à nouveau décrit comme oppressant, mais avec une approche plus grinçante, en collant à un employé de bureau déterminé à se suicider pour échapper à son rythme de travail. L’idée d’y inclure une assistance audio guidant le suicidaire vers la mort parvient à mixer efficacement l’humour au malaise et, au final, à aborder un thème difficile de façon intelligente, au travers de qualités techniques (montage et réalisation) plus qu’indéniables.

LONELY BONES
Rosto – France/Pays-Bas – 2012
Réalisateur néerlandais spécialisé dans le cinéma d’animation, Rosto reprend dans ce court-métrage des éléments initiaux dans l’un de ses précédents travaux (No place like home, court-métrage déjà présenté au festival il y a trois ans), à savoir le groupe virtuel et démoniaque Thee Weckers, et en fait le deuxième segment d’une future tétralogie en cours de fabrication. La petite histoire de ce projet est d’ailleurs plus facile à résumer que celle de ce petit film de 10 minutes, totalement nébuleux dans son intrigue comme dans son propos, déroulant une belle liste de techniques visuelles (dont une stop-motion assez étonnante) sous une bande-son égarée entre blues et rock. Absolument splendide à regarder, extrêmement singulier dans son esthétique, mais cela dit, ce genre d’hallucination sur pellicule n’a toutefois pas manqué d’en dérouter plus d’un. Ce qui, sous un certain angle, en faisait le court le mieux relié à l’éthique du festival. Sa victoire au palmarès n’en était que plus logique.

RECORD/PLAY
Jesse Atlas – Etats-Unis – 2012
On peut dire que ce court-métrage, présenté juste avant la projection en compétition de Berberian Sound Studio, tombait à pic, tant les deux films partagent un peu la même approche du son autant comme vecteur d’émotions diverses que comme élément déclencheur amenant l’écouteur dans une autre dimension. Ici, c’est en écoutant en boucle les cassettes audio enregistrées par sa femme qu’un homme solitaire tente de revivre les souvenirs du passé. Sauf que l’une de ces cassettes va aller jusqu’à l’inclure lui-même dans le contenu descriptif de la bande audio… Bénéficiant d’une narration et d’une mise en scène toutes deux très maîtrisées, ce court revisite surtout le thème de l’amour éternel sous un angle à la fois contemporain et rétro, l’attachement envers ces vieilles cassettes à bande magnétique (aujourd’hui obsolètes) servant de symbole fort pour illustrer le lien toujours intact entre deux amoureux (dont l’un n’existe plus). Belle métaphore.

HOTEL
José Luis Aleman – Espagne – 2012
Amusante variation sur le thème de Hansel & Gretel, ce court-métrage espagnol colle aux basques d’un homme paumé en plein désert, trouvant soudain refuge dans un hôtel désert, au beau milieu duquel se trouve une pièce pleine de nourriture. On vous laisse deviner la suite (assez prévisible), mais impossible d’anticiper la pirouette finale, assez marrante et anecdotique. L’attrait de ce petit film réside surtout dans le décor de l’hôtel, entièrement construit en carton à la manière de certains clips un peu artisanaux de Michel Gondry et rempli de couloirs biscornus qui évoquent parfois des compositions suprématistes. Et comme cette drôle de production design sert efficacement le concept (très simple) du film, le résultat constitue une agréable surprise.

WHO IS ARVID PEKON
Patrik Eriksson – Pologne/Suède – 2013
Au début, on croit être en terrain connu : un opérateur téléphonique reçoit des appels où il doit revêtir l’identité d’une autre personne, jusqu’au jour où l’un de ses appels va remettre en question sa propre identité. Forcément, l’idée de voir un récit kafkaïen en diable où un homme perd le sens des réalités et où des cafards viennent s’immiscer dans le décor évoque instantanément le spectre de William Burroughs. Il y a un peu de cela ici, mais certainement pas sur la forme, très appliquée et figée dans une rigueur visuelle propre aux films fantastiques d’Europe de l’Est. Tourné en Pologne par un jeune réalisateur suédois, ce court-métrage fut sans conteste le plus exigeant du festival. L’un des plus fascinants, aussi.

MEN OF THE EARTH
Andrew Kavanagh – Australie – 2012
L’ovni de la compétition courts-métrages, c’était lui. Et encore, ce n’est pas tout à fait vrai : l’année dernière, Andrew Kavanagh nous avait déjà fait le même coup avec At the formal, court-métrage tourné en un seul plan-séquence légèrement ralenti et hypnotique. Rebelote ici, avec une caméra qui s’incruste au beau milieu d’un chantier de la route où, bizarrement, les ouvriers ne semblent pas trop préoccupés par leur travail. Dès que le plan-séquence s’achève, le réalisateur révèle le pourquoi du comment et revient à un montage plus classique qui atténue paradoxalement le trouble du film. Pas trop mal en l’état, mais suffisamment anecdotique pour constituer le court le plus faible de la compétition.
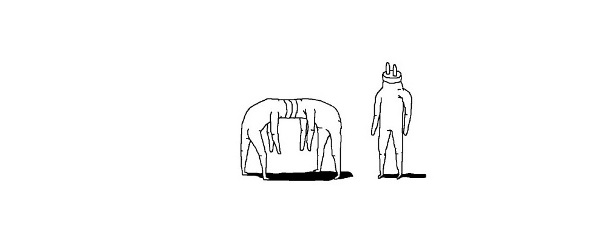
PLUG & PLAY
Michael Frei – Suisse – 2012
Chouette idée que de finir la compétition sur un petit film aussi barré, où des personnages à tête de prise électrique se branchent les uns aux autres dans un monde où les doigts sont les maîtres. Si le pitch semble trop vague, on a vite fait d’halluciner devant l’inventivité de ce réalisateur suisse, jouant aussi bien sur l’excentricité des situations que sur le minimalisme de l’animation (sacré travail sur les variations entre le noir et le blanc, lesquelles servent ici de support comique). Le propos ? On ne sait pas trop, mais on sent quelques idées sur la création, le sexe, l’amour, l’amitié, les relations de couple, la condition humaine, le courant qui passe, la pénétration anale, la jouissance… Tout ça dans un style visuel sacrément audacieux où se déchaînent les idées les plus folles, dont une qui renvoie au trashouille The Human Centipede. Les fans de Bill Plympton vont adorer, les autres aussi.

MACON COUNTY LINE
Richard Compton – Etats-Unis – 1974 – Thématique « Blancs, sales et méchants »
Aaaah, les rednecks ! Cette espèce redoutée et souvent dissimulée par une Amérique qui n’ose pas se regarder dans le miroir, composée de familles pauvres végétant dans des maisons délabrées, de garagistes crados qui ont visiblement confondu le gel douche avec l’huile de vidange et de tarés consanguins prêts à sauter à la gorge des citadins égarés en pleine campagne. La culture « white trash », donc, sorte de pendant honteux et répugnant du rêve américain, explorée en général dans des genres aussi codés que l’horreur et le survival, à l’honneur cette année durant le festival Hallucinations Collectives et sur laquelle il sera question d’apporter aujourd’hui un jugement quelque peu nuancé. Et quoi de mieux pour commencer ce revirement de façade que de découvrir l’un des films américains les plus cultes, les plus rentables et pourtant les plus méconnus de l’histoire du cinéma, à savoir le très intéressant Mason County Line, connu des cinéphiles les plus obstinés pour avoir fait un carton monstrueux dans les drive-in durant l’année 1974.
Coécrit et coproduit par l’acteur Max Baer Jr, à une époque où ce dernier venait de subir l’arrêt de la série Beverly Hillbillies au point de galérer sévère pour trouver du travail, le film tranche clairement avec l’image d’un monde rural déviant qui déchainerait sa monstruosité sur une jeunesse idéaliste. Au-delà du simple tableau réaliste du Sud des Etats-Unis, ce road-movie dérivant progressivement vers le drame fataliste met surtout en scène la confrontation brutale entre deux facettes de l’Amérique : d’un côté, la jeune génération naissante en quête de sexe, de liberté et de sensations fortes, et de l’autre, un univers sudiste et conservateur, perfusé à la ségrégation raciale et aux valeurs traditionnelles. Mais la grande force de Mason County Line est de jamais juger qui que ce soit, de rejeter toute stigmatisation comme la peste, et en définitive, de donner chair à des personnages plus complexes qu’ils n’en ont l’air, révélant une humanité profonde même à travers leurs aspects les moins reluisants. Et dans ce parcours d’un trio de jeunes Américains poursuivis par un shérif raciste les imaginant coupables du viol et du meurtre de sa femme, le réalisateur Richard Compton trouve aussi matière à renouer avec l’imagerie marquante des road-movies de l’époque, période Easy Rider ou Macadam à deux voies, à travers un film impeccablement joué, découpé et mis en scène. Des qualités qui tranchent avec l’aspect bricolé de la plupart des productions fauchées de l’époque, et qui poussent à reconsidérer urgemment cette petite pépite encore trop méconnue en France.

SANS RETOUR
Walter Hill – Etats-Unis – 1981 – Thématique « Blancs, sales et méchants »
Dans le monde cruel d’Hollywood, même les cinéastes les plus célébrés finissent par récolter le revers de la médaille à un moment donné. Et dans cette catégorie, Walter Hill aura connu le même sort que Steven Spielberg avec 1941 au cours de la première moitié de sa carrière : après un carton hollywoodien (Les dents de la mer pour l’un, Les guerriers de la nuit pour l’autre), voilà qu’un film plus hargneux et imprévisible se solde par un bide total au box-office. Et si les arguments ne manquent assurément pas pour tenter d’expliquer pourquoi Sans retour fut un tel échec, l’arrivée du reaganisme et la volonté pour l’Amérique de retrouver sa force conquérante en constitue peut-être le plus évident. Reste qu’au vu d’une guerre du Vietnam dont le spectre traumatisant restait encore bien chaud dans les mémoires, Hill va à contre-courant de cette démarche visant à enterrer l’une des pages noires de l’histoire de l’Amérique et en profite donc pour continuer à souffler sur les braises. Pour ce faire, il construit un postulat de survival basique où neuf soldats de la Garde Nationale, pratiquant une mission de reconnaissance au fin fond des bayous marécageux de Louisiane, se retrouvent pris en chasse par une horde de cajuns à la suite d’un malentendu totalement stupide. L’idée et le cadre pourraient évidemment laisser croire à une énième resucée de Délivrance. Sauf qu’a contrario du survival fondateur et universel, le quatuor de citadins humiliés par une bande de rednecks psychopathes ont laissé la place à un commando de militaires grandes gueules, pris en chasse par un ennemi quasi invisible dans un milieu qu’ils ne connaissent absolument pas.
Un choix géographique qui donne au film une dimension métaphorique plus qu’évidente, reproduisant ainsi le cadre du Vietnam dans un décor tout aussi exotique et dangereux. Et si le film de John Boorman faisait de la nature une vue de l’esprit idyllique progressivement vérolée par les bas instincts de l’être humain, Walter Hill opte au contraire pour un lieu d’emblée inhospitalier, sorte de bourbier gavé de pièges mortels dans lequel des personnages plus antipathiques qu’autre chose s’immiscent à la manière de conquérants sans pitié. Du coup, les soldats sont ici décrits comme des abrutis complets, d’une bêtise parfois hallucinante (l’un d’eux avoue vendre de la drogue à des mioches de dix ans !) qui n’a d’égal que leur profond mépris des peuples indigènes, et contraints de rester unis pour survivre alors que de violentes tensions s’installent très vite entre eux. Quant aux représentants de la culture « white trash », Hill ne les peint en aucun cas comme des tarés congénitaux sodomisant les pauvres citadins égarés en territoire inconnu, mais davantage comme les pauvres victimes d’une Amérique vaniteuse et imbue d’elle-même. Ce renversement total des codes du genre sied à merveille au style enragé de Walter Hill, lequel prend soin d’en pousser les limites, forçant ainsi l’identification du spectateur à une bande d’imbéciles en uniforme et plaçant ainsi celui-ci face ses responsabilités morales et politiques. Assez inconfortable sur le fond, Sans retour n’en oublie toutefois pas d’être ce qu’il devait être avant tout, à savoir un pur survival d’une efficacité et d’une colère assez étonnantes, réalisé de façon sèche et sans aucun compromis par un cinéaste en pleine possession de ses moyens, et dont le scénario, précis comme la balle d’un fusil, maintient une tension incroyable de la première à la dernière seconde. De quoi s’attrister qu’un film aussi puissant n’ait pas réussi à trouver le succès dans les salles obscures. Cela dit, Walter Hill n’aura pas attendu bien longtemps pour sortir de cet échec : l’année suivante, il réalisera 48 heures, buddy-movie avec Nick Nolte et Eddie Murphy, qui sera le plus gros succès de sa carrière.

HATED : GG ALLIN AND THE MURDER JUNKIES
Todd Phillips – Etats-Unis – 1993 – Thématique « Blancs, sales et méchants »
Le nom de Todd Phillips au générique n’est pas du tout une farce : il s’agit bel et bien du réalisateur de ces monuments de connerie régressive que sont Road Trip, Old School et Very Bad Trip. Mais avant d’orienter toute sa carrière dans cette voie, le bonhomme s’était fait les mains sur une paire de documentaires, dont le premier fut ce Hated, injustement méconnu dans l’Hexagone. Le sujet, lui, vaut largement qu’on s’y attarde, puisqu’il colle à la personnalité du chanteur punk hardcore GG Allin, réputé pour ses édifiantes prestations scéniques. Pour faire simple, disons qu’après s’être gavé de laxatifs, le type se désape intégralement et se lance dans un concert hallucinant où il gueule des obscénités dans un micro (ou se le cogne contre le visage jusqu’à s’éclater les dents), tabasse le public qui se trouve au premier rang, les incite même à se mettre à poil, s’insère une banane dans l’anus, prend plaisir à s’automutiler et va même jusqu’à déféquer sur scène avant de bouffer sa propre merde ! Fasciné par la personnalité extrême de GG Allin au point d’en être devenu fan, Phillips interroge alors des membres de sa famille, des proches, des fans et des ennemis, afin de faire la lumière sur son parcours. Le souci, c’est que l’on manque de mots pour qualifier ce docu. Non pas en raison de sa très courte durée (à peine 45 minutes !) ou des archives vidéos montrant des actes obscènes (soyez prévenus), mais parce qu’il laisse le mystère entier sur ce personnage. Qui était réellement GG Allin ? Un vrai punk habité par une colère nihiliste envers la société, ou un minable exhibitionniste lancé dans une course aberrante à la performance scénique la plus déviante ? Les révélations sur son enfance au cœur d’un environnement de rednecks servent d’indice pour tenter de comprendre l’homme, mais l’image qui en ressort ici reste plus antipathique qu’autre chose, qui plus est lorsque Phillips se concentre en majorité sur les fans décérébrés d’Allin. On ne peut en tout cas pas rester indifférent devant ce portrait, et le réalisateur le prouve en insérant les vidéos d’archive de l’enterrement d’Allin (décédé peu après le tournage) en bout de métrage, à la fin du générique. Plutôt logique : seuls quelques fans hardcore auront le courage et la passion de le suivre jusqu’au bout.

LA COMPAGNIE DES LOUPS
Neil Jordan – Royaume-Uni – 1984 – Thématique « Evanescente innocence »
Riche idée de la part du festival que d’accorder une place à une longue lignée de films fantastiques où le regard de l’enfance, forcément gorgé d’une innocence de plus en plus menacée, se heurte violemment au monde des adultes. Une thématique riche de sens, explorée par de nombreux cinéastes venus de différents horizons, et dont certains chefs-d’œuvre, de La nuit du chasseur de Charles Laughton au Labyrinthe de Pan de Guillermo Del Toro en passant par Le voyage de Chihiro d’Hayao Miyazaki et Cria Cuervos de Carlos Saura, auront posé les bases d’une réflexion hautement passionnante sur la fin de l’innocence comme métamorphose marquant le passage vers l’âge adulte. Les trois films présentés cette année durant le festival constituent des jalons-clés de cette thématique, œuvres plus ou moins méconnues qui, chacune à leur manière, abordent le sujet de plein fouet sous des angles d’attaque très variés… Œuvre culte vénérée par un cercle très fermé de cinéphiles pour son onirisme et son fond psychanalytique, La compagnie des loups aura toutefois ouvert les festivités en laissant une impression plus que mitigée. Que l’on ait vu le film à sa sortie ou pas ne change pas grand-chose à la déception que déclenche aujourd’hui cette sorte de conte de fées cauchemardesque, mêlant conte populaire et lycanthropie au cœur d’un récit complexe où rêve et réalité ne cessent jamais de s’interpénétrer. Il est toutefois facile de cerner en quoi ce second film de Neil Jordan (dont les débuts de réalisateur ne furent pas très glorieux) marqua les esprits en dépit de son échec au box-office : outre le désir de revisiter Le Petit Chaperon Rouge à la sauce macabre et un traitement visuel faisant la part belle aux célèbres trucages animatroniques pour les transformations de loup-garou, on y trouve avant tout une narration aux multiples niveaux de lecture, explorant la psychanalyse de l’enfance au sein d’un univers visuel angoissant et stylisé, reflet à peine revendiqué des peurs enfantines.
Le souci, c’est qu’un sujet en or ne fait pas forcément un grand film, surtout lorsque l’on se souvient que le réalisateur en question s’est généralement distingué par la suite avant tout pour son talent de scénariste (par ailleurs oscarisé en 1993 pour le mythique The Crying Game) que pour ses facultés à faire se dérouler une histoire avant tout par la puissance de sa mise en scène et de son découpage. Du coup, même avec des décors et des effets spéciaux qui n’ont hélas pas résisté aux affres du temps (et c’est presque un euphémisme), il est difficile de pénétrer réellement cet univers fantasmatique et de rester concentré devant ce qui ressemble désormais à un agrégat d’éléments mal emboîtés. Pour ne rien arranger, la réalisation de Neil Jordan pâtit ici d’un filmage démonstratif et d’un montage parfois bancal, ne laissant parfois même pas le champ libre pour les acteurs de s’exprimer correctement. En définitive, seul le contenu symbolique du récit pourra désormais continuer à intéresser le cinéphile au détriment d’un style visuel dépassé, dont les maladresses et les approximations auront fini par devenir clairement lisibles avec le temps. Cela n’enlève toutefois en rien à La compagnie des loups l’influence bel et bien importante qu’il aura sans doute eu sur de nombreux cinéphiles et cinéastes, parmi lesquels on aurait même tendance à placer ce cher Laurent Boutonnat, dont l’envoûtant Giorgino et la plupart des clips conçus pour sa muse Mylène Farmer semblent avoir été perfusés au même sang que ce film.

L’ENFANT MIROIR
Philip Ridley – Canada/Royaume-Uni – 1990 – Thématique « Evanescente innocence »
Cinéaste encore trop méconnu dans l’Hexagone et dont le retour il y a deux ans avec l’intéressant Heartless après des années d’absence n’aura même pas fait l’effet d’un choc au sein de la planète cinéphile (si ce n’est auprès de quelques fans), Philip Ridley est clairement devenu un auteur maudit, contraint de rester dans l’ombre pour continuer à s’exprimer, et dont la volonté d’embrasser plusieurs formats d’expression artistique sans se limiter à la simple réalisation de longs-métrages en font presque le Peter Greenaway du cinéma du genre. Son premier film, L’enfant-miroir, reste une découverte fascinante pour tous ceux fascinés par le portrait d’une enfance difficile, marquée par une avalanche de cauchemars au détriment du rêve. Baignant dans une ambiance solaire et apparemment stable où de sublimes couchers de soleil déploient leur douce lumière dans de grands champs de blé dignes d’une toile de Magritte, le film explore le quotidien difficile de Seth, un enfant de neuf ans grandissant auprès d’un père honteux et d’une mère fanatique, très vite confronté à des événements tragiques qui mettront son innocence à très rude épreuve. Mais loin du tableau d’une époque aujourd’hui révolue, revisitée sous l’angle du cauchemar par un enfant hanté par ses souvenirs, Philip Ridley choisit une approche plus inédite où le réel se confronte sans cesse à son pendant fantasmagorique. De rencontres soudaines en soupçons inquiétants qui se manifestent par l’apparition de détails symboliques (une femme blonde vêtue de noir, une voiture sombre qui annonce un terrible présage…), le film traduit à merveille les vertiges de l’enfance, marqués par le vacillement des repères moraux, la multiplication tragique des non-dits et une réinterprétation faussée des névroses du monde adulte. Cette menace sourde qui ne cesse de grandir au fil des scènes atteindra son paroxysme dans une scène finale littéralement inoubliable, sur laquelle il convient de ne rien dire. Vraiment un film sublime, d’une incroyable perfection visuelle, quelque part entre Atom Egoyan et Terrence Malick, dont les images hantent longtemps après la projection. A noter la présence d’un Viggo Mortensen encore très jeune et déjà formidable en figure de frère protecteur au look de James Dean.

L’ETE OÙ J’AI GRANDI
Gabriele Salvatores – Italie – 2003 – Thématique « Evanescente innocence »
On peut déjà remercier l’éditeur TF1 Vidéo pour avoir sorti il y a quelques années ce film en DVD sous l’appellation I’m not scared, traduction anglaise du titre italien original (également celui du roman de Niccolo Ammaniti dont il est l’adaptation). D’abord parce que l’on suppute très fortement qu’un titre français aussi aberrant est pour beaucoup dans la distribution confidentielle du film dans les salles obscures, ensuite parce qu’il ne reflète en rien le contenu finalement très dérangeant de ce récit complexe. Tout comme L’enfant-miroir (dont il semble reprendre le cadre solaire et les thématiques sur la fin de l’innocence), le film de Gabriele Salvatores ancre surtout son récit cruel au cœur du sud de l’Italie des années 70, dans une région pauvre et abandonnée qui semble coupée du reste du pays. C’est là que le jeune Michele et ses amis jouent à se créer des sensations fortes jour après jour, bénéficiant d’une totale liberté dans ce vaste territoire de champs de blés en raison d’adultes plutôt absents qui semblent les livrer à eux-mêmes. Le jour où Michele découvre par hasard un trou béant dans lequel est séquestré un enfant sauvage, c’est le moment où s’impose avant tout chez lui la notion de responsabilité : en choisissant de garder secrète cette découverte, l’enfant découvre surtout un nouvel ami qui le prend pour son ange gardien, le suppliant de l’aider et de l’extraire de cet enfer. On est dans la droite lignée d’un film comme Stand by me où des enfants découvraient un cadavre au cours d’une ballade, à la différence que le film de Salvatores ose clairement se confronter au monde des adultes à hauteur du regard de l’enfant, enrobant ainsi la plupart des éléments du récit d’un certain mystère (tout n’est pas expliqué) et posant sur chaque personnage, les enfants comme les adultes, un regard tendre et discret, sans complaisance ni stigmatisation, n’appuyant jamais le sordide de l’histoire et achevant son récit sur un final évanescent. Au détour d’un plan malicieux, il se permet même un clin d’œil discret à La nuit du chasseur, mettant sur le chemin initiatique du héros un bestiaire familier (crapaud, serpent, hibou…) qui hantait autrefois les bords de la rivière sur laquelle dérivaient lentement les deux enfants menacés, contraints de fuir la cruauté du monde adulte. Plutôt très fort de la part d’un cinéaste à qui l’on doit quand même l’inénarrable Nirvana, fable pseudo-cyberpunk avec Christophe Lambert !

DELLAMORTE DELLAMORE
Michele Soavi – Allemagne/France/Italie – 1994 – Hommage à Michele Soavi
Chaque année, le festival Hallucinations Collectives consacre une petite rétrospective en hommage à un puissant cinéaste qui aura marqué de son emprunte le cinéma de genre. Après le précieux Richard Stanley l’année dernière, c’est au tour du tout aussi précieux Michele Soavi d’obtenir les honneurs du festival. Cinéaste de plus en plus rare ces derniers temps, ayant débuté sa carrière comme acteur puis assistant auprès de Lamberto Bava et Dario Argento, Soavi s’était distingué en tant que cinéaste avec l’excellent Bloody Bird, mixage éminemment brillant entre giallo et slasher, respectant les codes du genre tout en les transcendant sur tous les aspects. La patte de Soavi était déjà très présente dans ce premier essai très maîtrisé, au travers d’une mise en scène expérimentale qui poussait ainsi le genre à offrir de lui-même de nouvelles perspectives sur ses propres règles. Mais les deux films diffusés durant le festival restent encore aujourd’hui les plus connus de sa filmographie en plus de rester parmi les œuvres les plus majeures du cinéma italien moderne. Adaptation très libre du roman éponyme de Tiziano Sclavi, alias le créateur du comics « Dylan Dog », Dellamorte Dellamore suit ainsi le quotidien pas franchement agréable d’un gardien de cimetière joué par Rupert Everett, dont la majeure partie du travail consiste à superviser l’enterrement des défunts du coin et de leur transpercer littéralement le crâne avec des balles bénies dès que ceux-ci se mettent à sortir de leurs tombes en pleine nuit. Pas facile quand le type en question, aussi mélancolique que décalé, tombe amoureux d’une femme adultère très vite envoyée ad patres par le cadavre de son mari défunt, et que son propre acolyte, obèse et simple d’esprit, succombe lui aussi au cadavre mort-vivant d’une motarde décérébrée, fille du maire opportuniste du village voisin. C’est au cœur de ce scénario insensé, variation morbide et décomplexée sur le thème de l’amour impossible, que se dessine un improbable jeu macabre avec des personnages sans cesse trahis par leur pulsion de mort, où les scènes transgressives (entre violence et érotisme) se font littéralement percuter par un humour jubilatoire qui contrebalance toutes les attentes du spectateur. A force d’accentuer scène après scène la folie de son atmosphère par une réalisation percutante, des effets de style qui servent à merveille le propos et des mouvements de caméra qui filent le vertige, Dellamorte Dellamore constitue une œuvre inclassable qui se vit plus qu’elle ne s’analyse, doublée d’un des rares films qui ne perdent strictement rien à être visionnés en boucle.
ARRIVEDERCI AMORE CIAO
Michele Soavi – France/Italie – 2006 – Hommage à Michele Soavi
Dans les interviews figurant au cœur des suppléments du DVD français du film, Michele Soavi ne cache intelligemment rien de son objectif initial : « Lorsque je faisais Dellamorte Dellamore, je faisais un film sur des morts-vivants. Cette fois-ci, je fais un film sur des vivants morts ». Et au vu du plan subjectif qui ouvre le récit (la caméra y adopte le point de vue d’un cadavre de crocodile, animal considéré comme prédateur, qui flotte aléatoirement dans une rivière où s’abat une pluie torrentielle), on peine à mesurer l’impressionnante cohérence dont fait preuve le cinéaste dans ce film sorti en 2006, chef d’œuvre absolu du cinéma italien en même temps qu’aboutissement magistral des expérimentations comme des thématiques abordées par Soavi tout au long de sa carrière. Arrivederci amore ciao permet aussi au cinéaste de passer les frontières du film horrifique pour s’inscrire cette fois-ci dans l’Italie contemporaine, gorgée de mafieux sadiques, de trafiquants malhonnêtes, d’arnaqueurs vicieux, de politiciens véreux et d’oies blanches à sacrifier. Tous pourris ? Clairement oui dans ce polar hardcore et totalement imprévisible, qui suit la tentative de réhabilitation de Giorgio, un ancien truand revenu en Italie après un exil de 15 ans au sein de guérillas marxistes en Amérique Latine, et désireux de récupérer la liberté qu’il n’a jamais cessé de vouloir caresser, même au prix des pires actions possibles. De ses trafics effectués en cachette au cœur du strip-club où il bosse comme videur jusqu’à son paisible travail de restaurateur travaillant en sous-marin à éliminer ceux qui le gène dans sa percée sociale, en passant par l’ignoble chantage que lui impose un flic ripou (joué par le réalisateur Michele Placido) et son amour faussé pour une jeune femme qu’il utilise avant tout à des fins rédemptrices, tous les moyens sont bons pour obtenir une réhabilitation totale.
Porté par un mélange des genres encore plus ahurissant et harmonieux que dans le précédent film de Soavi, Arrivederci amore ciao trace constamment le portrait d’êtres complexes à l’humanité déliquescente, véritables insectes en phase terminale grouillant à tous les étages d’une société pourrie de l’intérieur, contraints d’agir par le chantage et la corruption pour concrétiser leurs désirs de respectabilité. Mais à travers ce constat tragique et radical qui casse les habitudes d’identification du spectateur tout en forçant ce dernier à s’attacher au sort d’une ordure intégrale, Soavi cherche surtout à lui renvoyer en pleine gueule le tableau d’une société morbide et décrépite, dont les figures aliénées qui le peuplent en sont autant les instigateurs que les victimes. Et lorsque le cinéaste laisse pleinement parler sa mise en scène, tantôt expérimentale tantôt élégante, il prend soin de faire en sorte que cette liberté artistique soit constamment au service de sa thématique, avec une cohérence totale entre le discours et l’image, doublée de la volonté de faire du découpage du film le vecteur unique de son propos incroyablement nihilliste. A titre d’exemple, il va même jusqu’à adopter le point de vue subjectif d’une mouche pour refléter une justice désireuse d’enterrer vite fait mal fait les affaires les plus délicates. Œuvre témoin de la marche funèbre du monde autant que radioscopie terrifiante de la nature humaine, ce film hallucinant, bijou absolu de mise en scène sur lequel on aurait beaucoup de mal à recenser tous les superlatifs adéquats, perturbe tellement notre passivité récurrente de spectateur qu’on ne met pas plus de trois secondes à introniser ce cinéaste rare comme l’une des valeurs les plus indiscutables du cinéma italien. Qu’on se le dise, Soavi rime plus que jamais avec « génie ».

LE DERNIER MONDE CANNIBALE
Ruggero Deodato – Italie – 1977 – Carte blanche à Nicolas Boukhrief
Après avoir fait partie l’année dernière du jury du festival, le réalisateur français Nicolas Boukhrief, ancien critique de Starfix, se voit aujourd’hui gratifié d’une carte blanche. Liberté totale lui fut alors donnée pour sélectionner trois films reflétant au mieux le nom du festival, à savoir, selon ses propres termes « des films-trips à vivre dans une salle de cinéma, si possible bourrée à craquer de spectateurs heureux de les découvrir sur grand écran, et qui, à l’époque, m’ont fait sortir les yeux de la tête ». Et sans grande surprise, il s’est judicieusement focalisé sur des œuvres marquantes, conçues pour la plupart vers la fin des années 70, lorsqu’un grand nombre de cinéastes ont tenté de donner vie sur grand écran à des morceaux de pellicule démentiels, déployant une audace aujourd’hui quasiment révolue. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en plus d’être un cinéaste brillant, Boukhrief reste surtout un cinéphile passionné, heureux de faire partager sa passion et son amour d’un cinéma porteur de nouvelles sensations… Cela dit, on ne s’attendait pas forcément à retrouver dans cette catégorie un film de cannibale italien, réalisé par celui qui en fut l’un des plus fervents représentants, à savoir le légendaire Ruggero Deodato. Mais avant de rentrer un peu plus dans le contenu très intéressant de ce film, il convient de remettre un peu les pendules à l’heure sur ce genre-clé du cinéma bis italien des années 70, souvent réduit à l’objectif limité de vous donner envie de dégueuler votre pizza chorizo sur votre voisin de salle. Parce qu’au-delà de nombreuses théories bien fumeuses sur une éventuelle métaphore de nos sociétés anthropophages (que seul Deodato a su réellement aborder à travers ce genre), le film de cannibales n’a jamais cessé de se caractériser avant tout par son hallucinante pauvreté visuelle (en dépit d’une fausse caution documentaire), par des scénarios qui se ressemblent tous (en gros, de pauvres aventuriers blancs se confrontent à des tribus cannibales et primitives), par des acteurs qui jouent comme des vaches (et les doublages français, souvent à pisser de rire, n’étaient pas là pour les aider) et par une surenchère gore, saupoudrée ici et là de scènes de sexe complaisantes et de passages snuff à la ramasse où de véritables animaux sont étripés en gros plan.
Les débuts du cinéaste Ruggero Deodato dans le film de cannibale auront toutefois permis de changer un peu la donne et d’apporter un zeste de substance à ce genre désuet. Ainsi donc, quelques années après qu’Umberto Lenzi ait initié le genre avec Au pays de l’exorcisme, ce cinéaste, réputé à l’époque pour avoir été assistant réalisateur sur de nombreux westerns (dont le célèbre Django de Sergio Corbucci), réalise en 1977 Le dernier monde cannibale qui, malgré une structure narrative très linéaire qui se contente de reprendre le scénario-type évoqué précédemment, évacue le ridicule parfois inavouable du film de cannibale à la Lenzi (où des moments comiques et sexuels lorgnaient souvent vers la série Z érotique) au profit d’un cinéma d’auteur clairement assumé, où l’immersion en territoire inconnu s’accompagne d’un regard quasi entomologiste, un peu comme si Werner Herzog tentait de poser sa caméra au beau milieu d’une tribu primitive et éloignée de toute civilisation. Ainsi donc, si les morceaux de tripaille et les piments d’érotisme ne manquent pas à l’appel, on notera qu’ils n’interviennent que par petits instants, Deodato préférant appuyer la caution documentaire du récit, révéler la peinture des mœurs dérangeantes des cannibales sans poser de jugement stigmatisant et confronter ainsi le spectateur à une autre appréhension du monde, plus cruelle mais aussi plus réaliste. L’idée d’un cinéma primitif sans limite, d’une totale empathie pour ses personnages, et qui évite le racolage du genre grâce à une approche plus sincère. Trois ans plus tard, Deodato entérinera ce parti pris en signant le mythique Cannibal Holocaust, à travers lequel le genre trouvera une résonance sociologique en confrontant la tribu cannibale au comportement abject de nos sociétés soi-disant « civilisées ».

POSSESSION
Andrzej Zulawski – Allemagne/France – 1981 – Carte blanche à Nicolas Boukhrief
Preuve absolue s’il en est qu’une oeuvre impressionnante puisse parfois son origine dans les difficultés personnelles de son créateur, Possession n’a toujours pas volé, plus de trente ans après sa sortie, sa réputation sulfureuse et le culte qui lui vouent encore aujourd’hui une vaste quantité de cinéphiles. Il y a même fort à parier que personne n’oserait plus réaliser un film pareil, conçu par un Andrzej Zulawski au bout du rouleau, blacklisté dans son propre pays à la suite d’un tournage interrompu par le régime communiste polonais, dévasté par un divorce douloureux et contraint de fuir son pays pour espérer retrouver l’opportunité de travailler. C’est précisément d’un drame conjugal poussé à l’extrême que parle le film : revenu à Berlin après un long et mystérieux voyage, Marc (Sam Neill) retrouve sa femme Anna (Isabelle Adjani) dans un état d’angoisse et de nervosité très avancé. Lorsque celle-ci quitte brutalement le domicile familial sans donner d’explication précise sur les sentiments contradictoires qui la rongent, Marc la soupçonne très vite d’avoir une liaison et engage alors un détective privé pour la faire suivre à travers les rues de Berlin. Ce qu’il finira par découvrir dépasse l’entendement et précipitera le couple dans une chute dont il ne se relèvera pas.
On n’ira pas plus loin dans le synopsis, histoire de ne pas gâcher la surprise pour tous ceux n’ayant jamais vu le film. Mais on peut d’ores et déjà affirmer que cette histoire de possession (car il s’agit bien de cela) bouscule les codes traditionnels du film d’horreur pour activer la dimension symbolique de son récit et déployer ainsi une quantité importante de niveaux de lecture. Tragédie moderne sur la désintégration d’un couple, allégorie tétanisante sur le thème du double, métaphore à ciel ouvert sur la complexité des rapports humains, love-story démentielle aux allures de descente aux enfers : ce film fou donne clairement l’impression de tout englober, les genres comme les sensations, au cœur d’un maelström de folie pure où règne une hystérie absolue. Pour autant, Zulawski lorgne davantage du côté de l’allégorie politique, si l’on en juge par le cadre du récit (une cité berlinoise remplie de ruelles sinistres et rongée en son sein par le « mur de la honte ») et le malaise instauré par chaque élément de fabrication du film (photo glaciale, décors délabrés, cadrages nauséeux, mise en scène vertigineuse). Avec, en filigrane de ce vaste déchaînement de forces extrêmes, le spectre démoniaque du communisme, lequel divise les individus pour mieux les détruire au final. D’où la mutation (voire l’autodestruction) d’un couple déliquescent, irrémédiablement condamné à se réunir dans la mort, abdiquant face à leurs doubles maléfiques. Film halluciné et hallucinant de par le climat et la folie qu’il délivre dans chaque scène, Possession est comme un magma en fusion, entièrement régi par une Isabelle Adjani littéralement possédée, démente, en transe.
>>> Lire notre analyse du film

LE CONVOI DE LA PEUR
William Friedkin – Etats-Unis – 1977 – Carte blanche à Nicolas Boukhrief
Joie extrême : la séance la plus complète de tout le festival, marquée par une foule incontrôlable qui aura vite fait de remplir chaque siège de la salle de cinéma, fut celle consacrée à l’un des films américains les plus rares et les plus précieux, que l’on désespère encore de voir un jour édité en DVD et Blu-Ray (que l’on se rassure, c’est prévu pour très bientôt) et auquel Nicolas Boukhrief aura choisi de rendre hommage pour clore sa carte blanche. Film maudit dans la carrière de William Friedkin, marqué par un rejet critique absolu en France (certains journalistes refusant l’existence d’un remake de Clouzot) et un bide encore aujourd’hui légendaire de l’autre côté de l’Atlantique (la sortie de Star Wars le même jour avait rapidement fait de solder le destin tragique du film en salles), Le convoi de la peur est l’exemple typique du chef-d’oeuvre furieux et méconnu, traversant l’inconscient cinéphile depuis sa création tout en retrouvant peu à peu l’aura qu’il aurait toujours dû obtenir. On parlait donc d’un remake du Salaire de la peur, mais Friedkin en reprend le concept de base (quatre hommes tenter de convoyer plusieurs kilos de nitroglycérine à travers une jungle hostile et gorgée d’obstacles) pour s’attacher à des personnages gorgés de contradictions, dont il explore chaque nuance avec un souci du détail quasi inédit. Pour ce faire, il élabore une ouverture en trois temps qui fait la lumière sur le passé des protagonistes, tous condamnés à fuir leur pays pour des motifs différents : un banquier parisien (Bruno Cremer) menacé de prison pour cause de fraude boursière, un escroc new-yorkais (Roy Scheider) recherché par des truands à la suite d’un braquage raté, un terroriste palestinien (Amidou) poursuivi par la police internationale. Réfugiés dans un bidonville sordide, tous tentent alors de survivre en travaillant dans une raffinerie de pétrole au fin fond de l’Amérique du Sud. Jusqu’au jour où l’opportunité de s’enfuir avec une grosse somme d’argent s’offre à eux s’ils acceptent un travail considéré comme risqué. Ils ne savent pas encore à quel point…
Scénarisé par le légendaire Walon Green (à qui l’on devait le script de La horde sauvage), Le convoi de la peur fait preuve d’un respect tout aussi évident envers le film de Clouzot comme envers le roman original de Georges Arnaud. Mais il n’est en rien un remake insipide ou un décalque opportuniste, se contentant de reprendre bêtement un concept déjà exploré par un cinéaste réputé. Pour la petite histoire, Friedkin avait lui-même obtenu la bénédiction de Clouzot, ce dernier ayant été à l’époque très impressionné par French Connection. Mais si ce film réussit en tous points à surpasser son modèle, c’est justement en raison de la différence d’approche du scénario rédigé par Green, optant davantage pour un récit éminemment symbolique, élaboré d’un bout à l’autre comme une pure épopée mentale au cœur d’un environnement furieux faisant crouler ses personnages sous le poids d’un destin maléfique (le fameux terme « sorcerer » du titre original) qui n’a de cesse que de les écraser et les pousser à se mettre en danger. De son introduction calme qui expose l’origine des protagonistes avec une tranquillité trompeuse (un leurre malicieux qui n’étonne plus de la part d’un type aussi roublard que Friedkin) jusqu’à leur réunion fatidique qui les conduira à se transcender par l’entraide, le scénario exemplaire du film supprime l’image du héros hollywoodien au profit d’êtres complexes, imparfaits (« Personne n’est quelque chose et rien de plus », entend-on à un moment), parfois lâches et cupides, pions manipulés par un deus ex machina qui leur expédie ses forces destructrices par l’intermédiaire d’une nature hostile. La scène du pont suspendu, considérée encore aujourd’hui (et à très juste titre !) comme l’une des plus démentielles jamais vues au cinéma, pousse cette idée à son paroxysme : un chaos primitif et incontrôlable qui fait autant écho à leur désordre intérieur qu’à leur perte totale de repères. La sueur, la souffrance, la trouille, la violence, la folie, l’épuisement : chaque élément filmé par Friedkin, associé à l’hallucinant score de Tangerine Dream, participe au rarissime pouvoir d’hypnose déployé par le film. Si l’on n’ira pas forcément dire qu’il s’agit du meilleur film de son cinéaste (on lui préfèrera largement Bug), ce chef-d’œuvre monumental marque en tout cas une rupture symbolique entre deux époques, dont l’une n’a décidément pas fini de nous manquer.

BAD TASTE
Peter Jackson – Nouvelle-Zélande – 1987 – Cabinet de curiosités
Ce n’est jamais facile de parler de Bad Taste : d’un côté, on a envie de se poiler de rire devant ce qui s’apparente à un gros portnawak à peu près aussi bricolé que les nanars de Bruno Mattei, et d’un autre côté, le simple fait de savoir que le tournage s’est étalé sur quatre ans, sous l’impulsion d’un jeune cinéaste précoce déterminé à rendre hommage au cinéma de genre, suffit amplement à forcer le respect lorsque l’on revoit le résultat. Car, oui, loin de n’être qu’une série de pompages grotesques orchestrée par un tâcheron opportuniste, le premier film de Peter Jackson lorgne clairement du côté de la parodie assumée, narrant le combat d’une bande de potes armés contre une invasion extraterrestre destinée à transformer la Terre en fast-food géant. Un film qui fut tourné en grande partie dans le village natal du réalisateur, financé pour un budget défiant toute concurrence, bricolé de A à Z pendant le temps libre de son équipe technique, incarné par une dizaine d’acteurs (dont certains, y compris Jackson, iront jusqu’à jouer plusieurs rôles) et réalisé avec un sens aigu de l’amateurisme. Si l’on ajoute à cela que le doublage en VF (devenu culte) est à hurler de rire, on ne mettra pas bien longtemps à comprendre que ce festival de mauvais goût n’a pour seule ambition que d’en faire des caisses dans l’outrance, le délire et la décontraction. Pourtant, au-delà d’une mise en scène absolument pas maîtrisée, Bad Taste fait tout de même preuve d’une vraie inventivité au sein de tous les postes décisionnaires : outre des maquillages d’extraterrestres à base de moulages étrangement crédibles et un sens du montage assez bluffant si l’on en juge par le nombre d’années qui séparent parfois deux plans (pour info, dans une scène, Jackson torture un personnage également joué par lui !), cette farce ultra-gore vaut surtout pour ses effets spéciaux sanglants qui, à force d’être aussi exagérés et délirants (le dernier du film, où un humain pénètre dans le crâne d’un alien et s’en extirpe par l’anus, vaut son pesant de cacahuètes !), orientent le film du côté du slapstick décomplexé et dédramatise la sensation de dégoût qu’un tel déferlement de gore craspec serait sensé provoquer. En cela, cette curiosité mérite amplement l’admiration des cinéphiles, ne serait-ce aussi que pour les progrès hallucinants dont Peter Jackson fera preuve dans ses films suivants.

REQUIEM POUR UN MASSACRE
Elem Klimov – Russie – 1987 – Cabinet de curiosités
Avant, on croit avoir tout vu en matière de film de guerre, abonné à l’hyperréalisme du Soldat Ryan et aux oeuvres patriotiques avec John Wayne, sans oublier les innombrables documentaires sur les horreurs des conflits dans le monde. Après, d’un seul coup, on fait beaucoup moins le malin. On ne peut plus prononcer un seul mot. On est sonné, étourdi, dévasté, anéanti, un peu comme si l’on venait de subir un terrible retournement de cortex. Traduction : découvrir pour la première fois Requiem pour un massacre fait l’effet d’une date importante dans le parcours de tout cinéphile, et le revoir sur grand écran permet d’en mesurer pleinement l’importance considérable dans l’histoire du cinéma. Ce qui peut se décrire sans la moindre hésitation comme le film de guerre le plus important jamais réalisé reste pourtant une oeuvre encore trop méconnue, réalisée en 1987 par le cinéaste russe Elem Klimov, lequel n’avait que neuf ans lorsqu’il a dû s’enfuir de Stalingrad ravagée par l’armée allemande. On peut donc supposer que jamais il n’aurait atteint un tel réalisme dans le tableau de l’extermination des villages biélorusses si ces propres yeux d’enfant n’avaient pas vu toutes ces atrocités. Le jeune héros du film, Floria, engagé chez les partisans et confronté aux pires horreurs de la guerre, c’est évidemment lui-même : un jeune garçon qui traverse l’enfer scène après scène jusqu’à changer physiquement (dans les dernières scènes du film, son visage ridé et dévasté ressemble presque à celui d’un vieillard), voyant alors son innocence s’écrouler sous le poids de la monstruosité. Le spectateur, littéralement assommé par cette assaut de violence, vit les mêmes événements tout au long d’une mise en scène intense et subjective dont aucun autre cinéaste n’a su à ce jour retranscrire toute la fureur.
La puissance traumatisante du film, encore aujourd’hui impossible à égaler, découle de partis pris quasi kubrickiens qui font vivre la guerre à travers le regard malmené d’un adolescent, passant des plaisirs de la vie aux pires souffrances imaginables, le tout retranscrit avec une virtuosité littéralement insensée (le film a été entièrement tourné en SteadyCam). Du coup, pour ausculter toute la barbarie de l’être humain, Klimov élabore une mise en scène impressionnante de bout en bout, associée à un travail expérimental sur la bande-son, connectant ainsi le spectateur sur les perceptions sensorielles du héros. L’autre grande audace réside dans la sidérante maîtrise du hors-champ, en particulier lorsqu’il s’agit de dénoncer par l’image les atrocités hitlériennes : de ce plan inoubliable où le jeune héros ne voit même pas le charnier où suintent les cadavres de sa famille assassinée (à l’inverse de la jeune fille angélique qui l’accompagne) jusqu’à ces quarante minutes insoutenables sur le massacre de paysans immolés avec leurs propres enfants dans une église transformée en prison de feu, jamais la caméra de Klimov ne dérape sur l’obscénité de ces horreurs ni ne cède au manichéisme facile, sans pour autant limiter son ardeur à ne rien dissimuler. On le sent clairement désireux d’avoir mis toutes ses tripes dans ce film (le dernier qu’il ait réalisé), dans cette juxtaposition de purs blocs de fureur et de scènes viscérales, qui fait monter la compassion et l’humanisme du spectateur vers un Everest insoupçonné. Tout passe par des regards en gros plan qui en disent mille fois plus qu’un dialogue, par des sons et des hurlements qui hantent chaque recoin de la bande-son pour ne plus jamais nous quitter, par des paysages mortifères peu à peu envahis par une brume dans laquelle l’être humain s’est égaré à tout jamais, et par une mise en scène proprement géniale qui ne cache rien de l’horreur tout en suggérant toujours le pire. Jusqu’à une scène finale inouïe où Floria tire mécaniquement sur un portrait d’Hitler : le montage opère alors un rembobinage de l’Histoire jusqu’à superposer le regard dévasté de Floria avec une photo du dictateur encore enfant. Signification double : tirer sur Hitler revient à tuer le monstre qui réside en chacun de nous, mais vu que Floria cesse de tirer lorsque survient cette photo, on y verra l’image de l’enfant comme vecteur d’espoir si tant est que celui-ci choisisse de ne pas prendre le mauvais chemin. Au vu de cette déchirante leçon d’humanisme, on dira simplement que ne pas voir ce chef-d’œuvre au moins une fois dans sa vie serait proprement honteux. Quoiqu’il arrive, vous n’en reviendrez jamais indemne.

GODS AND MONSTERS
Bill Condon – Etats-Unis – 1998 – Cabinet de curiosités
Auréolé de l’Oscar de la meilleure adaptation en 1999 et pourtant jamais sorti en salles dans l’Hexagone (on se demande encore pourquoi !), Gods and Monsters n’est pas à proprement parler un biopic hollywoodien dans le sens où on l’entend. Construit autour de la personnalité complexe de James Whale, réalisateur pour les studios Universal de Frankenstein et de sa suite, le film de Bill Condon tient davantage d’une pure oeuvre de fiction, s’inspirant de certains éléments réels de la vie du cinéaste pour construire un récit plus orienté, où la thématique d’une œuvre culte finit par déborder sur le quotidien de son créateur. Le mythe de Frankenstein constituant déjà un vivier inépuisable d’interprétations sur la création et l’obsession engendrée par celle-ci, il n’en fallait pas moins à Condon pour se focaliser sur la fascination ambigue de Whale (Ian McKellen dans le meilleur rôle de sa carrière) pour son jeune jardinier Clay Boone (Brendan Fraser, à peine remis du succès de George de la Jungle). Une relation au sous-texte homosexuel très clairement affirmé qui, de confidences douloureuses en flashbacks successifs, viendra appuyer la relation vieillissante d’un créateur avec sa « créature », voyant celle-ci échapper peu à peu à son emprise pour prendre son envol loin, très loin de son Pygmalion. Les dieux et les monstres du titre, ce sont autant les deux protagonistes que ceux qui se reflètent dans les extraits du film Frankenstein, sauf que les apparences finissent par se brouiller : tout au long de cette relation où la fascination se mêle au besoin vital de prendre l’ascendant sur l’autre, le personnage cérébral de Whale finit par se reconnaître dans ce monstre auquel il a jadis donné vie au cinéma, sorte de freak qui ne s’accepte pas forcément tel quel et condamné à rester enfermé dans son image. Il en est de même pour son jardinier, qui, lors d’une superbe scène finale, assume clairement son statut de « créature » en reproduisant les gestes du monstre qui l’a tant marqué sur grand écran. Cet aller-retour permanent entre réalité, fiction et fantasme fait tout le sel de ce film simple et touchant, plus complexe qu’il n’y parait, dont l’invisibilité sonne comme une terrible injustice. Depuis, Bill Condon est tombé bien bas, puisqu’il a signé les deux derniers épisodes de la saga Twilight… Oui, je sais, ça fait mal de le savoir…

SAVE THE GREEN PLANET
Jeong Jun-hwan – Corée du Sud – 2003 – Cabinet de curiosités
Si l’on peut reprocher quelque chose à nos amis sud-coréens, c’est d’avoir bâti leur récente industrie cinématographique sur la volonté de tenter un peu tout et n’importe quoi, d’embraser tous les genres sans forcément les maîtriser, et de chercher parfois à reprendre les ficelles du cinéma américain par pur souci d’engranger de la thune facile sans trop se fouler les neurones. Et au beau milieu d’un océan de nanars prétentieux avaient alors réussi à surnager quelques uppercuts signés Bong Joon-ho ou Park Chan-wook, paradoxalement les seuls à flatter les festivaliers et à bénéficier donc d’une large couverture médiatique. Du coup, en creusant davantage, on pouvait parfois tomber sur des ovnis complètement lézardés de la cafetière dont Save the Green Planet reste peut-être le fer de lance. Sorte de rollercoaster totalement improbable, passant d’un genre à l’autre avec une dextérité hallucinante, le film de Jeong Jun-hwan constitue donc une alternative originale qui cherche d’abord à faire mine de partir dans tous les sens pour mieux scier le cortex de son spectateur lors de son final ubuesque lorsque le véritable propos du film se voit soudain clarifié. Pour schématiser, disons que ce gros portnawak part d’un kidnapping insensé, celui d’un homme d’affaires richissime que son kidnappeur timide et parano (également l’un de ses anciens employés) soupçonne d’être un extraterrestre planifiant en secret la destruction imminente de la Terre ! Mais ce pitch frappadingue, d’autant plus absurde qu’il s’étoffe de personnages bien déjantés (dont une complice débile et un inspecteur déchu réduit à faire la cuisine pour ses supérieurs) et d’idées de gags qui le sont autant (on en apprend beaucoup sur les ingrédients d’une crème de massage !), ne réussit pas pour autant à dissimuler son véritable propos : les cinéphiles habitués à ne voir dans ce genre de portnawak qu’une mise en bouche préparant à quelque chose de surprenant ne mettront pas moins d’une demi-heure pour deviner le twist final, lequel fait vriller alors le thriller comico-horrifique vers de la science-fiction quasi comic-book. Malgré tout, ces audaces narratives n’entachent en rien la cohérence du film, certes zébré ici et là de quelques hommages appuyés à Maniac, Reservoir Dogs ou 2001 : l’odyssée de l’espace, mais profondément intègre dans ses velléités humanistes comme dans son traitement d’un sujet plus sérieux qu’il n’y parait. Aussi inclassable que fortement recommandable, donc.

HENRY : PORTRAIT OF A SERIAL-KILLER
John McNaughton – Etats-Unis – 1986 – Midnight Movies
Dans une scène de son film Journal intime, cet insupportable narcissique de Nanni Moretti (dont on connait l’aversion pour les films violents) se rendait dans une salle de cinéma pour y découvrir le film de John McNaughton. On le montrait alors en train de regarder un court extrait violent du film, puis sortir de la projection à la fin du film en se demandant comment un critique de cinéma pouvait faire une critique positive d’un tel film. On avait juste envie de lui rappeler trois choses qu’il n’avait pas l’air d’avoir compris (ou qu’il se refusait peut-être à admettre) : d’abord que Henry n’est en rien un film flattant la barbarie la plus innommable, ensuite que la violence y est généralement suggérée par la bande-son à l’exception de trois scènes assez frontales (dont celle qu’il montrait dans son film), enfin que Les Cahiers du Cinéma avaient à l’époque fortement défendu le film. Contre toute attente, le film de John McNaughton fut l’un des rares films d’exploitation sur l’errance du serial-killer à avoir obtenu une vraie reconnaissance critique. Ce qui n’est pas surprenant du tout, tant le talent de ce jeune cinéaste (à qui l’on devra plus tard le très bandant Sexcrimes) réside dans un mélange hyper maîtrisé de réalisme quasi documentaire et de refus absolu du racolage. Focalisée sur son protagoniste, inspiré du terrible serial-killer Henry Lee Lucas, dont l’allure de jeune homme bien sous tous rapports cache un esprit malade (martyrisé durant son enfance par sa propre famille) qui le condamne à se libérer de ses démons dans une terrible folie meurtrière, la mise en scène se contente de suivre son errance d’un bout à l’autre du récit tout en passant sous silence l’acte criminel pour n’en filmer au final que le résultat, dans des plans d’une rare authenticité où seuls le montage et la bande-son sont vecteurs d’angoisse. Son amour naissant pour la sœur de son acolyte Otis (en compagnie duquel il commet chacun de ses meurtres) semble être un premier pas pour lui vers une éventuelle rédemption, mais ce ne sera hélas qu’une fausse piste. Glaçant et puissant dans l’atmosphère malsaine qu’il dégage, exemplaire dans son propos et réalisé avec une vraie intelligence du découpage, Henry méritait bien de rejoindre le Maniac de William Lustig au Panthéon des meilleurs films de serial-killer des années 80.
.jpg)
ASSASSIN(S)
Mathieu Kassovitz – France – 1997 – Séance débat
« Toute société a les crimes qu’elle mérite » : l’accroche du film a le mérite d’être claire. Comme les médias nationaux n’ont pas manqué de se sentir visés par l’attaque portée par le film, le torpillage du film ne s’est pas fait attendre lors de la présentation du film au festival de Cannes en 1997. Et si l’on cherche les raisons qui ont poussé Mathieu Kassovitz, encore auréolé en 1997 du succès de La haine, à cracher sa haine du système de façon aussi enragée, on pourrait croire à un film conçu « en réaction ». Ce n’est pourtant qu’à moitié vrai : certes, la projection de La haine au festival de Cannes s’était accompagnée d’une polémique relayée par des médias champions de l’amalgame (ce qui avait à l’époque bien irrité le cinéaste), mais il faut surtout voir dans Assassin(s) moins le cri d’un cinéaste en colère contre le monde d’aujourd’hui qu’un film fataliste et profondément hybride sur la transmission de la violence à tous les niveaux de la société (le pluriel du titre n’est pas anodin). Dans cette histoire tragique d’un vieil assassin déterminé à passer successivement le flambeau à deux jeunes de banlieue, le système médiatique est la première cible intégrée dans la visée du sniper Kassovitz : une télévision devenue une pompe à merde irrécupérable où végètent des films saucissonnés, des jeux télévisés humiliants et des leurres publicitaires, tandis que la nouvelle génération, sans perspective d’avenir, s’enferme dans sa bulle en zappant d’une chaîne à l’autre tout en se gavant de fausses illusions. A l’intérieur, la colère gronde. A l’extérieur, la société n’est qu’un territoire urbain aux teintures aussi grisâtres que déprimantes, une vie de merde sans espoir et sans couleur.
Antithèse absolue d’un film aimable, Assassin(s) bâtit donc sa colère au travers d’une attitude agressive et presque inconsciente. Ce qui aurait pu constituer une vraie maladresse forme ici au contraire une singularité, tant narrative que visuelle, que Kassovitz prend soin de pousser dans ses ultimes retranchements : d’un bout à l’autre, le film se révèle ouvertement maladroit, conçu dans l’urgence (le tournage débuta avec un scénario inachevé, coécrit avec Nicolas Boukhrief) en bâtissant son hybridation à grands coups de marteau, comme si la construction bizarroïde du film (narration trouée de partout, plans d’une lenteur millimétrée, flashs stroboscopiques, intrusion soudaine de programmes télé durant le montage, etc…) visait à refléter la vacuité répugnante de ce que le film est censé illustrer. Kassovitz va d’ailleurs beaucoup plus loin en mettant en parallèle l’acte de « tuer » avec le phénomène de « zapping » (recherchez le sens de l’éthymologie anglaise du verbe « to zap »), en reflétant le nihilisme du monde contemporain par la confrontation entre un quotidien qui pourrit à vue d’œil et un tube cathodique qui vend du rêve à gogo, et surtout, en brisant la cohérence de sa mise en scène par des ruptures de ton permanentes. Moins film sur la violence en action qu’œuvre qui l’interpelle comme excroissance de la solitude de l’homme moderne, où le médium télé abreuve ses spectateurs d’images sans finalité jusqu’à les transformer en robots carburant aux pulsions de l’instant, Assassin(s) rejoint l’aspect expérimental et métatextuel d’un film comme Tueurs-nés, mais avec un style plus glacial et infiniment moins satirique que celui du film d’Oliver Stone. Il constitue pour cela un film indispensable sur l’errance des générations, à travers lequel Mathieu Kassovitz aura pris le risque de foncer tête baissée vers sa cible avant de tendre la joue pour en récolter la violence brutale. Précisément celle qu’il souhaitait stigmatiser. Le risque était payant. Le film, lui, continue de déranger, et c’est tant mieux.
>>> Lire notre analyse du film

DRAGON GATE, LA LEGENDE DES SABRES VOLANTS
Tsui Hark – Chine – 2011 – Séance de clôture
Condamné à sortir directement en DVD et Blu-Ray sans passer par la case cinéma, Dragon Gate eut la chance d’être projeté en séance de clôture du festival dans l’état voulu par le cinéaste, à savoir une projection en relief 3D. Malgré tout, la découverte de ce film prouve à quel point Tsui Hark, depuis sa résurrection flamboyante avec le génial Seven Swords, n’a clairement pas fini de tourner en rond dans sa façon d’aborder un genre précis (le wu xia pian) comme dans ses désirs d’expérimentation. Le redite se fait clairement ressentir avec cette énième histoire prévisible d’un groupe de rebelles préparant la riposte contre un eunuque sanguinaire qui fait régner la terreur sur une Chine au crépuscule de la dynastie Ming. Scénario rebattu tant de fois par le cinéma de Hong Kong au cours des vingt dernières années (John Woo l’avait même amené vers son zénith avec Les trois Royaumes), tant est si bien qu’on finit par s’épuiser de devoir se refarcir à nouveau les mêmes thématiques sur l’honneur et l’entraide, les mêmes approches de l’art martial comme vecteur d’envolées lyriques, les mêmes enjeux manichéens dont on perçoit l’issue au bout d’un quart d’heure. Même le style révolutionnaire de Tsui Hark, bien que récemment handicapé par un Detective Dee en demi-teinte, n’arrive pas ici à s’extraire d’un canevas aussi convenu, empêtré dans un script qui s’embrouille pas mal à force de multiplier les personnages et qui centre toute son action dans un cadre de western exotique où, coincés dans une auberge paumée en pleine tempête du désert, les personnages élaborent une énorme valse des identités et des apparences en jouant comme dans un vieux théâtre de boulevard. S’ensuit heureusement une dernière demi-heure trépidante, où Hark renoue in fine avec les idées de mise en scène qui ont fait sa renommée, multipliant les scènes d’action au cœur d’un décor à la Indiana Jones et signant du même coup ses retrouvailles avec Jet Li, longtemps après s’être brouillé avec lui sur le tournage d’Il était une fois en Chine 3. Pour autant, le résultat reste une déception assez relative, la faute à une mise en scène qui ne transcende jamais la notion de chaos développée dans les meilleurs films du cinéaste (The Blade et Time and tide en tête). Peut-être est-il grand temps pour ce cinéaste majeur de changer de registre et de passer à autre chose.
Suite à la projection du film, un débat a été organisé en présence du coscénariste Nicolas Boukhrief. Pour information, les déclarations ci-dessous sont avant tout une retranscription des différentes réponses qui ont été posées durant ce débat, et afin de ne pas rendre leur lecture trop difficile, nous avons souhaité les réunir sous des points thématiques directement reliés au film.

Une genèse infernale
Cela faisait un moment que je n’avais pas vu le film, à vrai dire, et le revoir sur grand écran m’a fait très plaisir. Mais d’un autre côté, même si je trouve le film vraiment impressionnant en terme de mise en scène (il y a encore des idées de plans conçus par Kassovitz qui me sidèrent), je souffre aussi beaucoup en le revoyant. A cause de ce que le film est à l’arrivée par rapport à ce qui était prévu au départ et à cause du souvenir du tournage qui fut proprement infernal (surtout pour son réalisateur). Les problèmes ont commencé lorsque Kassovitz et le producteur Christophe Rossignon ont voulu à tout prix Michel Serrault pour le rôle principal. Comme il tournait énormément à l’époque, il n’était libre que dans une période de temps très précise. Du coup, on a commencé à écrire le scénario avec une date de tournage déjà fixée, et plus cette date approchait, plus je sentais que le scénario n’était pas encore totalement prêt. Mais comme c’était Serrault ou rien (sachant que le financement avait été décidé en fonction de lui), le film est parti en tournage avec un manque de temps évident, aussi bien pour le scénario qu’en préparation, et les retards se sont ensuite reportés sur les repérages et sur le tournage. Là-dessus, au bout de dix jours de tournage, Kassovitz s’est arrêté, conscient qu’il était en train de courir après son propre film, et m’a demandé de venir sur le plateau pour mettre en forme le scénario pendant le tournage, afin d’y apporter des changements et des évolutions. Il sentait déjà que la matière était encore un peu molle ou imprécise et que l’on pouvait prendre des raccourcis pour s’en sortir.
Ainsi donc, je me suis mis à suivre tout le tournage en scénariste-observateur, J’ai pu ainsi me rendre compte qu’une certaine tension a commencé à naître sur le tournage, non seulement entre Mathieu et son équipe (parce qu’il montait d’une marche par rapport à La haine en terme d’ambition et de mise en scène et que les techniciens avec lesquels il avait tourné ses films précédents avaient parfois du mal à le suivre) mais aussi avec Michel Serrault : celui-ci commençait à être très impliqué dans son personnage, il se comportait de façon très dure sur le plateau, il commençait à avoir quelques problèmes de mémoire (donc il fallait parfois des cartons pour qu’il récite son texte), et du coup, c’était souvent très dur pour Mathieu de lui donner la réplique. Il en fut de même avec le jeune acteur Mehdi Benoufa, qui n’avait jamais fait de film avant, qui n’en a même jamais fait après et qui, bien que très touchant, était parfois maladroit dans son jeu. Bref, peu à peu, le tournage s’est interrompu à peu près toutes les trois semaines : on avait des arrêts de plusieurs jours pour que Mathieu puisse reprendre des forces et imaginer ce qu’il allait filmer par la suite. Sans compter le fait que Kassovitz était devenu persona non grata auprès de tous les quartiers bourgeois de Paris à cause de La haine et que certains décors s’avéraient extrêmement difficiles à trouver, les mairies refusant les autorisations. Le tournage de certaines scènes a dû être déplacé dans d’autres villes (dont Lyon), ce qui fait que le temps de travail et d’écriture a littéralement explosé.
Le massacre cannois
Au bout du compte, une fois que tout ce tournage (passionnant pour moi, mais violent et douloureux pour Kassovitz) s’est terminé, le film a été frappé d’une maladie qui tombe souvent sur le cinéma français (et pas que sur lui, d’ailleurs) depuis très longtemps : le Festival de Cannes. En effet, l’obsession pour les distributeurs et les producteurs, c’est de vendre et faire parler de leur film, ce qu’un festival comme Cannes facilite énormément, et encore plus si vous obtenez un prix. Donc, on a eu une nouvelle date limite qui a été fixée et qui a donc poussé Mathieu à foncer tête baissée dans le montage sans trop de recul. Le film tel qu’il existe aujourd’hui ne correspond pas forcément à ce qu’on pourrait appeler une « copie de travail », mais je considère qu’il ne s’agit clairement pas du montage définitif. Pour tout dire, il y a plein de coupes que je repère désormais dans le film et que Mathieu aurait sans doute effectuées autrement s’il avait eu plus de temps. Du coup, le film a été monté dans l’urgence par un cinéaste épuisé, et tout ça s’est retrouvé ensuite à Cannes ou cela a été véritablement un massacre. Il faut dire qu’il y avait là-bas très peu de cinéphiles mais énormément de médias et de journalistes, et le film s’est fait siffler pendant un quart d’heure par la presse lors de sa projection. Comme je le disais à Mathieu « en même temps, montrer ce film à Cannes, c’est comme montrer La haine à un parterre de flics ». Adjani était cette année la présidente du jury et avait dit dès le départ « Je ne donnerai aucun prix à un film violent, je déteste la violence au cinéma ». Et c’est quand même l’actrice de Possession qui disait ça ! (rires) La sélection était d’ailleurs très violente cette année-là (il y avait Funny Games de Haneke qui était lui aussi projeté en compétition), et Adjani a finalement tenu parole puisqu’elle a donné la Palme d’Or au Goût de la cerise de Kiarostami (qui, par ailleurs, est un très beau film).
Le massacre par la presse a été unanime, c’était 100% de mauvaises critiques. A vrai dire, on a eu une seule bonne critique de la part de Jean-Luc Hees (aujourd’hui patron de Radio France) qui nous avait reçus dans son émission de France Inter pour nous dire qu’il avait bien aimé le film et qu’il se sentait seul contre tous (ce qui était vrai). Globalement, le film a été considéré comme hyper lourd, hyper chiant, hyper nul. Mais il n’y avait pas vraiment d’argumentations. Le plus fort a été la critique du Figaro qui se limitait à dire « C’est probablement le film le plus nul de l’histoire du cinéma français ! ». Je pense que les gens de la presse avaient envie de « se faire le film ». Du coup, Kassovitz en est sorti déprimé, puis un peu cynique dans la façon dont il a appréhendé la suite de sa carrière pendant quelques temps. Je suis certain que si Assassin(s) avait été un tout petit peu mieux reçu, il n’aurait pas mis quinze ans pour faire un film comme L’ordre et la morale. Des fois, les films changent malheureusement le destin de leur metteur en scène. A l’époque, ça a été un tel rejet qu’il s’est dit « Plus jamais ! », et il lui a fallu quinze ans pour revenir à ce type de films, à la fois brillamment mis en scène, mais avec sans doute plus de fond que dans Gothika ou Les rivières pourpres, même si ces derniers ne sont pas sans qualités formelles.
Une tension qui a nourri l’énergie du film
La tension accumulée sur le tournage s’est clairement répercutée sur le film. Mais vu la vision très forte et ambitieuse qu’avait Mathieu de son film, je ne suis pas sûr que le film aurait perdu en violence si le plateau avait été moins tendu et la mise en chantier du film plus apaisée. D’autant qu’avec la tension qui régnait sur le plateau, l’équipe se mettait à faire de grosses erreurs à cause d’une paranoïa qui commençait à s’installer chez tout le monde. L’accident la plus grave par exemple, c’est quand la BMW que vous avez vue exploser dans le film a d’abord explosé pendant une répétition, sans que la caméra tourne. Ni que cela soit prévu. Par miracle, personne ne se trouvait à côté sinon la personne aurait été totalement déchiquetée.
Un film contre les médias… mais fait avec l’aide des médias ?
Il y a eu deux personnes qui ont réagi très bizarrement sur ce film. Le premier, ça a été Nagui, qui a tenté de faire interdire le film. Au départ, il était très content, mais après, il a eu vent du projet véritable de Mathieu, il a donc demandé à voir la séquence où son émission apparaissait et, par la suite, il a tout fait pour faire interdire le film, ce qui était impossible étant donné que les autorisations avaient déjà été signées. Quant à Patrick Poivre d’Arvor, on était totalement persuadé qu’il refuserait étant donné la morale du film, et contre toute attente, il était absolument ravi. Je pense qu’il était tellement flatté narcissiquement que je suis sûr qu’il aurait accepté de jouer dans un porno si Kassovitz lui avait proposé. Mathieu est parti tourner la scène dans les locaux de TF1, et il en est revenu complètement halluciné en se disant qu’il s’était peut-être fait avoir, vu que PPDA l’avait accueilli chaleureusement, lui avait même offert le champagne, etc… Il était visiblement très heureux de tourner au cinéma.
Un récit d’anticipation sur les dérives de la société ?
Je crois que ce que Mathieu voulait dire, c’est que trop d’images zappées en permanence finissent par aveugler les gens, par couper la pensée et par empêcher la notion de culture. Tout le propos du film part de cette idée. C’est ce qui se passe aujourd’hui avec la culture du Net, où il n’y a plus de longue durée. J’étais moi-même un grand zappeur autrefois, et j’ai fini par me rendre compte que le zapping ne m’apportait rien. Par ailleurs, quand j’ai travaillé sur Alzheimer pour un film que je devais faire (Cortex), j’ai constaté que les médecins commençaient à s’interroger clairement sur le rapport de la télévision avec la mémoire, et comment quelqu’un qui regarde Les feux de l’amour (qui est un feuilleton sans fin) finissait par ne plus avoir aucune mémoire de ce qu’il regarde, allant même jusqu’à ne plus être capable de raconter ce qui s’était passé dans un épisode diffusé il y a six mois. Pour ces médecins, cette notion du zapping finirait par « grignoter » la mémoire, et c’est vrai que si l’on passe une soirée entière à zapper et qu’on va ensuite se coucher, le lendemain matin, on se rappelle à peine de trois images alors que ça nous a pris une heure de pensée. Donc, Mathieu et moi étions clairement sur cette réflexion-là, mais je ne sais toujours pas si elle est pertinente ou pas.
Ce qui était sûr, c’est que je rejoignais son propos à partir du moment où il était établi qu’on ne mette pas d’images de films… Bon, au final, il y en a une seule qui existe dans le film, un petit hommage : il s’agit d’une image du film Maniac de William Lustig, et ce dernier avait accepté de donner gratuitement une image de son film en échange d’une visite sur le plateau. Mais pour le reste, il ne devait y avoir dans ce film que des images non signées, puisque ce qu’on se tape à longueur de temps lorsqu’on zappe à la télé ou sur le Net sont des images qui ne sont pas signées. Ce n’est pas un message envoyé par quelqu’un qui pense, c’est juste de l’anti-communication. De ce point de vue-là, le film évoque presque un récit d’anticipation, même si, par moments, j’ai quand même l’impression aujourd’hui que le propos du film se prend un peu les pieds dans le tapis. Là encore, un peu plus de temps pour le scénario nous aurait sans doute permis d’affuter le propos.
Un film actuel ?
Je pense aujourd’hui que le film est plus actuel qu’il ne l’était au moment de sa sortie. Même si ça n’a strictement rien à voir avec l’affaire Mohammed Merah, cette idée d’un enfant qui part en vrille et se met à buter tout le monde dans une confusion totale à l’entrée d’un collège est très actuelle. A l’époque de la sortie du film, on s’était fait traiter de « fachos apocalyptiques » et certains ont même dit que le film exigeait de mettre des flics devant chaque entrée d’école ! Les réactions étaient donc très énervées, y compris auprès des médias, puisque Mathieu avait refusé de se prêter au jeu des interviews. Je me souviens du rédacteur en chef de Première qui était furieux de voir telle attitude, puisqu’il considérait que c’était grâce à son journal que La haine avait été un succès en salles. Du coup, ils se sont vengés sur lui. Après, pour revenir au festival de Cannes, il y a toujours deux possibilités quand un film est fini à la bourre pour passer en sélection : soit le film sort bien après le festival comme ce fut le cas pour Apocalypse now, ce qui fait de Cannes une gigantesque preview sur le film qui permet ensuite de changer le montage en fonction des réactions, soit le film sort en même temps que le festival (ce qui a été le cas d’Assassin(s)), et là, ce n’est pas possible de revenir en arrière. Mais après, même si Kassovitz était effondré, j’étais tout de même un peu moins négatif : le film fait 2h20, on a donc une séance en moins par journée, il est interdit aux moins de 16 ans, il s’est fait totalement massacrer par la presse, et il fait 500 000 entrées ! Aujourd’hui, dans le contexte actuel de distribution des films, on sauterait presque de joie si l’on obtenait un score pareil pour un film comme celui-là.
La présence de Michel Serrault
Le personnage joué par Serrault était déjà décrit tel quel dans le court-métrage initial qu’avait réalisé Mathieu et qui correspondait à la fameuse scène du meurtre du vieil homme dans sa propre maison. Monsieur Wagner représente un peu la vieille France, artisanale, rance, poujadiste, celle qui a pris possession du pays. On voulait sentir aussi que le gars avait fait de l’épuration dans son passé, et dans le scénario, j’avais mis au départ une phrase que Mathieu n’a pas souhaité conserver pour des raisons personnelles, c’était « Moi, mon premier contrat, c’était un youpin en 1944 ». Au lieu d’utiliser ce terme, Mathieu a préféré mettre un « Mon premier contrat, c’était un coco ». Mais c’est vrai que Kassovitz voulait que le personnage soit malgré tout assez attachant, donc la caractérisation du personnage a quelque peu été modifiée. Il faut aussi préciser que, pour Mathieu, donner la réplique à Michel Serrault était l’occasion de jouer en face d’un monstre sacré. Par ailleurs, si par hasard Serrault avait refusé de faire le film, l’une des solutions de secours avait été d’envisager le rôle pour Claude Piéplu (ce qui aurait été super intéressant), et du coup, il y aurait aussi eu Gérald Thomassin (Le petit criminel) dans le rôle que tient finalement Kassovitz. Au départ, Serrault hésitait vraiment à jouer le rôle, il a beaucoup discuté avec Mathieu, et puis, une fois lancé sur le film, il n’a plus posé trop de questions, il a joué clairement le jeu de Mathieu, et même à Cannes, lors de la conférence de presse, il a fortement défendu le film et Mathieu face aux journalistes. Après, d’un point de vue humain, Michel Serrault était tout simplement détestable durant ce tournage. Il était parfois extrêmement dur avec les techniciens, mais sans doute était-ce parce qu’il était très impliqué dans son personnage. En tout cas, de mon point de vue, il n’a pas contribué à atténuer la tension qui régnait déjà sur le plateau.



