
“Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie” – Arthur C. Clarke
La citation est belle mais a un revers moins reluisant. Fasciné par les possibilités offertes par la technologie, l’auteur de 2001, L’Odyssée De L’Espace et Rendez-Vous Avec Rama oublie que la science a toujours eu à long terme l’optique de se généraliser. Développé par une poignée de personnes, la science va avoir pour but de servir au plus grand nombre jusqu’à sa banalisation la plus complète. Comment alors voir de la magie dans le miracle de la science tant celle-ci est désormais acquise et convenue ? S’exclame-t-on de surprise lorsqu’un interrupteur permet d’illuminer une pièce plongée dans l’obscurité ? Sommes-nous encore fascinés par ces moyens de communications nous permettant de joindre des personnes à l’autre bout du monde ? La réponse est clairement non car l’émerveillement ne peut être suscité que par quelque chose dépassant le cadre de notre quotidien. Par la banalisation, on perd complètement de vue les miracles mises à notre disposition. En soit, nous nous laissons abuser par cette exploitation à outrance de la technologie et nous ne sommes plus capables d’en reconnaître les bienfaits. Cette sur-utilisation donne lieu à des dégénérescences qui ne vont que nous faire oublier pourquoi cette science est bel et bien magique.
Il y a maintenant plus de vingt ans, plusieurs personnalités ont tenté d’offrir quelque chose de neuf au cinéma grâce à une nouvelle technologie : les CGI ou computer-generated imagery pour les néophytes. Aujourd’hui, les CGI ont envahi les blockbusters actuels à un tel point qu’on a l’impression que plus aucune autre technique de trucage ne prévaut. Les CGI sont utilisés pour tout et n’importe quoi. De toute façon, c’est bien ça le miracle de ces effets numériques : offrir aux réalisateurs une certaine liberté d’action. Comparés aux autres trucages, les CGI laissent en effet un champ de possibilités plus large. Les animatroniques sont des outils se mouvant à l’aide de machineries lourdes. Celles-ci ne doivent bien sûr pas apparaître dans le cadre, ce qui oblige le réalisateur à composer ses plans en conséquence. La stop motion et sa version perfectionnée, la go motion, sont des processus permettant de détourner ce problème mais l’intégration de ces éléments animés avec les images tournées n’est pas toujours heureuse et reste contraignante, notamment au niveau de la mobilité de la caméra. Par ailleurs, il est difficile de corriger une maquette ou un maquillage lorsque l’on se rend compte devant les rushes que le rendu ne fonctionne juste pas. Les CGI offrent la possibilité au réalisateur de composer sa mise en scène comme il l’entend (ou en tout cas avec bien moins de contraintes) et d’effectuer tous les correctifs qu’il jugera utiles en post-production. Autrement dit, toutes les créations de l’esprit de l’auteur semblent pouvoir se concrétiser. Malheureusement, en abusant sans plus se soucier de ce qu’ils servent à représenter, le cinéma actuel oublie trop souvent ce qu’implique un tel outil. Par conséquent, il n’est pas inutile de se replonger régulièrement dans Jurassic Park. Plus encore que les incursions précurseurs de James Cameron dans le domaine avec Abyss et Terminator 2, le film de Steven Spielberg restera le long-métrage phare qui aura popularisé la magie des CGI.
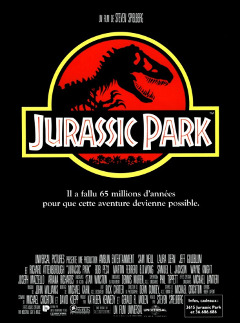
REALISATION : Steven Spielberg
PRODUCTION : Universal Pictures, Amblin Entertainment
AVEC : Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern, Richard Attenborough, Joseph Mazzello, Samuel L. Jackson…
SCENARIO : Michael Crichton, David Koepp
PHOTOGRAPHIE : Dean Cundey
MONTAGE : Michael Kahn
BANDE ORIGINALE : John Williams
ORIGINE : Etats-Unis
GENRE : Science-fiction, Aventure, Adaptation
DATE DE SORTIE : 20 octobre 1993
DUREE : 2h02
BANDE-ANNONCE
Synopsis : Ne pas réveiller le chat qui dort… C’est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler avant de se lancer dans le « clonage » de dinosaures. C’est à partir d’une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d’espèces de dinosaures. Il s’apprête maintenant avec la complicité du docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et de son amie Ellie, à ouvrir le plus grand parc à thème du monde. Mais c’était sans compter la cupidité et la malveillance de l’informaticien Dennis Nedry, et éventuellement des dinosaures, seuls maîtres sur l’île…
Il est d’ailleurs fascinant de mettre en parallèle le film avec le roman d’origine. La lecture de ce dernier permet en effet de voir clairement que Spielberg n’a gardé que ce qui l’intéressait dans le best-seller de Michael Crichton. Dans l’excellent making of du film (un des plus passionnants existants en la matière), Spielberg racontait comment Crichton lui a introduit le projet en évoquant “une histoire de dinosaures et d’ADN”. Par la manière dont il relate l’anecdote, il est évident que Spielberg a été scotché par le terme dinosaure et non ADN. De ce fait, le processus d’adaptation conduit à une séparation certaine entre les deux œuvres. Pour Crichton, Jurassic Park est avant tout une réflexion scientifique sur l’utilisation de la technologie moderne. Une modernité servant ironiquement à ressusciter un monde primitif qui, selon les préceptes du chaos, va reprendre ses droits sur la civilisation. Spielberg ne partage néanmoins pas les mêmes préoccupations que l’ancien étudiant en médecine reconverti en écrivain. Avec l’aide du scénariste David Koepp, il va ainsi se lancer dans une gigantesque épure du roman en réduisant le nombre de personnages (ou leur temps de présence à l’écran) et en resserrant drastiquement les enjeux (pas de danger autour de l’éventualité d’une évasion des sauriens). En brillant entertainer qu’il est, Spielberg va même nous amuser avec le discours ultra sérieux de Crichton.

Ainsi va-t-il utiliser un cartoon et un personnage purement comique (Mr. ADN) pour nous expliquer la technique de création des dinos. Quant à la théorie du chaos, elle trouvera son explication la plus poussée dans une séquence de drague entre Jeff Goldblum et Laura Dern. Dit comme cela, le film tiendrait de la vulgarisation bêtifiante du roman mais ces illustrations parmis les plus équivoques du long-métrage font partie d’un processus de construction en filigrane du discours. C’est d’ailleurs là une des grandes spécialités de Spielberg. Sous une couche de divertissement indolore pour l’intellect du spectateur, il laisse en effet sévir de véritables pistes de réflexion. Une technique opportune pour travailler directement sur l’inconscient de son audience même si celui-ci sera obligé de revoir le film avec un œil insensible pour la déceler. Car Spielberg a au bout du compte fait un film tout aussi riche que le roman. Ainsi, par exemple, un simple effet de montage (un clic sur une souris enchaîné avec un grondement de tonnerre) permet d’insérer le concept du chaos ou l’atterrissage d’un hélicoptère, dont la puissance des pales recouvre de poussières les fossiles déterrés, suffit à planter le rapport à la technologie des personnages.
Mais l’objectif premier de Spielberg reste tout autre néanmoins. Le fait qu’il ait changé en plein tournage la fin de son film est d’ailleurs équivoque en cela. La conclusion originale ne faisait en effet pas intervenir le T-Rex et jouait plus sur l’ironie du sujet. Alors que le vélociraptor est accroché à la nacelle où se sont réfugiés les survivants, le professeur Grant manœuvre celle-ci afin de fracasser le dinosaure contre le squelette du T-Rex exposé dans le grand hall. En bout de course, Grant arrivera à achever le bestiau en le coinçant à l’intérieur des mâchoires du prédateur décédé depuis des millions d’années. Une fin non dénué d’intérêt mais loin de la jubilation de celle qui fut retenue dans le produit final (l’arrivée fracassante du T-Rex dévorant les deux derniers raptors). Fasciné depuis son enfance par les dinosaures (la réplique de Grant à la découverte du tricératops est autobiographique), Spielberg veut en effet avant tout chercher à faire ressentir à son public la magie et l’horreur inhérentes à la vision de ces titans foulant à nouveau la Terre. Spielberg ne voulait pas un film de monstres mais un film d’animaux. En cela, Jurassic Park est une pure œuvre de cinéma. Le réalisateur de E.T aura recruté une cellule de professionnels afin d’envisager le meilleur moyen pour donner vie aux dinosaures. Cette cellule fut composée de Stan Winston, Dennis Muren et Phil Tippett. Chacun proposera ce que sa spécialité (animatroniques pour Winston, go-motion pour Tippett et CGI pour Muren) permet.

Malgré des tests assez concluants, Tippett devra se mettre en retrait face à ce qu’offre Muren. En effet, celui-ci, épaulé par Mark A.Z. Dippé (depuis tombé dans un trou noir après avoir réalisé l’infâme Spawn) et Steve Williams (également tombé dans un trou noir après avoir commis le tout aussi infâme The Wild), montre une technologie permettant une animation sans saccade et une parfaite intégration dans les images filmées. C’est là le cœur de la problématique de Spielberg qui, pour nous faire croire à la véracité de ces incroyables animaux, doit avoir la possibilité de les montrer dans l’état le plus naturel qui soit. Le spectateur ne doit pas se préoccuper des trucages et donc être capable de les détecter ; d’être juste transporté en découvrant ces bêtes que l’homme n’aura jamais eu l’occasion de croiser. Tout comme chez Cameron, l’utilisation des CGI a ici un véritable sens car elle sert à offrir ce qui n’aurait jamais pu être concrétisé de manière si crédible autrement. Cela explique d’ailleurs pourquoi deux décennies plus tard, les CGI s’avèrent toujours aussi bluffants même si l’œil s’est depuis habitué aux textures numériques. Mais le travail méticuleux de l’équipe des effets spéciaux ne fait pas tout et Spielberg l’a également compris. Il faut mettre en valeur ces visions d’un autre monde. Toute l’émotion du film passe ainsi par les capacités de mise en scène de Spielberg, ses choix de cadrages et de découpages s’avérant constamment pertinents pour nous émerveiller (la découverte des diplodocus dans la plaine) ou nous terrifier (l’attaque du T-Rex sous la pluie). Spielberg est d’ailleurs bien secondé dans son entreprise par le directeur de la photographie Dean Cundey (les premières minutes du film où les éclairages favorisent le caractère insoutenable de l’attente) et le compositeur John Williams (signant un thème principal aussi inusable que ceux de Star Wars et Indiana Jones).

Au bout du compte, si Spielberg a voulu donner un fond à son film, celui tiendrait principalement à son média. Car la réflexion sur la technologie de Crichton, alliée à l’emploi des CGI par Spielberg, conduit Jurassic Park à se teinter d’une parabole sur le septième art. Spielberg détourne les questionnements de Crichton pour les faire siens et s’interroge sur la technologie particulière qu’il utilise. Il n’y a qu’à prendre les attitudes paradoxales du personnage de Grant. Ce dernier est atteint de cyberphobie et voit d’un très mauvais œil ces outils qui enlèveraient tout le plaisir qu’il voit dans son travail. Pourtant, il se montrera tout aussi impressionné que le spectateur face aux dinosaures recréés par cette même technologie. Grant sert d’ailleurs tout autant de point d’ancrage pour le spectateur que pour l’équipe du film. Spielberg mettra ainsi dans sa bouche la réplique que lâcha Tippett lorsqu’il découvrit les tests en CGI (Don’t you mean extinct ?). La fin est également merveilleuse et constitue la note d’intention du cinéaste. A bord de l’hélicoptère qui les ramène vers le monde moderne, Grant sert dans ses bras les enfants qu’il a accompagnés durant tout son périple. Lui qui au début du film détestait les gosses semble finalement s’y être attaché et prendre plaisir à les avoir auprès de lui. Après un échange de sourires avec sa petite amie, il ira contempler par le hublot le vol de quelques-uns de ces oiseaux qu’il considère comme les descendants des dinosaures. Sans dialogue, Spielberg rappelle qu’un film/aventure peut transformer notre perception du monde. Certes nous nous sommes émerveillés devant ces dinosaures ressuscités mais cela ne veut pas dire que l’on ne peut plus retrouver ce même émerveillement face au spectacle de la nature la plus simple. Lorsqu’il laisse partir l’hélicoptère dans le soleil couchant, il annonce juste là un avenir s’ouvrant sur toutes les possibilités.
Film d’aventure passionnant malgré quelques joyeuses invraisemblances (la mort de Samuel L. Jackson entre autres choses), Jurassic Park s’analyse avant tout comme un film sur le pouvoir de l’illusion. Il n’y a qu’à voir la transformation du personnage d’Hammond par rapport au roman. Celui-ci perd son statut de pseudo-docteur Moreau pour celui d’une sorte de Walt Disney désireux d’abolir la frontière entre réalité et imaginaire (l’anecdote du cirque des puces et son artifice devenant vérité pour celui qui ne le voit pas). Sommet de maîtrise artistique exhibant avec virtuosité toute la puissance de son médium, Jurassic Park sera bien perçu à sa sortie comme l’œuvre précieuse qu’elle est. S’il y aura quelques réactions désobligeantes (une bataille rangée dans nos contrées entre le film de Spielberg et le Germinal de Claude Berri), le long-métrage deviendra le plus grand succès au box-office de Spielberg.
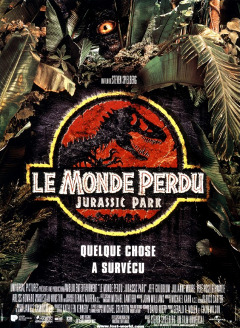
REALISATION : Steven Spielberg
PRODUCTION : Universal Pictures, Amblin Entertainment
AVEC : Sam Neill, Pete Postlethwaite, Julianne Moore, Richard Attenborough, Joseph Mazzello, Arliss Howard, Vince Vaughn…
SCENARIO : David Koepp
PHOTOGRAPHIE : Janusz Kaminski
MONTAGE : Michael Kahn
BANDE ORIGINALE : John Williams
TITRE ORIGINAL : The Lost World : Jurassic Park
ORIGINE : Etats-Unis
GENRE : Science-fiction, Aventure
DATE DE SORTIE : 22 octobre 1997
DUREE : 2h09
BANDE-ANNONCE
Synopsis : Quatre ans après le terrible fiasco de son Jurassic Park, le milliardaire John Hammond rappelle le Dr Ian Malcolm pour l’informer de son nouveau projet. Sur une île déserte, voisine du parc, vivent en liberté des centaines de dinosaures de toutes tailles et de toutes espèces. Ce sont des descendants des animaux clônes en laboratoire. D’abord réticent, Ian se décide à rejoindre le docteur quand il apprend que sa fiancée fait partie de l’expédition scientifique. Il ignore qu’une autre expédition qui n’a pas les mêmes buts est également en route.
Logiquement, le public en veut plus et appelle une suite. A cet exercice, Spielberg ne s’y est attelé lui-même qu’une seule fois avec la trilogie Indiana Jones. Sentant le potentiel non encore exploré de sa création, il accepte l’idée d’un nouvel opus. Mais il se voit toutefois obligé de respecter le congé sabbatique fixé par sa femme (sans ça il serait perpétuellement en tournage). Cela laisse d’ailleurs le temps à Michael Crichton pour trouver une bonne histoire à conter. Quatre ans plus tard, l’idée est trouvée et Spielberg peut reprendre sa caméra. Avec amusement, on peut considérer qu’il reprend les choses là où il les avait arrêtées. L’année 1993 sera en effet pour lui celle d’un doublé magnifique (le bouleversant La Liste De Schindler suivra de peu la sortie de Jurassic Park). L’année 1997 verra également l’apparition d’un doublé composé d’un film dit académique (Amistad) et d’un grand divertissement populaire (Le Monde Perdu donc). Pourtant, si le double-programme de 1993 figure parmi les œuvres les plus admirées du réalisateur, celui de 1997 comprend ses œuvres généralement les moins appréciées. Dans le cas du Monde Perdu, le trop plein d’attente est fortement en cause. Souvent décrié pour quelques détails (les détracteurs du film mettent TOUJOURS en avant la séquence de gymnastique), une simple révision permet de mettre de l’eau dans son vin. Car, certes très loin d’égaler son aîné, cette suite n’en manque pas moins d’intérêt ne serait-ce que dans ses intentions.
Le concept proposé par Crichton est simple : site B. Il imagine en effet que la société créatrice des dinosaures dispose d’une autre île avec une usine où étaient créés les dinosaures avant d’être exposés dans l’île du premier film. Suite à la débâcle advenue précédemment, la société a abandonné ses installations et libéré les animaux déjà arrivés à terme. Ainsi a vu le jour le monde perdu du titre. Il s’agit bien sûr d’un hommage au classique d’Arthur Conan Doyle qui aura inspiré ce que Crichton nomme un techno-mythe (la science ayant détruit les anciens dieux et leurs mythologies, elle s’en est créée de nouveaux). A l’instar du précédent opus, ce pitch donnera lieu à deux œuvres finalement très différentes. En l’occurrence, Crichton écrira le roman alors que David Koepp planchera sur le script. En conséquence, les divergences sont nombreuses. Seuls les grandes lignes (deux groupes aux ambitions distinctes parcourent une île peuplée de dinosaures) et certains évènements clefs (l’attaque de la camionnette par les Tyrannosaures) sont communs entre les deux. Là encore, il s’agit pour Spielberg de faire valoir son point de vue sur celui de Crichton. L’écrivain ressuscitera donc le personnage de Malcolm (pourtant clairement laissé pour mort dans le roman) et se lancera à nouveau sur une réflexion autour du chaos cette fois appliquée au principe de l’évolution. Les préoccupations de Spielberg sont, elles encore, cinématographiques. Désireux d’éviter la redite, Spielberg abandonne l’émerveillement contemplatif inhérent à Jurassic Park. Il tourne même littéralement le dos à l’ambition de ce dernier. Avec Jurassic Park, le réalisateur souhaitait à tout prix éviter l’écueil du film de monstre. Désormais que le public est convaincu de la crédibilité de ses créatures, il va embrasser le genre à pleine bouche au travers du Monde Perdu. D’ailleurs, toute la structure du film s’avère calquée sur King Kong. A l’époque de Jurassic Park, Spielberg avait d’ailleurs utilisé le monument de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack pour expliquer en quoi son film n’appartient pas au même registre. Un juste retour des choses donc qu’il y rende hommage lorsqu’il décide de s’atteler véritablement à ce genre.

Le Monde Perdu entretient donc des ficelles narratives similaires. Un groupe de personnages débarque sur une île dominée par un bestiaire ancestral, lutte pour sa survie, capture et ramène chez lui une créature (à noter que le bateau transportant le T-Rex est le S.S Venture, le même navire qui véhicula Kong) qui va se libérer et semer le désordre en ville. Une base en forme de clin d’œil que Spielberg va développer de manière étonnante. Peut-être est-ce par rapport à cette joie de s’exercer au genre mais Spielberg fait ici preuve d’une décomplexion qu’on soupçonne rarement chez lui. On le sent donc prendre un plaisir redoutable lors d’une séquence de safari où il filme dans un même plan des jeeps et des motos avec ses dinosaures. Il y a là un anachronisme jubilatoire qui évoque d’autres bizarreries cinématographiques comme La Vallée De Gwangi où une bande de cow-boys tombe sur une vallée où règnent les fameux sauriens. Plus que son sadisme récurrent (le remake gore du baiser de La Belle Et Le Clochard), Spielberg se permet même des privates jokes. Par exemple, lorsque le bus détruit le vidéoclub, on peut remarquer plusieurs affiches de films bidons avec Robin Williams et Tom Hanks ainsi qu’une version du Roi Lear avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle titre (clin d’œil à Last Action Hero qui subira le contrecoup du succès de Jurassic Park ?). Rien n’est en même temps étonnant lorsqu’on se souvient qu’il produisait à l’époque des séries animées délicieusement absurdes comme Les Animaniacs où il n’hésitait pas à se tourner lui-même en ridicule (voir l’épisode de Freakazoid où il tourne E.T. 2).
Mais derrière le film d’aventure décomplexé, Spielberg se montre toujours aussi consciencieux. Il prend donc soin à inclure en background les thématiques du roman de Crichton. Délaissant le rapport à la technologie développé précédemment, ce dernier utilisait le sujet pour évoquer la frontière entre modernité et primitivité. Peu désireux de reprendre toute l’étude anthropologique du livre, le cinéaste choisit juste d’en faire de belles illustrations. Par exemple, lors d’une scène d’action, les deux personnages féminins creusent un passage dans la terre afin de s’enfuir d’un hangar alors que les vélociraptors font de même de leurs côtés pour y entrer. En un simple passage de suspense, Spielberg met en perspective comment l’urgence de la situation renvoie l’homme civilisé à un état animal. Son bagage évolutif a beau le faire croire supérieur aux sauriens, il se trompe lourdement. C’est ce qu’apprendra un des chasseurs qui inculquera la peur de l’homme à un petit bestiau avant que celui-ci ne vienne se venger en groupe. En reniant son statut animal, l’homme adopte un comportement et un fonctionnement stupide par rapport à l’ordre naturel des choses. L’arrivée du T-Rex à San Diego en est un bon exemple, Spielberg joignant en un seul plan les premiers pas en ville de la créature avec la situation de douaniers aux prises avec des immigrés clandestins.

À ceci, Spielberg ajoute sa maestria de la mise en scène. Celle-ci reste remarquable dans sa recherche d’implication et de spectaculaire. Il tente là d’exploiter au maximum les possibilités d’interactions des dinosaures (numériques ou animatroniques) avec les acteurs pour rendre plus palpable le sentiment de danger. Alors que Jurassic Park jouait sur cette idée de barrières de protection s’effondrant, Le Monde Perdu montre immédiatement un univers où les deux espèces sont mises au même niveau. Après la contemplation, il faut désormais de l’immersion ce qui tend à justifier le remplacement du directeur de la photographie (la douceur élégante de Dean Cundey cède la place au plus sec Janusz Kaminski). Du côté des effets spéciaux, la multiplication de la charge de travail (c’est simple : tout est deux fois plus grand) n’enlève rien à la quête de perfectionnisme voulue par Spielberg (impossible de deviner que le plan d’hélicoptère sur le colisée à été réalisé avec une maquette). Pour ne rien gâcher John Williams réinvente brillamment sa partition originale. Mais pourquoi diantre ce film semblant si parfait ne jouit-t-il pas d’une meilleure réputation ? Un sentiment de lourdeur peut-être. Lourdeur dans l’introduction (tout le monde s’accordera à dire que les dialogues entre Hammon et Malcolm sont loin d’être les séquences les plus captivantes du film) mais également dans tout son déroulement. C’est comme si le côté décomplexé de l’entreprise qui aurait dû libérer le film pesait dessus.
On aura ainsi du mal à passer outre la superficialité des personnages, tellement traités par-dessus la jambe qu’on peine à s’y attacher (pour un Pete Postlethwaite charismatique, combien d’insignifiants Vince Vaughn ?). Une déficience se résumant à elle seule par le choix du héros. Que Crichton ait choisi de profiter du fait que Spielberg ait laissé vivant Malcolm à la fin du premier film, c’est assez logique. Bien que son retour par rapport à la trame littéraire est ridicule (une mauvaise blague sert à justifier cette réapparition digne de celle de Bobby dans Dallas), Crichton le justifie par l’affection qu’il porte à ce personnage par lequel il peut exprimer tous ses questionnements scientifiques. On peut douter que ce soit le cas de Spielberg surtout lorsqu’on voit le traitement initial qu’il fera du personnage (Jeff Goldblum est d’ailleurs au sommet de son art avec ce rôle de rock star multipliant les pics sarcastiques). Au regard de l’orientation donnée à cette suite, le professeur Grant semblait le choix le plus logique pour mener une exploration sur l’île aux dinosaures. Malcolm se montre de manière prévisible un chef d’équipe dépassé et peu à l’aise dans l’aventure. Les quidams plongés dans des situations extraordinaires ne sont pas nouveaux chez Spielberg mais on atteint ici un tel degré de nonchalance que ça en devient impardonnable. Moins impardonnable cela dit que la problématique quant à l’enchaînement des péripéties. Car c’est finalement là le souci et le grand drame du long-métrage : les scènes d’actions sont incroyablement bien filmées mais jamais poignantes. Difficile en effet de trépigner devant l’action et surtout d’y croire lorsque celle-ci devient si abracadabrantesque (la caravane suspendue dans le vide et ce passage nonsensique de la vitre se fissurant) ou au contraire si maigrement exploitée. On citera là notamment le dernier acte très bancal. Tout comme dans Jurassic Park, cette fin fut modifiée en cours de route. Originellement, le scénario se concluait en effet sur l’île avec une attaque de ptérodactyles. En choississant d’aller à fond dans la référence à King Kong, Spielberg promettait de grandes choses. Mais la catastrophe attendue s’avère fort minime puisque le T-Rex se contente de provoquer quelques accidents de la route et de dévorer le scénariste David Koepp qui passait par là le temps d’un caméo.

Faut-il d’ailleurs voir là dedans un signe des temps à venir où quantité de yes-men laisseront les effets spéciaux dévorer un véritable travail d’écriture ? Vu la lucidité sur le medium dont a fait preuve Spielberg jusqu’ici, il n’y a qu’un pas à franchir pour répondre par l’affirmative. En l’état, ce second opus reste un succès au box-office malgré une ambiance de frustration appelant un nouvel épisode pour corriger le tir. Si on ne sait pas ce que Spielberg pense de cette suite (certaines légendes attribuent même la paternité du film à Koepp qui fut également directeur de la seconde équipe), il semble clair que son désistement de la réalisation du troisième épisode marque sa volonté d’explorer à nouveau des horizons inédits. Une saine initiative que d’autres auraient dû suivre plus tôt.

REALISATION : Joe Johnston
PRODUCTION : Universal Pictures, Amblin Entertainment
AVEC : Sam Neill, Alessandro Nivola, William H. Macy, Tea Leoni, Laura Dern, Trevor Morgan, Michael Jeter…
SCENARIO : Peter Buchman, Alexander Payne, Jim Taylor
PHOTOGRAPHIE : Shelly Johnson
MONTAGE : Robert Dalva
BANDE ORIGINALE : John Williams, Don Davis
ORIGINE : Etats-Unis
GENRE : Science-fiction, Aventure
DATE DE SORTIE : 08 août 2001
DUREE : 1h32
BANDE-ANNONCE
Synopsis : Huit ans après les événements surréalistes survenus lors de sa visite au Jurassic Park du richissime John Hammond, le paléontologue Alan Grant se rappelle toujours de sa rencontre, d’abord magique puis effroyable, avec ces dinosaures ramenés à la vie grâce aux incroyables progrès de la génétique. À l’origine, ces créatures de la Préhistoire n’étaient pas censées se reproduire ni survivre, mais elles ont déjoué les plans des scientifiques. Elles sont probablement toujours en vie sur l’île Isla Sorna.Alan étudie l’intelligence des vélociraptors. Cependant, il manque de subventions pour financer ses recherches. Paul Kirby et sa femme Amanda, un couple richissime, lui proposent alors une grosse somme d’argent s’il leur fait survoler la fameuse île. Alan accepte leur offre.Mais celui-ci flaire une entourloupe lorsque le pilote amorce sa descente sur l’île. Il découvre alors les vraies raisons de l’excursion organisée par les Kirby : sauver Eric, leur fils disparu dans les environs. Ces derniers avaient besoin de son aide, car il est le seul à connaître l’île et ses mystérieux occupants. Cependant, au moment où l’avion s’apprête à redécoller, un spinosaure tente de piétiner l’appareil…
Spielberg passe donc le relai à Joe Johnston. Dès la sortie du premier opus, Johnston fit part au réalisateur des Dents De La Mer de son envie de réaliser une hypothétique suite. Johnston semble un choix idéal puisqu’après tout il s’y connaît en effets spéciaux (son Chérie j’ai rétréci les gosses est presque un manifeste des effets spéciaux réalisables à son époque), il a un certain sens visuel (l’esthétisme de Star Wars lui doit beaucoup) et il aime l’aventure (le rétro-futuriste Rocketeer ou l’inventif Jumanji). Honnête artisan qu’il est, il s’attèle à la tache avec application et soin. En soit, son travail sur cet épisode n’a rien de honteux et il offre une aventure agréable à suivre. Toutefois il s’avère au centre d’un processus inconscient beaucoup plus complexe. Comme nous l’avons expliqué plus haut, toute technologie tend à devenir commune et habituelle. En 2001, les CGI sont bel et bien devenus une banalité que l’on retrouve dans le moindre blockbuster. Son potentiel a été exprimé et assimilé par le public. Des défis sont toujours lancés ici et là (Final Fantasy, le premier long-métrage d’animation photoréaliste, sortira pratiquement en même temps que Jurassic Park 3), une certaine lassitude quête. En fait, elle pointe tellement le bout de son nez que Jurassic Park 3 devient presque le réservoir d’une déprime naissante. Car si beaucoup considéreront cet épisode comme une grosse baudruche se dégonflant, cette figure de style parsème le film.

Le discours de Grant dans le premier acte pose ainsi une première base. Revenu à ses fossiles et à ses théories sur le comportement des dinosaures, Grant se voit interrogé sur la possibilité d’aller dans le monde perdu pour vérifier ses thèses. Ce à quoi Grant répond que c’est scientifiquement infondé car il n’y a techniquement pas de dinosaures sur l’île. Grant rappelle là un élément clef des romans de Crichton que Spielberg a sciemment mis de côté. Les dinosaures sont en effet des clones dont le code génétique a été manipulé par les savants. Cette partie de l’histoire a bien sûr été évoqué par Spielberg mais il ne mit pas l’accent sur ce qu’implique cette conception. Les livres sont ainsi traversés de nombreux dialogues interrogeant cet aspect, à savoir que ces manipulations ont donné naissance à des créatures qui ressemblent à des dinosaures mais dont le fonctionnement biologique et le comportement ne peuvent pas être en tout point similaire. Autrement dit, ces dinosaures sont des supercheries. On peut aisément comprendre pourquoi Spielberg a laissé de côté ce point. Il désirait à tout prix nous faire croire à l’existence de ces animaux et nous fasciner devant. Soulever ce point, ça aurait été pousser le spectateur à prendre conscience du subterfuge et donc des trucages. Le fait que l’interrogation fasse une entrée en fracas dans ce troisième épisode tend à démontrer un manque de croyance dans l’outil. Il faudra d’ailleurs se rendre à l’évidence que le film propose là les effets spéciaux les moins concluants de la saga. Malgré la même équipe aux commandes et un budget sensiblement à la hausse, les créatures du film convainquent bien moins que leurs prédécesseurs. L’absence du soin perfectionniste d’un Spielberg est très probablement en cause dans le résultat (certes assez convaincant dans l’ensemble) où les textures et les intégrations masquent mal le caractère factice des bêtes. En soit, cette baisse de régime donne presque l’impression de voir un produit de contrefaçon plutôt qu’un véritable troisième opus.
Par certains aspects, le film en est une. N’ayant plus de roman sur lequel se baser, les scénaristes reprennent les grands principes de ses prédécesseurs et volent certains passages des livres qui n’ont pas encore été portés à l’écran (la volière avec les ptérodactyles, l’attaque du bateau). Le film en devient un spectacle familial où l’ambiance bon enfant tend à justifier la compression de toute ambition. On en revient à cette optique de baudruche se dégonflant. Les personnages en sont de beaux exemples. Se présentant comme des milliardaires aventureux, les Kirby sont de simples quidams sans le sou qui n’ont jamais quitté l’Oklahoma. Engagés pour superviser le sauvetage du fils de ces derniers, les mercenaires introduits comme des Rambo surentraînés s’avèrent de pauvres brèles qui seront immédiatement envoyés ad patres. Le Tyrannosaure, grand méchant de la franchise jusqu’alors, se fait dévorer en deux temps trois mouvements par le plus hargneux Spinosaure. Même ce dernier se verra désacraliser par une stupide sonnerie de téléphone annonçant sa présence. Inutile de dire que le film choisit d’évacuer toutes problématiques même la plus insignifiante. Le film se permet même une grosse pique envers l’œuvre de Crichton au détour d’un dialogue entre Grant et le gamin. L’interrogeant sur l’ouvrage que Malcolm a écrit sur les évènements, l’enfant répondra : « c’est un peu prêchi-prêcha. Il y a trop de chaos, tout est chaos ! Ce type a l’air d’avoir une haute idée de lui-même. ». Une manière de remettre à sa place l’auteur de La Variété D’Andromède dont les obsessions scientifiques imprègnent la moindre page de ses livres.

En fait, il y a une scène où on aurait voulu pleinement épouser le point de vue de Grant. Survolant l’île en avion et revoyant pour la première fois les dinosaures depuis tant d’années, Grant se montre captivé. Alors qu’il semblait jusqu’alors blasé à l’idée de retrouver ces pauvres simulacres d’une réalité disparue, Grant est émerveillé et lâche juste un « j’avais oublié ». Il avait oublié que cette illusion/supercherie pouvait être juste magnifique et provoquer des émotions comme on en connaît rarement. Malheureusement, le choix d’une aventure sans prise de tête (on taira la manière dont les personnages sont secourus pour ne pas être vulgaire) et de se reposer sur des acquis bien établis mais aucunement transcendés (le compositeur Don Davis pompe les thèmes de Williams auquel il rajoute quelques abominations de son cru) empêche de retrouver cette sensation. Lorsque Johnston tente de retrouver l’atmosphère contemplative et apaisante du premier opus juste avant le climax, rien ne se passe. En faite, le sentiment du spectateur se retrouve plus volontiers dans une autre scène. Celle où les personnages se mettent à visiter une usine en ruine tout en mangeant des confiseries trouvées dans un distributeur. Comme eux, on regarde blasé les restes d’un beau rêve en mangeant tranquillement des cochonneries supra-caloriques. On peut comprendre après ça qu’aucun quatrième épisode ne fut lancé.
Enfin pas officiellement tout du moins. Le site Ain’t It Cool fera bien une review d’un prétendu traitement signé par William Monahan (Les Infiltrés) et John Sayles (Hurlements) mais celui-ci est d’un tel mauvais goût qu’on peut émettre des doutes sur sa véracité. Jugez plutôt : dans un futur proche, les attaques de dinosaures se multiplient en Amérique. Pour contrer cette menace, une corporation crée ses propres dinosaures en les modifiant génétiquement pour les rendre aussi dociles que des chiens (gné ?) et intelligents comme des humains (re-gné ?). Des bestiaux nouvelle génération qui, dotés d’armures et d’armes (re-re-gné ?), font seconder notre mercenaire de héros. Un concept complètement barré qui ressemble plus à un rip-off de séries animés comme Cadillacs & Dinosaures ou Extrêmes Dinosaures. En l’état, rien ne se concrétise et des rumeurs sont régulièrement relancées. La dernière date d’il y a juste quelques mois et vient de Spielberg lui-même annonçant carrément une nouvelle trilogie avec toujours Johnston à la réalisation er Mark Protosevich (Je Suis Une Légende) au scénario. Une annonce qui semble attester une volonté de tirer en avant la franchise et non de la laisser se reposer sur son héritage. Après tout, Spielberg continue de son côté sa quête d’exploration des possibilités du septième art et s’apprête à concrétiser une nouvelle révolution avec Tintin et son cinéma virtuel. Il est d’ailleurs assez intéressant de voir que le contexte entre Jurassic Park et Le secret de la licorne est approximativement semblable. S’appropriant une technologie déjà bien introduite par James Cameron, Spielberg décide de porter à l’écran l’œuvre d’un autre (quitte à prendre des libertés avec) dont les difficultés d’adaptation (donner vie à des créatures mortes depuis des millions d’années ou reproduire l’univers d’une bande dessinée) justifient l’emploi de cette technique. Alors que le cinéaste s’apprête une fois encore à changer les mentalités et qu’un quatrième opus se fait toujours attendre, la franchise Jurassic Park n’est-elle plus destinée qu’à devenir un précieux fossile d’une époque passée ? L’avenir nous le dira et cela dépendra de notre capacité à considérer la banalité.




1 Comment
Très intéressant le rapprochement avec Tintin.
Je pensais surtout au rapprochement entre Jurassic Park et Avatar, pour ma part. Car les deux films proposent dans leur scénario la même mise en abîme de l'emploi d'une nouvelle technologie aux yeux du spectateur. La démarche de Cameron par rapport à la Performance Capture étant globalement la même que Spielberg par rapport aux CGI, dans la structure scénaristique de leurs films respectifs (découverte et émerveillement du héros et du public en même temps face à la nouvelle technologie).
Quand on y pense, c'est même tellement casse-gueule comme procédé scénaristique qu'il fallait bien des cinéastes de leur trempe pour que cela fonctionne.