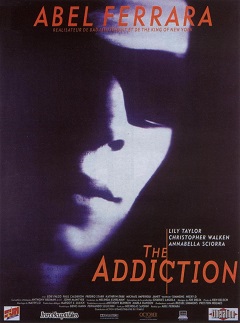
REALISATION : Abel Ferrara
PRODUCTION : October Films, Polygram Filmed Entertainment
AVEC : Lili Taylor, Christopher Walken, Annabella Sciorra, Edie Falco, Paul Calderon, Fredro Starr, Kathryn Erbe, Michael Imperioli, Jamal Simmons, Louis Katz
SCENARIO : Nicholas St. John
PHOTOGRAPHIE : Ken Kelsch
MONTAGE : Mayin Lo
BANDE ORIGINALE : Joe Delia
ORIGINE : Etats-Unis
GENRE : Drame, Horreur
DATE DE SORTIE : 10 avril 1996
DUREE : 1h22
BANDE-ANNONCE
Synopsis : Brillante étudiante en philosophie à l’Université de New York, Kathleen prépare activement sa thèse de doctorat. Un soir, elle croise sur son chemin une étrange et séduisante femme qui la conduit de force dans une impasse avant de la mordre au cou. Bientôt, Kathleen va développer un appétit féroce pour le sang humain qu’elle assouvira en attaquant ses proches ou des inconnus…
Abel Ferrara qui réalise un film de vampires : on peut déjà être sûr que ça ne ressemblera ni à Dracula ni à Twilight. Cela dit, ce génie taré nous avait-il déjà injecté une dose aussi élevée de nihilisme dark ?
« Regarde-moi dans les yeux et demande-moi de partir » : voilà ce que Kathleen (Lili Taylor) n’a de cesse de répéter à ses futures victimes. Peu importe la réponse car, juste après, la morsure ne se fait jamais attendre. Au sens propre, ce n’est que la conséquence attendue d’une vampire qui se nourrit du sang de tous ceux qu’elle croise. Au sens figuré, c’est en réalité un transfert, un signe de contamination. Rien de moins que l’expérience du Mal absolu, vécue de l’intérieur par un être humain qui s’empresse de l’injecter illico chez celui qui n’a pas la prévoyance de regarder le pêché en face et de le rejeter sans appel. Dit comme ça, on sait déjà qu’on est moins devant un film de vampire que dans un film d’Abel Ferrara, et il fallait bien s’attendre à ce que ce grand cinéaste taré traite le film de genre de façon plus audacieuse et personnelle que les huiles d’Hollywood (ce qu’il avait déjà prouvé avec sa relecture de Body Snatchers). Mystique de la défonce, chaos plastique, dégénérescence carabinée, chute rédemptrice, chrétienté déviante, goût de l’autodestruction enragée, corps affecté par mille maux contemporains : tout ça, ce grand cinglé d’Abel connaît bien. Quand bien même sa filmo magnifiquement déliquescente se veut parfois le corollaire d’un excès de substances illicites dans les conduits et d’un chapelet d’obsessions maladives, ça accouche toujours de ce à quoi on est désormais habitué : des films chimiques, malades et vibrants, mais surtout fiévreux parce que résultant de la fièvre créatrice d’un artiste hanté à vie par la compassion et chez qui le cynisme n’a jamais pris racine. C’est que Ferrara se fait toujours plus angoissé à force d’être en empathie absolue avec la souffrance du monde, ce que The Addiction confirme et amplifie. Son titre amorce l’idée d’une dépendance, et cette fois-ci, le cinéaste vise aussi large qu’universel : notre addiction – irrémédiable et irrépressible – au Mal, notre attirance pour ce précipice sans fond dans lequel on finit toujours par chuter. Et comme il y a un choix à la base de cette chute (sauter ou être poussé ?), Ferrara a son idée sur la question : être mauvais parce qu’on fait le Mal est une fausse lecture, faire le Mal parce qu’on est mauvais est plus juste. Ambiance…

Le postulat du récit tient sur un demi-ticket de métro : Kathleen, étudiante en philosophie, se fait mordre un soir par une élégante femme qui la transforme de facto en vampire assoiffé de sang. C’est tout ? Loin de là, car l’ouverture de The Addiction creuse très vite sous la surface des choses : cette jeune héroïne prépare une thèse sur un sujet qui l’obsède et la terrifie, à savoir l’ampleur génocidaire d’un XXème siècle dont les images d’archive les plus terrifiantes défilent alors sous forme de diapositives (on y voit des photos du massacre de My Lai commis en 1968 par des soldats américains). Un peu plus tard, des images des camps de concentration allemands prendront le relais pour expliciter davantage ce qui motive Ferrara là-dedans : l’élaboration commune d’une tragédie morale et d’un bilan allégorique du siècle passé – on était alors à la veille du nouveau millénaire. Tiens, d’ailleurs, la notion d’« allégorie » nécessite toujours une mise en garde quand elle est manipulée par un cinéaste de la trempe de Ferrara : les personnages de ses films allégorisent toujours des réflexions souterraines au lieu d’être eux-mêmes des allégories de quoi que ce soit. En cela, le personnage de Kathleen se veut le relais contemporain d’un sentiment de culpabilité à la fois diffus et historique, ce qui confère au vampirisme une signification très claire : l’horreur du XXème siècle au sens large, allant du nazisme à la guerre du Vietnam en passant par la pauvreté, les maladies contagieuses et même l’impérialisme US – un point de vue déjà esquissé en mode mineur par Ferrara dans Cat Chaser. A la théorie de George Santayana selon laquelle celui qui ne tire pas de leçon de son Histoire est condamné à la voir se répéter, le cinéaste rétorque qu’il n’existe pas d’Histoire. Juste un fléau qui ne cesse de croître en nous et qui définit ce que nous sommes. Tout espoir pour le futur est donc soldé dès le début. Ça dérange et c’est le but.
The Addiction se veut donc le récit d’une double mutation : une étudiante humaine en tueuse vampire (échelle micro), un fait historique en effet physique (échelle macro). Ici, une image d’archive contamine la psyché jusqu’à accoucher d’un tourment intellectuel lié au passé (qui est coupable ? comment expier ?), et cette vampirisation de l’esprit se répercute sur le corps. Au fond, rentrer en contact avec les images d’une Histoire meurtrière ou avec l’image du vampire moderne (apparition sensuelle d’Annabella Sciorra dans un look de prostituée de luxe), cela revient au même : dans les deux cas, l’allégorie naît d’une image documentaire qui inocule psychiquement son « vécu » – douleur et souffrance – dans la fiction. Se découvrir vampire revient ainsi à signer un pacte quasi faustien avec le Mal (dont l’alpha et l’oméga est ici personnifié par Christopher Walken), histoire de prendre acte de son éternel recommencement et d’être hanté à tout jamais par cette prégnance. Le prix à payer, c’est l’altérité du corps lui-même. Inutile de refouler ou de camoufler les dégâts par la chirurgie ou la consommation. A l’image d’une Kathleen qui régressera en corps toujours plus esquinté (elle perd ses dents, sa chair, ses gestes…) pour finir en loque sanguinolente sur un trottoir, plus rien ne semble vivable chez l’être humain. Se frotter au réel et s’imprégner de l’Histoire n’engendreront qu’une angoisse toujours plus morbide. Tenter d’expier un tourment le fera toujours revenir au galop. Quant à faire l’effort de se connaître soi-même, ce n’est là qu’un aller simple vers l’achèvement d’un désastre (ultime réplique du film : « La révélation de soi est l’annihilation de soi »). Déverser sa fureur en inoculant l’inhumanité à son tour, agoniser non-stop sous l’effet d’un tourment éternel, pourrir de l’intérieur mais ne jamais mourir : tel est le triple destin tragique des figures vampiriques de The Addiction.


Au beau milieu de cet océan de noirceur et de nihilisme, où peut-on trouver le moindre repère, la moindre bouée de sauvetage à laquelle se raccrocher ? C’est au fond très simple, puisque cette théorie sur la gouvernance du Mal absolu n’est en aucun cas traitée sur le mode d’une lourde thèse, à l’image de celle que prépare l’héroïne. L’utilisation de la voix off constitue notre meilleur guide dans ce purgatoire existentiel : elle se veut certes signe de lucidité et non de distance vis-à-vis d’un propos ultra-dark, mais elle se joue aussi du sens que l’on pourrait facilement superposer à ce récit. Même si Ferrara brasse ici large en matière de repères philosophiques (on y cite Kierkegaard, Nietzsche, Burroughs, Santayana, Sartre, Dante, Beckett, Baudelaire…), ce n’est clairement pas pour jouer les intellos ni pour surligner son propos par des points de vue annexes. C’est plutôt pour tracer des passerelles ironiques quand ce n’est pas carrément pour tordre une pensée. Ici, on contredit plus qu’on ne valide, et Ferrara, malin comme pas deux, en fait l’illustration littérale via un raccord entre deux travellings latéraux, passant du sabordage en off d’une théorie de Kierkegaard (centrée sur notre attirance pour le Mal) à une soutenance de thèse où Kathleen définit la philosophie comme de la propagande égotiste. Influencer son audience et changer son point de vue par des thèses n’intéresse pas Ferrara. Si le sens dépend du verbe (comme le suggère Kathleen), alors The Addiction avance à rebours vers un espace archaïque où le verbe n’a plus cours, où le discours redevient grognement, où la voix régresse en un cri primitif. Le monde civilisé, défini ici par le poids de la culture, perd toute son aura de par le point de vue de Kathleen sur une bibliothèque : rien de plus qu’un cimetière à l’odeur de charnier, avec des étagères de livres assimilées à des « rangées de tombes délabrées » et dont le contenu n’est qu’« épitaphes vicieuses et diffamatoires », le tout absorbé par des visiteurs qui se collent comme des mouches. Le réel redevient tout à coup ce vivarium des instincts les plus enragés, où le désir de nuire à l’Autre égale celui d’en drainer l’énergie (Kathleen se fait des shoots de sang de clochard !), et qui culmine dans une séquence inouïe d’orgie meurtrière. Ce climax final, si hardcore qu’il fait passer celui de L’Ange de la vengeance pour un épisode de Maya l’Abeille, fait du cannibalisme le stade terminal de l’action vampirique : dévorer le monde jusqu’à ce que le Mal se dévore et s’anéantisse lui-même.


De bout en bout, les visions sidérantes de The Addiction font ressurgir une terrifiante angoisse, destinée à s’exalter et impossible à canaliser. On peut clairement assimiler ce film à une sorte de givrage psychique et intellectuel, dont la dernière des fonctions serait de nous remettre les idées en place. Ferrara veut à tout prix générer un stress infernal, et comme la seule force – déjà dévastatrice ! – du fond ne lui suffit pas, c’est peu dire qu’il y met les moyens question mise en scène : un noir et blanc aussi éblouissant que spectral qui flirte souvent avec l’expressionnisme d’un Murnau, une scénographie ultra-ténébreuse qui capture des zones de turbulences internes et externes, un kaléidoscope sonore caractérisé par la superposition de divers bruitages (voix off, bruits d’animaux, machineries d’usine, hurlements stridents, musique rap…). Vous voilà donc prévenus. Et bien qu’on puisse être tenté de lire l’ultime scène comme la suggestion ambivalente d’un happy end (Kathleen finalise-t-elle sa « transcendance » en quittant son ancienne vie terrestre et en se recueillant sur sa propre tombe ?), il est clair qu’on ne sort pas de ce film-trip avec la patate ou la joie de vivre. Tout du moins peut-on avoir la sensation viscérale d’avoir été mordu – intérieurement et extérieurement – aussi bien par un artiste-vampire que par un mal nécessaire. The Addiction ne vise qu’à nous hanter sur une durée indéterminée. Et c’est peu dire qu’on y songe encore longtemps après l’avoir vu, désireux que l’on est de propager son existence à autrui en lui disant ceci : « Regarde-moi dans les yeux et demande-moi de ne pas te montrer ce film ».
Test Blu-Ray
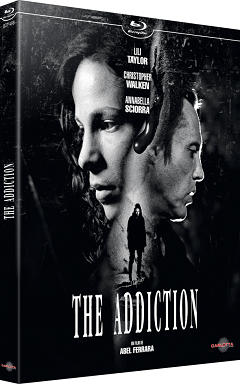
Il en aura fallu du temps pour que la quasi-invisibilité de ce chef-d’œuvre cauchemardesque prenne fin en France. Rendons à nouveau grâce à nos amis supra-cinéphiles de Carlotta pour avoir ressorti The Addiction des oubliettes, qui plus est dans un écrin HD aussi splendide. Supervisée par Abel Ferrara lui-même et par son chef opérateur Ken Kelsch, cette restauration 4K offre au film un piqué et une profondeur de champ absents de la copie 35mm. On parie déjà que certains tiqueront devant une netteté aussi forte pour un film à ce point rattaché au circuit indépendant et underground (ce qui laisserait supposer une texture plus sèche et granuleuse), mais cette beauté visuelle, vierge du moindre bruit vidéo, contribue encore plus à renforcer le caractère quasi hallucinatoire de certaines séquences (en particulier celle de la morsure de Lili Taylor par Annabella Sciorra). Même verdict d’excellence pour la piste sonore, exclusivement en VO (il n’existe aucune VF de ce film), qui offre un surplus d’ampleur aux bruitages par rapport aux dialogues, ce qui n’est clairement pas pour nous déplaire. Les bonus, de leur côté, constituent de solides accompagnements, et Abel Ferrara y prend logiquement la parole en tant que privilégié. D’abord dans un petit documentaire récent d’une demi-heure où il questionne ses deux acteurs principaux, son chef opérateur et son compositeur sur leurs souvenirs du film. On avouera qu’il n’y est pas toujours question du film lui-même, chacun se laissant parfois aller à dévoiler sa pensée du moment ou à théoriser sur son propre travail, mais certaines confessions sont intéressantes (Lili Taylor profite de l’occasion pour évoquer son alcoolisme durant le tournage !). Ensuite dans un petit entretien en solo où il évoque sa sensibilité pour les films en noir et blanc, salue l’investissement absolu de son équipe, décrypte sa lecture personnelle du vampire et donne son interprétation de la scène finale. Enfin dans un petit module d’époque très drôle dans lequel le cinéaste, fidèle à sa démarche dansante et bordélique, réagit à quelques rushes en pleine phase de montage tout en s’attardant sur la situation en Bosnie et en chantant sur une cacophonie rock ! On avoue que l’entendre assimiler le montage à une « opération du cerveau » vaut son pesant de cacahuètes… A ces trois interventions vient s’ajouter un ultime bonus – le plus intéressant pour les cinéphiles ! – où le biographe Brad Stevens, auteur de l’excellente monographie Abel Ferrara : The Moral Vision, offre quelques angles de lecture de The Addiction en à peine neuf minutes. Il n’en fallait pas davantage pour permettre à ce très bon Blu-Ray de rendre justice au film qu’il sert.
