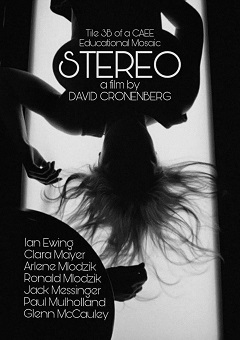
REALISATION : David Cronenberg
PRODUCTION : Emergent Films
AVEC : Ronald Mlodzik, Jack Messinger, Paul Mulholland, Iain Ewing, Arlene Mlodzik, Clara Mayer, Glenn McCauley, Mort Ritts
SCENARIO : David Cronenberg
PHOTOGRAPHIE : David Cronenberg
MONTAGE : David Cronenberg
ORIGINE : Canada
TITRE ORIGINAL : Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic)
GENRE : Expérimental, Science-fiction
DATE DE SORTIE : 23 juin 1969
DUREE : 1h03
BANDE-ANNONCE
Synopsis : Dans un futur proche, au Canada. Le parapsychologue Luther Stringfellow réalise une expérience portant sur les interactions entre les espaces-continus empiriques d’un groupe d’individus particulièrement uniques. Huit cobayes sont alors enfermés dans un centre de recherche après avoir subi une opération du cerveau développant leurs capacités sexuelles et télépathiques. Le but de cette expérience consiste à mieux appréhender la cybernétique socio-humaine à travers l’étude des dimensions des expériences humaines dans le contexte de l’homme et de la société. Quelle en sera l’issue ?
C’est un euphémisme de dire que les premiers films (plus ou moins méconnus) d’un cinéaste que l’on admire restent le meilleur moyen de déceler les vestiges de son œuvre à venir. Dans le cas de David Cronenberg, la tâche est d’autant plus facile que la filmo du ciné-psy de Toronto a toujours fait preuve d’une unité thématique à toute épreuve – si l’on met de côté l’intermède Fast Company en 1979. N’en déplaise à ceux qui n’ont jamais fait l’effort de corriger leur erreur de jugement sur Cronenberg, ne cessant de crier au retournement de veste snobinard dès lors que le créateur de Vidéodrome ne donnait pas dans le body horror le plus explicite. A ceux-là, trop occupés à chercher dans les films post-eXistenZ les traces d’une quelconque branlette théorique pour intellos torturés du ciboulot, on conseillera en priorité de (re)voir les deux premiers films du bonhomme. Quoi, Frissons et Rage ? Non, les deux d’avant. Constituant la suite logique de deux courts-métrages expérimentaux conçus avec une philosophie d’autodidacte (Transfer en 1966 et From the Drain en 1967), Stereo prouve bien qu’avant de signer l’acte de naissance du body horror en 1975 avec Frissons (son premier film commercial, on le rappelle), Cronenberg avait déjà exposé tous ses grands thèmes de prédilection, sans forcément prendre le temps de les ordonner (il ne s’imaginait pas encore cinéaste, on le rappelle également). La sexualité déviante, la contamination virale, le corps humain comme terrain d’expérimentation, l’altération du schéma organique, la science dépassée par les trouvailles de ses néo-savants fous, le pouvoir de l’esprit sur le corps… Tout était déjà là dans ce premier essai bizarroïde, shooté pour le plaisir en période estivale avec une équipe réduite dans un lieu authentique (le campus du district de Scarborough à Toronto, laissé à l’abandon durant l’été), et drivé par l’esprit créatif de l’underground newyorkais (de Jonas Mekas à Kenneth Anger). Un premier film amateur, donc ? Peut-être dans la forme (le corps) mais pas dans le fond (l’esprit). Et c’est parfaitement normal : chez David Cronenberg, l’interne prend toujours le dessus sur l’externe.

Parler de Stereo n’est jamais très simple lorsqu’il s’agit de le pitcher en quelques lignes. A l’arrière-plan, le film se concentre sur d’obscures expériences, mêlant sexualité et télépathie, menées en huis clos par le professeur Luther Stringfellow sur un panel de huit cobayes dans un établissement futuriste. Au premier plan, le résultat laisse transparaître en permanence le point de vue de Cronenberg sur la pensée scientifique, assimilée à un charabia pseudo-scientifique et plus fumeux qu’autre chose. Fort d’un tournage effectué avec une caméra sans prise de son directe, le réalisateur s’en tient ici à l’usage d’un jargon abscons en guise de voix off – un parti pris qui rend le choix du titre Stereo assez ironique ! Les termes zarbis s’enchaînent à la queue leu leu : « espace-continu empirique », « cybernétique socio-humaine », « intrusion schizo-frénétique », « Gestalt expérimentale parapsychologique », « système organique de dialectique », « raffinement phénoménologique » ou « sexualité tridimensionnelle » (un terme a priori utilisé pour désigner la bisexualité !). Ce qui pourrait sembler séduisant à l’oreille dans une chanson de Mylène Farmer riche en néologismes divers et variés aurait ici plutôt tendance à susciter le rire nerveux. Or, c’est un peu plus subtil que ça. Dans la diégèse du film, on sent alors l’impossibilité pour les narrateurs (ici des étudiants) à débattre autrement qu’en utilisant un verbiage hermétique, ce qui laisse à penser que Cronenberg se moque ouvertement des soi-disant « détenteurs du savoir ». Dans la conception du film lui-même, le cinéaste soutient en réalité une thèse du philosophe français Henri Bergson, selon laquelle le langage et la pensée seraient par essence incompatibles, ce qui aurait plutôt tendance à figurer la mise en alerte. Avec tant de gestes et de mouvements qui paraissent plus clairs et limpides que le discours qui prétend pourtant en livrer la clé de décryptage, Cronenberg expose sa peur première : une science faussée dont les promoteurs abusent de mots imbitables afin de propager des concepts flippants – le spectre de l’eugénisme et du fascisme est ici à l’œuvre – au détriment de l’ultime vérité universelle (celle du corps).


Au vu de certains détails qui nous font froncer les sourcils dès les premières minutes, on devine bien quelle est la cible directe de Cronenberg et l’arme avec laquelle il choisit de la fustiger. Stereo se présente très clairement comme une parodie de documentaire scientifique avec les sectes dans son angle de visée. Fringués comme des pensionnaires de Poudlard (avec canne et cape noire !), les cobayes de cette expérience sont tous soumis à un traitement à base de gélules aphrodisiaques – lequel préfigure le sevrage à l’Ephémérol dans Scanners – qui sont sensées briser leurs barrières sexuelles. La mécanique à l’œuvre dans tout le film est donc limpide : manipuler l’individu en brisant toutes ses frontières (sociales, psychologiques, sexuelles) et en mettant fin à son libre arbitre, et ce après lui avoir confisqué la parole – seul le discours des scientifiques a ici voix au chapitre. Comme si la caméra de Cronenberg, quasi entomologiste, filmait des rats de laboratoire perdus dans un vaste labyrinthe architectural à la THX 1138 et condamnés d’avance à la folie la plus suicidaire, et que sa mise en alerte visait l’uniformisation de la pensée à l’échelle humaine. Sa mise en scène, focalisée sur des symboles et des abstractions, se connecte aisément à différentes facettes du monde contemporain, tant et si bien que la liste des niveaux de lecture se fait toujours plus large – la téléréalité et le futur à la Big Brother restent des angles possibles. Mais qu’importe le visage qu’on puisse lui donner, cette « dictature des hommes nouveaux » trouve ici une incarnation d’autant plus stimulante qu’elle reste abstraite jusqu’au bout. Ce que l’on voit à l’écran durant une heure est comme de la poudre aux yeux où le son et l’image ne cessent de se contredire, où l’effet entendu ne justifie en rien les faits visualisés. Et l’humour dont fait preuve Cronenberg au détour de cette longue litanie de commentaires bidons en off lui suffit pour contourner le piège du pensum indigeste, ce qui ne semblait pas gagné au départ. Ou comment un prototype à la lisière du foutage de gueule se transforme en parabole alerte sur la dépendance et les dangers de la science. On peut appeler ça un coup de maître.
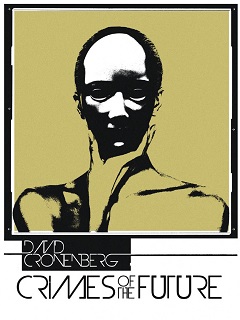
REALISATION : David Cronenberg
PRODUCTION : Emergent Films
AVEC : Ronald Mlodzik, Jon Lidolt, Tania Zolty, Jack Messinger, Paul Mulholland, Iain Ewing, William Haslam, Ray Woodley, Stefen Czernecki, Rafe MacPherson
SCENARIO : David Cronenberg
PHOTOGRAPHIE : David Cronenberg
MONTAGE : David Cronenberg
ORIGINE : Canada
GENRE : Comédie, Expérimental, Science-fiction
DATE DE SORTIE : 3 juin 1970
DUREE : 1h03
BANDE-ANNONCE
Synopsis : Adrian Tripod est le directeur de la « Maison de la Peau », institut pour riches patients atteints de pathologies dermatologiques suite à l’usage de produits de beauté. Il succède à Antoine Rouge, médecin décédé d’une maladie qu’il a lui-même découvert et à laquelle il a donné son nom. Des patients de l’Institut, il ne reste plus qu’un individu, les autres ayant visiblement succombé à l’épidémie Rouge…
Les fans de David Cronenberg le savent déjà : après huit ans de silence radio pour cause de tragédie familiale et de détour par la littérature, son nouveau long-métrage (actuellement en production) portera le même nom que son second essai. Le mystère reste entier sur le lien direct qui pourrait exister (ou pas) entre les deux films, mais il faut d’ores et déjà s’attendre à du lourd si les faits se confirment. Que pourrait bien donner le duplicata d’une expérience filmique cinquante ans plus tard, qui plus est quand le film d’origine avait centré tout son récit sur les « conséquences » d’une « expérience désastreuse » ? Fermons la parenthèse et revenons en 1970… Les expériences décrites dans les films de Cronenberg ont souvent eu pour cadre la ville de Toronto, métropole à la fois moderne et glaciale, dont l’architecture très spécifique lui permettait de donner vie à des compositions de plans et à des lignes de fuite explicites, où le processus d’étude reposait sur la position de l’individu dans le corps sociétal. Film jumeau de Stereo, Crimes of the Future reprend à son compte cette idée tout en différant par une frontalité plus affirmée, opérant de facto un réel changement dans la continuité. On aura beau renouer avec la même froideur plastique, l’ajout de la couleur signe l’entrée de Cronenberg dans un cadre bien moins abstrait et épuré. On aura beau y déceler le même effet de désincarnation chez les acteurs (surtout lorsqu’ils sont cadrés par des plans larges), une large fournée de gros plans suffit ici à leur conférer une vraie dimension maladive, jusque-là inexistante dans Stereo. On aura beau se familiariser de nouveau avec cette voix off drivée par un charabia crypto-scientifique (vous connaissez l’« import-export métaphysique » ?!?), elle n’est cette fois-ci plus omniprésente et s’harmonise au sein d’un environnement sonore expérimental, peuplé de sons étranges (notamment des bruits d’animaux et de fonds marins), qui installe de la distanciation par la simple distorsion image/son. Et enfin, le cinéaste ressort sa carte du savant fou dépassé par sa propre création, mais dans un style qui n’exclut ni l’humour décalé ni la provocation grinçante.

Forcément, au vu de tout cela, il était légitime de s’attendre à ce que Cronenberg tourne en dérision l’image des établissements médicaux. La surprise, ici, c’est qu’il choisit de le faire au travers non pas d’un autre groupe de cobayes mais d’un nouveau scientifique, protagoniste dont il stigmatise la folie et les égarements. Incarné par Ronald Mlodzik (acteur principal de Stereo, à la silhouette étrange et au regard opaque), cet individu nommé Adrian Tripod est ici le directeur de la « Maison de la Peau », un établissement clinique pour patients atteints de maladies dermatologiques, dont l’ancien directeur et la plupart des patients semblent s’être évaporés (le premier aurait a priori provoqué l’extermination des seconds à la suite d’un gros ratage scientifique). Une clinique pour le coup invraisemblable, où il ne reste plus qu’un seul et unique patient, considéré comme un objet d’amusement par les deux médecins stagiaires encore présents dans ces lieux (dont Tripod), et dont la pathologie semble se traduire par l’émergence d’une substance toxique (rouge ou blanche) qui s’écoule de ses orifices à la manière d’une menstruation. Guidé en off par la description médicale très subjective (donc forcément sujette à caution) que fait Tripod de cet étrange facteur épidémique, on pense d’abord à une fiction acquise d’avance à cette idée d’une contamination virale et généralisée, d’une maladie qui décime une population entière. Or, tout ceci n’est qu’un leurre, Cronenberg s’amusant à tourner au ridicule chaque hypothèse du héros à mesure que les faits, de plus en plus douteux, encouragent à la mise en distance.
C’est là que Crimes of the Future, finalement bien éloigné d’une quelconque satire du monde de la médecine, devient très clairement le récit d’une psychose, celle d’un schizophrène pour qui la plus minime des altérations corporelles ne peut être lue autrement que comme le signe d’une épidémie foudroyante. Plus Tripod s’enferme dans son délire interprétatif, plus Cronenberg en rajoute dans le décalage absurde. Ainsi donc, ces pratiques fétichistes visant à masser le pied humain servent à pailler l’absence de femmes, la mélancolie qui touche des malades lorsqu’on leur prélève des organes soi-disant améliorés aurait tout d’une « forme créative de cancer », et la découverte de pieds palmés chez un patient atteint d’un syndrome de dégénérescence évolutive serait la parade d’une conspiration pédophile orchestrée par une firme appelée « Institut de Thérapie Océanique » ! Bref, on sent bien que Tripod (quel nom génial !) a un grain dans sa tête, et que tout Crimes of the Future, en l’état parfaitement incompréhensible si l’on prend sa voix off au pied de la lettre, n’obéit à rien d’autre que la plongée en apnée dans une psyché déviante, pour ne pas dire carrément malsaine. La scène finale, qui confrontera de plein fouet Tripod à la source de sa névrose (une tentation pédophile qu’il tente alors de refréner, isolé dans une pièce avec un enfant), donnera le point final de cette exploration de la folie en tant qu’excroissance du désir de rationalité. Gonflé, le concept ? Ce n’est pas peu dire.


En fin de compte, si Stereo et Crimes of the Future ont une place déterminante dans la filmo cronenbergienne, c’est autant parce qu’ils en exposent intelligemment les premiers signes d’incubation que parce qu’ils justifient pleinement la dimension cérébrale (celle-là même que certains de ses soi-disant fans de la première heure conchient sans ménagement) de ses films ultérieurs, allant du Festin nu à Cosmopolis en passant par Spider et A Dangerous Method. Situé à des années-lumière de cette image de cinéaste franc-tireur qui aurait trahi son aura d’origine en tâchant de correspondre à l’image flagorneuse que l’intelligentsia lui renvoyait, Cronenberg est toujours resté Cronenberg, fidèle à son goût de l’exploration thématique et filmique. Plus on replonge dans sa carrière à des fins de rembobinage analytique, plus on se rend compte que le body horror ne devait sans doute être pour lui qu’un moyen parmi tant d’autres de coucher sur la pellicule ses obsessions et ses réflexions, et que de temps à autre, le fait d’opter pour une approche plus cérébrale et plus abstraite était aussi bien un gage de pluralité conceptuelle qu’une garantie de ne pas être systématiquement réduit aux effets explicites qui ont fait sa réputation. Pour résumer, si l’on n’a jamais vu et assimilé ces deux premiers essais, on ne peut pas prétendre connaître le cinéaste canadien. Cette mise au point s’imposait pour cibler précisément, au-delà de l’enveloppe apparente de l’entité Cronenberg, l’ambiguïté de l’esprit qui se niche derrière la vérité du corps.
