
REALISATION : Steven Soderbergh
PRODUCTION : Outlaw Productions, Virgin
AVEC : James Spader, Andie MacDowell, Peter Gallagher, Laura San Giacomo, Ron Vawter, Steven Brill, Alexandra Root, Earl T. Taylor, David Foil
SCENARIO : Steven Soderbergh
PHOTOGRAPHIE : Walt Lloyd
MONTAGE : Steven Soderbergh
BANDE ORIGINALE : Cliff Martinez
ORIGINE : Etats-Unis
TITRE ORIGINAL : Sex, Lies and Videotape
GENRE : Comédie, Drame
DATE DE SORTIE : 4 octobre 1989
DUREE : 1h36
BANDE-ANNONCE
Synopsis : John et Ann Melaney forment un couple apparemment sans histoires. Mais en vérité, rien ne va plus entre eux. Ne ressentant plus le besoin de faire l’amour, Ann se refuse à son mari. Celui-ci a décidé de la délaisser pour Cynthia, sa sœur, une femme au tempérament diamétralement opposé. Un ami de John, Graham Dalton, de retour dans sa ville natale, s’installe pour quelque temps chez les Melaney. Au départ, Ann se sent irritée par cet homme au charme évident et à la franchise inhabituelle. Jusqu’au jour où il lui révèle son impuissance, ainsi que sa manie d’enregistrer en vidéo les révélations que lui font les femmes au sujet de leur sexualité…
Palme d’or méritée en 1989, ce grand déballage impudique de l’intimité de ses quatre protagonistes fut surtout la révélation d’un grand cinéaste éclectique : Steven Soderbergh.
Lançons d’entrée une torpille problématique : une bonne mise en scène, ça tient à quoi ? Une architecture du cadre et de la scénographie qui incarne à elle seule une idée et/ou un point de vue, via un découpage qui en prolonge l’effet et la portée ? C’est en tout cas l’opinion de l’auteur de ces lignes, en général plus ou moins allergique à la fameuse technique du less is more si chère à cette intelligentsia critique française qui, en ne se fixant que sur le contenu du scénario et la direction d’acteurs, ne fait que cacher grossièrement sous le paillasson tout ce qui ordonne le langage cinématographique. Le film dont il va être question ici sera pourtant l’exception qui confirme la règle. C’est surtout qu’avec le temps, loin d’un néo-John Huston dont l’éclectisme serait corollaire d’une absence totale de ligne directrice d’un bout à l’autre de sa filmo, Steven Soderbergh a fini par imposer un style visuel et narratif qui, aujourd’hui, se reconnait presque en trois plans. Un cinéaste dont l’envolée exponentielle démarra par la meilleure rampe de lancement qui soit : en 1989, cet ancien monteur d’Hollywood d’à peine 26 ans, déjà auteur d’un film-concert pour le groupe Yes et d’un obscur court-métrage, ne mit que huit jours à rédiger sur un petit bloc-notes un scénario inspiré de l’échec d’une précédente relation amoureuse. Tourné en trente jours dans la ville de son enfance (Bâton-Rouge en Louisiane), ce premier long-métrage fut présenté à Cannes où l’incroyable se produisit : en plus de faire péter un câble au président du jury Wim Wenders (qui, selon la légende, aurait souhaité lui décerner tous les prix), Sexe, Mensonges & Vidéo coiffa au poteau Spike Lee et son Do the Right Thing, offrant ainsi à Steven Soderbergh le titre honorifique (jamais détrôné) de plus jeune cinéaste palmé de l’Histoire du festival. Consécration mille fois méritée pour un film qui, au-delà de son apparence candide et mineure, hypnotise et piège littéralement le spectateur dès la première vision, quitte à lui donner envie de le revoir à répétition. Une « vidéo-thérapie » faite film qui prend le risque – payant – de mettre en perspective son propre support.


Ayant conçu ce premier long-métrage comme une « autoanalyse sauvage », Soderbergh n’a jamais rien caché de sa propre approche du médium vidéo sur ce film : à la fois métaphore de la distance (envers les gens et les événements) et élongation extrême de la définition du voyeurisme (se sentir libre de réagir sans pour autant être vu), la vidéo invite à expérimenter soi-même ce qui est visionné sur bande – on vous épargne le parallélisme avec la célèbre théorie d’André Bazin sur la fonction intrinsèque du cinéma. Il est cependant allé plus loin en adoptant la vidéo comme cinquième personnage de l’intrigue, sorte de centre de gravité qui concentre et révèle les faiblesses humaines. Celles des quatre autres personnages : l’épouse Ann (Andie MacDowell) qui ne supporte pas qu’on la touche, son mari John (Peter Gallagher) qui quitte souvent son cabinet d’avocats à la mi-journée pour la tromper avec une autre, sa sœur délurée Cynthia (Laura San Giacomo) qui travaille comme barmaid en plus d’être « l’autre » en question, et surtout le mystérieux Graham (James Spader), vieil ami vidéaste de John dont le tempérament lunaire et introverti paraît dissimuler quelque chose de plus troublant. En effet, Graham n’a qu’une seule activité : proposer aux femmes qu’il rencontre de confier leurs fantasmes sexuels et leurs angoisses existentielles à sa caméra vidéo. Sa simple présence va vite faire voler en éclat un schéma affectif nébuleux que l’on sait riche en mensonges et en secrets insidieux. L’éternel petite rengaine adultère sur « la femme, le mari et l’amant » avec le cocon bourgeois comme cible ? Jamais de la vie. L’image en tant que vecteur de rédemption ? Il y a de ça, en effet, mais le film ne s’en contente pas, loin de là.
Au premier abord, on pouvait croire que Steven Soderbergh aurait souhaité s’incarner en nouveau transfuge d’Antonioni, à savoir axé sur l’introspection existentielle et l’incommunicabilité entre les êtres, mais au détriment d’un vrai travail sur l’architecture symbolique du décor et de l’espace. A la réflexion, on faisait peut-être fausse route. Parce que la mise en valeur du décor en tant que composante de la mise en scène n’est jamais aux abonnés absents : les intérieurs blancs et quelconques dans lesquels l’intrigue prend place offrent à Soderbergh l’occasion de structurer avant tout des déplacements et des perspectives, cadrant untel via sa découpe dans l’embrasure d’une porte ou une autre en position assise sur un canapé. Chaque scène du film exprime ainsi cette idée d’un cloisonnement à double visage : extérieur de par la position de tel ou tel acteur dans le cadre, intérieur en raison de ce système narratif visant à laisser ces autistes de l’amour parler en off lorsqu’ils ont disparu de l’écran – un parti pris qui deviendra un très fort leitmotiv de la mise en scène de Soderbergh. Et surtout, le thème central de l’œuvre du cinéaste se dessine déjà en profondeur : la « circulation des flux ». Ces choses qui circulent au sein même du virtuel et du contemporain, et qui, de Traffic jusqu’à Effets secondaires en passant par Girlfriend Experience et son immense remake de Solaris, auront imposé un véritable méta-cinéma où les forces vitales du cadre et de l’espace sont sans cesse soumises à une perversité tous azimuts. Dans le cas de Sexe, Mensonges & Vidéo, ce compartimentage des individus dans leurs propres mensonges tient sur un montage d’une froideur ironique, souvent dénigré à tort comme une enfilade de vignettes fixes au détriment de tout dynamisme, mais aussi sur l’intensité des échanges où chaque intention d’un dialogue devient sujette à caution.


Au fond, le film ne montre rien d’extraordinaire : des gens qui parlent, des gens qui sont filmés, des gens qui regardent d’autres se faire filmer, etc… Sauf que ces petits détails alimentent une atmosphère toujours plus perturbante, capable de faire vriller la comédie vers le drame psychologique (et vice versa) sans que la scène n’ait varié d’un iota dans ses mouvements de caméra – ce travelling circulaire qui accompagne la scène du dîner a valeur d’exemple. Et côté dialogues, c’est peu dire que Soderbergh, s’il choisit intelligemment de fuir le filmage explicite que le titre du film semblait suggérer, éprouve la même aisance que ses personnages à laisser ces derniers parler des sujets qui fâchent. Là aussi, une scène vaut mille mots : dès la scène d’intro où Ann confie à son psy sa peur des réactions en chaîne impossibles à maîtriser, les secrets enfouis de tout un chacun sur le sexe ou la masturbation remontent d’autant plus à la surface que ce dialogue s’accompagne d’une jointure très maline (l’arrivée de Graham et la liaison adultère de John sont parallélisées via la voix off d’Ann). La parole devient ainsi un moyen de fuir le mensonge autour du sexe, et Soderbergh se sert alors de la vidéo pour enfoncer le clou : atteindre le réel par le virtuel, renouer avec sa réalité pour mieux s’extraire de sa propre fiction. La mise en scène, souple et pudique en surface, voyeuse et perverse en profondeur, enregistre alors des gestes dont le naturel permet de tout chuchoter. Voyez cette tension érotique inouïe durant la scène du bar entre Ann et Graham, entièrement due à la façon dont la première caresse langoureusement son verre de vin. Voyez ce regard pénétrant et ces gestes erratiques de Graham lorsqu’il regarde les confessions sexuelles enregistrées par sa caméra. Et voyez, plus généralement, cette présence d’un écran secondaire qui interpelle la relation trouble entre le réalisateur et son actrice (Ann ne finit-elle pas à son tour par être « dirigée » par Graham dans le « film » de ce dernier ?). Où la caméra doit-elle se placer ? Quelle doit être la place de notre propre regard ? Où commence l’empathie, où s’arrête le voyeurisme ? La mise à nu entretenue par Soderbergh vise en définitive tous les « acteurs » de son film, c’est-à-dire ceux qui (se) réfléchissent dedans.




La longue scène de confrontation finale entre Ann et Graham – qui offrira d’ailleurs à la structure linéaire du récit son seul et unique flash-back – mettra soudainement fin à ce jeu du chat et de la souris, inversant brutalement les rôles entre celui qui interroge et celle qui se livre, et donnant accès à une vraie métamorphose intérieure. Personne n’est à l’abri d’un tel dispositif. La caméra vidéo n’est plus un outil de pouvoir, elle est le pouvoir. L’épure stylistique de l’image n’est rien de plus qu’une illusion, une simple page blanche encourageant la mise à nu de celui qui expose ses failles et ses secrets au pouvoir transperçant du médium vidéo. La justesse et la mise au point qui en découlent ont valeur d’évasion réussie, comme en témoigne ce long silence pesant de Graham quand Ann éteint la caméra et se met à l’enlacer. Ce qui se passe alors restera hors-champ, mental et implicite. Et dans cette atmosphère calme et sensuelle de la Louisiane où les femmes se baladent bras nus et où l’on boit frais (au propre comme au figuré), il faudra attendre la tombée de la pluie dans l’ultime scène du film pour avoir une preuve qu’un stade a été franchi et que la sueur du mensonge a été bien essuyée. Le calme avant la tempête : dans un sens, Sexe, Mensonges & Vidéo n’aura pas été autre chose que cela. Juste du très grand cinéma, trouble et insidieux d’un bout à l’autre, perturbant et hypnotique grâce à la bande originale synthétique de Cliff Martinez (très proche des nappes atmosphériques de Brian Eno), mais surtout habité par un immense carré d’acteurs, dominé de loin par l’impérial James Spader – primé à Cannes pour son interprétation – qui préfigurait ici les rôles sexuellement dérangés qu’il allait ensuite incarner dans Crash et La secrétaire. Quant à Steven Soderbergh, au vu d’un premier film aussi génial qu’inclassable, le reste de sa prodigieuse filmo parle pour lui : le cinéma contemporain avait trouvé là l’une de ses plus fortes têtes chercheuses.
Test Blu-Ray
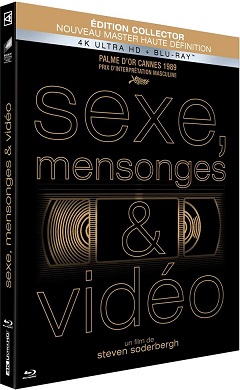
Pour bien mesurer l’éblouissante réussite de cette édition Blu-ray longtemps espérée pour le premier chef-d’œuvre de Steven Soderbergh, un petit rembobinage des faits s’impose… Octobre 2000 : une première édition DVD voit le jour grâce à Pathé, mais se contente de servir le film sur un pressage granuleux lamentable et le prive de tout bonus… Mars 2003 : MGM récupère les droits d’édition du film pour ne rien apporter de plus, si ce n’est une bande-annonce bidon et une jaquette DVD d’une laideur effroyable… Février 2010 : l’honneur devient sauf grâce à Sony Pictures, via une édition DVD estampillée « DeLuxe » qui offre enfin un pressage SD de qualité estimable tout en offrant quelques bonus dignes de ce nom mais trop peu nombreux… Ce sont justement ces bonus-là que nos amis de L’Atelier d’images ont pris soin de récupérer pour cette première édition Blu-ray. Tout d’abord un passionnant commentaire audio qui, comme toujours avec Soderbergh, relève davantage de la discussion avec un invité – en l’occurrence le réalisateur Neil LaBute – en vue de creuser le sujet du film et d’évoquer les différents choix narratifs et scéniques. On retrouve ensuite deux petits modules d’interviews, hélas beaucoup trop succincts : le premier date de la sortie du film et laisse Soderbergh s’exprimer sur son film, et le second permet de retrouver le réalisateur et ses acteurs (hormis James Spader) en train de fêter les 20 ans du film au festival de Sundance. Et ne manquez surtout pas les deux petites bandes-annonces, dont une, réalisée et commentée par Soderbergh lui-même, prouve bien que ce genre de bonus souvent qualifié de « remplissage » peut parfois être un supplément de premier choix.
Du côté des bonus inédits (tous très récents), la valise est sacrément chargée et il n’y a rien à jeter. Pièce maîtresse de cette édition Blu-ray, l’indispensable Philippe Rouyer (critique à Positif et cinéphile ô combien précieux) revient durant une vingtaine de minutes sur l’historique du film, sa production, son casting, sa musique, son succès cannois et commercial, son impact sur le cinéma indépendant américain et son utilisation de la vidéo. Un tour d’horizon on ne peut plus complet, le tout avec quelques pistes analytiques sur la mise en scène que Rouyer complète encore davantage par une analyse séquentielle du climax final. Soderbergh revient ensuite, le temps d’une interview réalisée en 2018 et là encore trop courte, pour revenir de façon synthétique sur le propos central du film et l’aura de ses personnages, tout en se livrant à une description très « mathématique » de la narration du film. Pour le reste, on ne sait pas si James Spader n’aime pas s’exprimer sur ses films, mais pour l’évocation des coulisses du tournage par le carré d’as du casting, il est une fois de plus le seul à ne pas répondre présent. Les trois acteurs restants (Andie MacDowell, Peter Gallagher et Laura San Giacomo) reviennent longuement et amoureusement sur ce film qui a très clairement changé leurs vies et (re)défini la direction de leurs carrières respectives. Entre autres anecdotes, on retiendra surtout Andie MacDowell en train de souligner ce « changement de paradigme » que le film a provoqué sur son image en tant qu’actrice, ou encore Peter Gallagher évoquant un joli coup de pute d’Harvey Weinstein durant la promo américaine. Un petit entretien réunissant le compositeur Cliff Martinez et l’ingénieur du son Larry Blake ferme parfaitement la marche en dévoilant, au beau milieu de nombreux souvenirs personnels des deux hommes, à quel point ce film fut aussi une rampe de lancement fabuleuse pour les techniciens qui travaillèrent dessus.
Et le film, alors ? C’est bien simple : on ne l’a jamais vu dans un état aussi splendide et la précision du piqué HD permet clairement de le redécouvrir, mettant en exergue un large éventail de détails que l’on n’avait pas forcément remarqué au premier abord – observez bien l’arrière-plan pendant les scènes qui prennent place dans le bureau de Peter Gallagher. Les pistes sonores, de leur côté, soutiennent les dialogues et la musique de Cliff Martinez avec l’équilibre le plus adéquat pour profiter de chaque instant. Au final, on se dit tout connement que jamais ce chef-d’œuvre absolu n’avait été aussi bien servi par le support physique. Que des bravos.
>>> Informations et précommande sur le site de L’Atelier d’images
