
REALISATION : Sean Penn
PRODUCTION : FilmHaven Entertainment, Gerber Pictures, Mars Films, River Road Films
AVEC : Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos, Jean Reno, Jared Harris, Denise Newman, Oscar Best, Zubin Cooper
SCENARIO : Erin Dignam
PHOTOGRAPHIE : Barry Ackroyd
MONTAGE : Jay Cassidy
BANDE ORIGINALE : Hans Zimmer
ORIGINE : Etats-Unis
GENRE : Drame
DATE DE SORTIE : 11 janvier 2017
DUREE : 2h11
BANDE-ANNONCE
Synopsis : Au Libéria, pays d’Afrique ravagé par la guerre, le docteur Miguel Leon, médecin humanitaire, et le docteur Wren Petersen, directrice d’une ONG, tombent passionnément amoureux l’un de l’autre. S’ils sont tous les deux engagés corps et âme dans leur mission, ils n’en sont pas moins profondément divisés sur les politiques à adopter pour tenter de régler le conflit qui fait rage. Ils devront surmonter leurs clivages et le chaos qui menace d’emporter le pays tout entier, sous peine de voir leur amour voler en éclats…
Nous sommes le vendredi 20 mai 2016. Il est 8h30. Le soleil s’est levé sur la Croisette, la fin du 69ème Festival de Cannes se rapproche, la fatigue se fait un peu ressentir, mais pour l’instant, la projection presse du très attendu The Last Face de Sean Penn est sur le point de démarrer. L’auteur de ces lignes, bien que déjà rodé à l’effet Cannes depuis quelques années, ne sait pas encore à quel point les 132 minutes qui vont suivre seront sur la première marche du podium de ses séances les plus mémorables. Au vu d’un sujet à peu près aussi engagé que le réalisateur lui-même (a priori un récit centré sur l’action de Médecins du Monde), les paris étaient tout de même ouverts : au mieux, un drame humaniste et complexe fouillant les injustices dans le Tiers Monde avec un sens du cinéma mis en parfaite adéquation (ce qui justifierait ainsi une sélection en compétition cannoise) ; au pire, un énième film d’indigné à tendance démago qui ferait primer le consensualisme du fond sur l’universalité de la forme. On était loin de la vérité. Et il n’aura fallu en réalité pas plus d’une minute pour que le sort du film soit immédiatement scellé. Juste le temps d’un carton d’introduction édifiant, mettant sur un pied d’égalité – en tout cas pour l’Occident si l’on en croit le texte affiché – la violence des conflits guerriers en Afrique et « la brutalité d’un amour impossible entre un homme… ». Les points de suspension nous incitent à attendre quelque chose d’inattendu. Un homme ? Un animal ? Une arme ? Un ordinateur ? Non. Après cinq secondes de faux suspense sur écran noir, la réponse tombe : « … et une femme ». Le fou rire est immédiat, inattendu, irrésistible. On s’interroge, hagard et effaré : le film entier va-t-il être de ce niveau-là ? La réponse est oui. Et à la sortie de tout ça, en guise de petite cerise subversive sur un gâteau de rejets critiques déjà au bord de l’overdose, ce cher Luc Besson aura aidé à prolonger les fous rires incontrôlés avec un tweet mémorable :
Press killed Sean Penn's movie in #Cannes.
Sooo easy! Sean has courage that they will never have.
The film is a master piece.
I loved it!!— Luc Besson (@lucbesson) 21 mai 2016
LE DERAPAGE CANNOIS
Plusieurs mois auront été nécessaires pour savoir ce qui a bien pu se passer pour en arriver là. Il ne fallait déjà pas compter sur l’équipe du film, suffisamment sonnée par l’accueil cannois, qui aura choisi – à juste titre – de faire profil bas, y compris lors d’une très discrète sortie française en janvier 2017 – le film fut même privé de sortie en salles aux Etats-Unis. En fait, il aura fallu davantage compter sur Thierry Frémaux [NDLR : le délégué général du Festival de Cannes] pour cibler déjà une large partie du problème. En effet, l’origine de la sélection cannoise de ce maxi-navet était à choper au travers de quelques pages de ce passionnant journal de bord intitulé Sélection Officielle, dans lequel Frémaux revenait en détail sur son planning entre les deux dernières sélections cannoises (une cuvée 2015 très honorable et une cuvée 2016 particulièrement riche) :
– 15 février 2016 – La découverte d’une copie de travail non finalisée fut la première étape : « The Last Face est une histoire d’amour au temps des missions humanitaires, et une belle ambition de cinéma : la façon qu’a Sean de tremper sa caméra dans le sang d’une Afrique ravagée par les guerres renvoie à ses propres engagements, en Haïti et ailleurs. Sur la mise en scène, on retrouve ses partis pris visuels avec usage puissant de la caméra et ralentis parfois intempestifs. Le film a du charme et est traversé par des éclairs de force. La complexité narrative voulue n’est pas encore aboutie et certaines scènes sont inutiles, mais Sean le sait […] Il me détaille les changements qui restent à faire. Exercice toujours délicat de commenter le travail des cinéastes : la part de l’amitié le dispute à celle de l’exigence et il ne faut ni complaire ni blesser. Ce qu’il m’a montré est prometteur mais aura-t-il terminé à temps ? […] Comme tout cinéaste, il défend très bien son travail ». Le même jour, Frémaux reçoit un coup de téléphone de Stéphane Célérier, le distributeur du film, qui lui fait le forcing pour Cannes avec un argument-massue : « Sean Penn, Charlize Theron et Javier Bardem : tu imagines la montée des marches ? »… Aïe… Voilà bien l’argument idiot qui n’aurait jamais dû être lâché…
– 22 février 2016 – Alors que Sean Penn lui annonçait la veille son désir d’affronter la compétition cannoise, Frémaux prend sa décision : « J’ai confirmé à Sean que son film était pris en compétition. Je n’ai rien revu mais je fais confiance au réalisateur de The Indian Runner et Into The Wild. Premier film américain sélectionné pour Cannes ! ». A ce stade, tout est dit : d’abord un film sélectionné en compétition sans que quiconque ne l’ait vu terminé (ce qui peut toutefois donner lieu à de belles surprises, comme l’a prouvé la sélection périlleuse du magnifique 2046 de Wong Kar-waï), mais surtout assez de raisons pour fustiger cette « logique » selon laquelle faire péter un tapis rouge avec plein de stars glamour bien habillées serait un critère justifiant à lui seul une compétition pour la Palme d’Or. Sans oublier le fait qu’un cinéaste jugé talentueux au vu de ses passages récurrents à Cannes (ou ailleurs) peut à tout moment – et sans s’en rendre compte – poser une vilaine pêche sur l’écran du Palais des Festivals.
– 20 mai 2016 – La lame de la guillotine tombe enfin sur un film qui croule sous moult reproches argumentés ici et là, et pour Frémaux, il est l’heure de constater l’étendue des dégâts : « La catastrophe s’est produite. La presse rejette The Last Face. Depuis ce matin, des textos me parviennent par dizaines […] On peut toujours chercher une explication mais il n’y en a qu’une : le film ne plaît pas. La foudre va lui tomber dessus. Et je connais les lois cannoises : Sean sera traité comme un moins-que-rien. Je m’en sens coupable, parce que c’est un ami, parce que je l’ai emmené là. Il va juste falloir vivre avec ça […] Sean est un type qui ne prend pas la pose mais son visage est marqué. Il l’est par les ans, par les combats et les nuits courtes. Et par ce qu’il est en train de vivre. Aujourd’hui, il est dans le doute et la souffrance ».

Que le réalisateur de Valérian ait tenu lui-même à vilipender une presse jugée excessivement assassine (mais a-t-il seulement lu les arguments avant de râler ?) et à qualifier le film de « chef-d’œuvre » (rires) fait d’ailleurs pâle figure au vu de ce que l’on vient d’évoquer à propos du choix de Thierry Frémaux. Le problème est plus large, puisque l’amitié envers un artiste devient ici un critère de qualité qui semble aller au-dessus de la valeur réelle du produit fini, et qu’importe si ce dernier doit au final figurer dans une sélection ouvertement jugée comme devant être la plus prestigieuse de l’année cinématographique. D’autant que, dans le cas de Besson, c’est kif-kif : son amitié avec Sean Penn est si avérée que sa réaction pue l’hypocrisie déplacée (il semble être moins question de défendre un film que de consoler un ami). Alors que la presse, elle, se contente de juger des films, avec subjectivité et loin de toute forme de copinage – c’est en tout cas la vision que défend l’auteur de cette analyse. L’affaire The Last Face a donc quelque chose de terrible dans le sens où elle engendre un constat sans appel, du genre à ternir à jamais la réception d’une œuvre et à lui offrir la pire médiatisation qui soit : même en considérant que joindre le geste (= mise en scène) à la parole (= propos) reste capital pour mettre en valeur un engagement (que ce soit envers un artiste ou un idéal humaniste), le règne de l’entre-soi persiste à jouer le rôle du parasite, engendrant maladresse dans l’envoi du message et irritation dans la réception de ce même message. Et on n’a pas l’impression d’extrapoler quoi que ce soit en disant cela…

LE CANTIQUE DE LA RACAILLE
La dimension du rejet critique envers The Last Face n’aura en tout cas rien fait pour passer inaperçue, tant le film sera rentré malgré lui dans l’Histoire : outre une presse unanimement liguée contre lui (pas un seul papier positif !), le film aura réussi l’exploit de récolter la pire moyenne critique jamais enregistrée à Cannes (à peine 0.2 sur 4 !), battant de ce fait le score désastreux du très raté Nos souvenirs de Gus Van Sant (présenté en compétition l’année d’avant). Pour autant, le degré d’ineptie du texte d’introduction que l’on évoquait plus haut aura pesé très lourd dans ce déchaînement de haine. Pas seulement en raison d’une comparaison donnant au mot « indécence » un relief que l’on ne soupçonnait pas, mais surtout de par le manifeste qu’elle entretient sans aucune justification. En résumé, pour Sean Penn, oser comparer les horreurs de la guerre et la violence des sentiments amoureux semble propre à l’Occident et n’a pas à être discuté. Osons lui répondre qu’en effet, il n’y a pas à contester cela. Parce que si le film arrive à révéler quelque chose de propre à l’Occident vis-à-vis des injustices présentes dans le reste du monde, c’est son irrémédiable capacité à se sentir engagé et concerné sur un sujet qui lui échappe. Et c’est sur ce point précis que la vision arrogante et suprématiste de Sean Penn en dit long sur l’état d’un microcosme hollywoodien coincé dans sa bulle.
On a beau croire en la sincérité de l’engagement militant de Sean Penn (ne serait-ce qu’au vu de son action en Louisiane et en Haïti), toute résistance est ici inutile face à ce qui oscille entre la bêtise et l’inconscience. Bien qu’adapté d’un scénario qui n’est pas le sien (on le doit en effet à Erin Dignam, autrefois réalisatrice d’un Loved avec Robin Wright, ex-épouse de Penn), The Last Face aurait pu servir de regard détourné sur son parcours personnel. On résume : ancien bad boy du cinéma de l’Oncle Sam, lourd passif d’acteur multi-récompensé, président du jury cannois en 2008 (son désir de récompenser un film politique fut d’ailleurs très clairement exprimé), et réalisateur à la filmo jusque-là marquée par un beau drame intimiste (The Indian Runner), deux solides polars (Crossing Guard, The Pledge) et un trip hippie consensuel (Into the Wild). Revêtir la casquette de citoyen engagé est ce qui aurait pu lui permettre de relier tous ces points, traçant ainsi une destinée faite de hauts et de bas jusqu’à un vrai examen de conscience. Or, ce nouveau film ne fait que l’inviter à se remettre encore plus en question, surtout dès qu’il s’agit de prendre le pouls d’une situation de guerre – située qui plus est sur un autre continent que l’Amérique – et de la traiter avec un minimum de dignité. Parce qu’à l’instar du nauséabond Blood Diamond d’Edward Zwick (en dix fois pire), Sean Penn redonne ici chair à une vilaine tendance du cinéma US, visant à valoriser ses stars glamour sur fond d’un chaos planétaire qu’il ne saisit pas, à appuyer très fort sur la plaie du pathos, et à laisser toute trace de subtilité cramer sous le soleil de la caricature.

Un terme – extrêmement péjoratif – souvent utilisé pour qualifier une personne au-delà du méprisable est le suivant : « racaille ». Voilà bien un terme que l’on n’hésitera pas une seconde à employer pour qualifier tous ceux qui ne cessent de concevoir les drames humanitaires comme des usines à rétentions hypocrites, là où le réveil des consciences passe avant tout – consciemment ou pas – pour un faire-valoir commercial (et c’est en soi encore pire que d’oublier de traiter ce thème ou de l’éjecter du récit). Car ils sont nombreux, ces pseudos-divertissements indignés pour bobos, où la mise en avant du sujet passe sans cesse avant la justesse de son exploitation, où une horreur filmée sans ménagement sert de caution bêta à une vision manichéenne du monde (en résumé, les « très gentils » face aux « très méchants »), où le parcours évolutif de personnages-fonctions cherche à tout prix la culpabilisation d’un spectateur en mal de conscience humanitaire. Et pour ce qui est de la nuance, désolé, on s’est juste trompé de film. En l’état, The Last Face réussit l’exploit de décupler chacune de ces caractéristiques par un coefficient multiplicateur de maladresse rarement égalé.
A l’instar d’un BHL qui refuse de salir sa chemise repassée en allant au contact des combattants anti-Kadhafi, Sean Penn a ici revêtu malgré lui la panoplie du touriste engagé dont la force du militantisme serait censée anéantir celle du moindre reproche, quand bien même l’autopromotion flatteuse en devient tangible et gênante. Car il ne faudra pas chercher bien loin pour déceler dans le personnage de Javier Bardem une sorte de double inavoué : un beau gosse baroudeur, aussi séduisant et mal rasé que Bernard Lavilliers, qui attire les beautés féminines comme un aimant, à commencer par une Charlize Theron qui était encore à l’époque la compagne de Penn dans la vraie vie – ce choix de casting est une preuve en soi. De ce fait, au beau milieu d’un continent africain filmé comme une pub Jacques Vabre, deux espaces sont alors moins voués à se confondre qu’à se confronter. D’un côté, un couple de médecins humanitaires formé par Charlize Theron et Javier Bardem, forcément bien coiffés et bien éclairés, qui se font des regards mielleux quand ils ne sont pas carrément cadrés comme des gravures de modes hyper « sexe », incarnant de ce fait un humanisme packaging qui sonne déplacé. De l’autre, des Africains qui n’accèderont même pas à la caractérisation minimale d’un vrai rôle : tantôt des miséreux qui ne sont bons qu’à hurler et à pleurer au cœur de l’enfer, tantôt des milices armées formées par d’abominables raclures dopées à la coke et à la violence gratuite – les voir attifés comme les punks d’un bon vieux post-apo de Sergio Martino suscite d’ailleurs un léger fou rire.

Cette absence totale de recul conditionne notre propre recul de spectateur, achevant ainsi de rendre le film profondément dégueulasse. Au-delà d’un peuple africain réduit à un amas de chairs meurtries (ou meurtrières) que l’on repousse honteusement à l’arrière-plan, il ne reste ici que les représentants d’un Occident libérateur et supérieur, filmés dans une belle lumière dorée, qui passent le plus clair de leur temps à se rouler des pelles, à se brosser les dents face-à-face devant un rideau (?!?) ou à s’engueuler comme des cocufiés chez Danièle Thompson. En gros, ils viennent aider ceux qui souffrent, mais le film met en avant leur propre souffrance de couple en crise, en lâchant des phrases supra-sentencieuses dans les pires situations possibles, créant ainsi le plus abject des contrepoints. De quoi rendre encore plus vomitive la leçon de morale délivrée au terme de ce calvaire humanitaire : en gros, les réfugiés ont une histoire, un métier et des rêves, ils savent lire, ils sont des êtres humains, et il ne faut pas rester inactifs face à leur douleur. Presque aussi fort que notre Steven Seagal adoré qui, à la fin de son inénarrable Terrain Miné, lâchait soudain un discours écolo juste après avoir fait exploser une station pétrolière en plein Alaska !
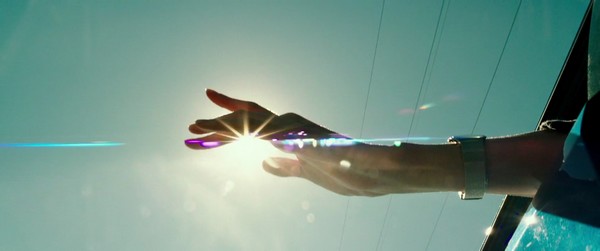
LE STYLE ET LA MANIERE
Devant ce qui s’apparente à un authentique porno tiers-mondiste, avant tout destiné à un panel de pseudo-intellectuels engagés qui s’en vont flatter leur narcissisme dans des pays ravagés par les génocides, il y aurait de quoi redonner du poids à cette définition de l’abjection par Jacques Rivette lorsque ce dernier évoquait le Kapo de Gillo Pontecorvo dans un texte des Cahiers du Cinéma. Sauf que si ce texte mettait en avant quelque chose de pertinent, à savoir la responsabilité du cinéaste dans ce qu’il choisit de montrer, il reste encore aujourd’hui très controversé sur l’attitude à adopter vis-à-vis de l’option choisie par le cinéaste pour « montrer ». Dans le cas présent, l’abjection se voit davantage alimentée par de grossières intentions de montage que par le degré d’horreur de la scène visualisée. On s’interrogera longtemps sur ce qui a poussé Sean Penn à se sentir obligé de singer Michael Bay avec un sujet totalement aux antipodes, mais les faits sont là : du pompiérisme visuel à tous les étages, allant d’une flopée de plans pseudo-malickiens à un Scope stylisé façon clip MTV en passant par des effets de style gratuits tels que le zoom racoleur ou le ralenti à outrance. Sans parler d’un abus de musiques grandiloquentes, compilant Ismael Lô, Mary J. Blige et Hans Zimmer comme pour dessiner une bande-son faussement cosmopolite qui tape vite sur le système.
Cela dit, si l’ensemble ne se limitait qu’à cette enjolivure de gros blockbuster hollywoodien pété de thunes, on pourrait juste parler d’un manque de recul et accorder à Sean Penn le bénéfice du doute au vu de l’industrie dans laquelle il évolue. Sauf que cela reviendrait à passer sous silence que The Last Face, si l’on regarde bien, n’a pas grand-chose d’un produit fini. Observez ces trois quarts de plans approximatifs où le cadre semble envahi par un flou injustifié – problème de focale ou conséquence d’un chef opérateur presbyte ? Voyez ce hachage de plans en caméra portée qui saucissonne l’action à défaut de s’y immerger réellement – on a d’autant plus de mal à essayer de saisir l’ampleur du conflit guerrier. Admirez ce spectacle d’enfants du Liberia charcutés au ralenti sur fond de musique planante pour Natures & Découvertes – un choix musical qui pue l’improvisation en urgence tout en étant obscène à souhait. Cherchez une quelconque idée de cinéma dans ce moment professoral où Theron, flanquée d’un saladier dans lequel elle verse des matières diverses, énonce un point de vue que le découpage n’incarne jamais. Sans oublier la Palme d’Or du raccord méga-con qui ne sert à rien : l’utilisation du morceau Overside des Red Hot Chili Peppers comme lien implicite entre l’opération chirurgicale d’un petit enfant africain mutilé, la baise fougueuse du tandem principal sur le lino de leur chambre, et une dispute en voiture sur le trop-plein machiste de monsieur (il semblerait que madame ait trouvé les paroles de la chanson beaucoup trop vulgaires…). C’est à peine croyable. Et ça fait autant de dégâts sur l’esprit qu’une bombe à fragmentation sur le corps.

Le taux commun de débilité et d’obscénité a déjà tellement crevé le plafond que seul un humour involontaire pourrait servir de porte de sortie rassurante. Là-dessus, pas de quoi s’affoler : le potentiel de The Last Face à nourrir les pages du site Nanarland semble tout tracé. Déjà pour un sidérant raccourci involontaire avec les conventions du bis cannibale italien en mode Lenzi-Deodato, dont le postulat invariable – une équipe d’occidentaux mal incarnés débarquent en terre inconnue et se confrontent à une surenchère gore révulsive – se voit ici reproduit avec les mêmes défauts de fabrication. Ensuite pour un casting français qui élève très haut le taux de gêne carabinée : outre une Adèle Exarchopoulos qui fait intervenir un suspense malsain à base de contamination sidéenne en plein désastre humanitaire, on savourera un Jean Reno mauvais comme c’est pas permis en « Docteur Love » (ça ne s’invente pas !) qui balance de grandes théories sur l’amour à peine dignes d’un cours d’hédonisme par Patrick Sébastien. Enfin pour des dialogues d’une connerie abyssale qu’il serait impossible de recenser ici en totalité. Comme on vous aime bien, voici quand même quelques exemples : le coup de foudre (« Avant de le rencontrer, j’étais l’idée de moi-même »), la dispute conjugale (« Ce n’est pas parce que tu m’as pénétrée que tu me connais »), la dignité conservée d’une Africaine victime de violences (« Elle a des fuites urinaires, mais elle danse »), la lecture de la guerre comme moteur aphrodisiaque (« Sans la guerre, il n’y aurait sans doute pas de Nous »), etc… C’est beau, un film qui se saborde lui-même…

Au début de cette effarante centrifugeuse de l’ethnocentrisme, on aura quand même pris soin de relever un intéressant échange verbal – en réalité le tout premier du film – entre Bardem et Theron. Peu avant de se rendre à une réception où la miss doit prononcer un discours humaniste à destination des plus grands donateurs de New York, l’homme s’interroge : « Il y aura d’abord un concert. Pourquoi faut-il les divertir pour qu’ils écoutent ? ». La réponse de Theron ne se fera pas attendre : « Il est bon de rappeler ce que l’humain peut faire d’autre ». Où voulait réellement en venir Sean Penn avec une phrase pareille ? Que faire entendre une vérité doit passer à tout prix par le recours à l’effet de spectacle et d’expression artistique ? Si c’est le cas, ce qui devrait passer en principe pour la fonction première de l’art en général (et pas seulement le cinéma) est ici un terrible aveu d’échec pour le cinéaste : le spectacle qu’il aura filmé pendant 131 minutes crie une vérité qu’il se révèle incapable d’incarner par faute d’une mise en scène qui ne cesse de hurler l’exact inverse. L’ampleur du dérapage est telle qu’on peine à croire que Sean Penn saura s’en relever, d’autant qu’on connait des carrières qui se sont écroulées d’un coup sec pour moins que ça. Trop de tout, et au final rien du tout : The Last Face est un désastre magnifique, du genre à servir d’outil pratique à tout cinéphile désireux de travailler son esprit critique. Il faut le voir pour le croire. Parce qu’on peine à croire qu’on puisse encore voir un truc pareil à notre époque. Bisous Sean, et surtout, merci pour ce moment.
