
REALISATION : Alejandro Amenabar
PRODUCTION : Las Producciones del Escorpion, Sogepaq Distribucion SA
AVEC : Ana Torrent, Fele Martinez, Eduardo Noriega, Javier Elorriaga, Miguel Picazo…
SCENARIO : Alejandro Amenabar
PHOTOGRAPHIE : Hans Burmann
MONTAGE : Maria Elena Sainz de Rozas
BANDE ORIGINALE : Alejandro Amenabar, Mariano Marin
ORIGINE : Espagne
GENRE : Thriller
DATE DE SORTIE : 4 décembre 1996
DUREE : 2h04
BANDE-ANNONCE
Synopsis : Angela, étudiante en communication, prépare une thèse sur la violence dans les médias. Son directeur de recherche se propose de l’aider à trouver des films aux images violentes dans la vidéothèque de l’université. Le lendemain, il est retrouvé dans la salle de projection. Angela découvre le corps et vole la mystérieuse cassette que le professeur regardait avant de mourir. Elle décide alors d’enquêter aux côtés de Chema, un étudiant fasciné par les films gore. Ils découvrent bientôt l’existence d’un réseau de snuff movies au sein même de l’université…
C’est sans doute LE sujet qui suffit à déchaîner les passions au sein même de la sphère critique, et ce depuis que le 7ème Art existe : la violence des images filmées. A bien des égards, ce qui continue de rendre ce sujet éminemment complexe et brûlant réside sans doute dans ce qui reste en filigrane, à savoir la question du voyeurisme au sein même du propos et du dispositif de mise en scène. Il en résulte toujours la même dichotomie, ressassée ad nauseum : pour les uns, aborder frontalement ce genre d’images reviendrait à faire preuve de racolage, et pour les autres, privilégier au contraire le hors-champ et la suggestion ne servirait qu’à révéler la frilosité (voire l’incapacité) du cinéaste à aborder de plein fouet son sujet. Montrer la violence ou la suggérer : cette question a-t-elle encore un sens ? De là en découle les divisions critiques les plus virulentes, plaçant parfois le spectateur dans un entre-deux difficile à cerner. A ce jour, on pourrait discerner deux films ayant réussi à esquiver ce piège, voire à l’annihiler purement et simplement dans le cas du second. D’un côté, en 1993, Michael Haneke évoquait avec Benny’s video un adolescent tueur, fasciné par les images violentes et finalement couvert par ses parents. Le film ne visant qu’à installer le doute sur la véritable psyché de son protagoniste, il ne fallait alors à Haneke qu’une gestion démoniaque du hors-champ pour donner chair au plus croissant des malaises. De l’autre côté, le jeune Alejandro Amenabar (à peine 23 ans !) choisissait trois ans plus tard d’investir le sujet brûlant des snuff movies en vue d’un propos actuel sur le voyeurisme des images. Le résultat, multi-récompensé aux Goyas à sa sortie, continue encore de nous flanquer de sacrées montées de trouille.

Là encore, lorsque des cinéastes s’attaquent au thème du snuff, c’est en général pour le traiter n’importe comment, voire pour s’en servir d’appât narratif. A titre d’exemple, on se souvient encore du détestable 8mm, où Joel Schumacher explorait cette légende urbaine comme prétexte à une apologie puante de l’auto-justice. Là où Amenabar se démarque avec brio, c’est en choisissant d’une part d’explorer son propos à travers les codes du cinéma de genre, et d’autre part de questionner le voyeurisme de son héroïne (et, par extension, du spectateur) par le biais de sa seule mise en scène. Tesis sera donc un pur thriller, dont la structure narrative lorgne autant vers le cinéma hitchcockien que du côté de l’investigation rajeunie tendance Le Club des Cinq. D’entrée, la scène de crime est plantée, les enquêteurs en herbe sont identifiés : une université si banale et gavée de couloirs sombres qu’un terrible secret semble s’y cacher, la belle Angela (Ana Torrent, qui avait alors bien grandi depuis Cria Cuervos) comme étudiante fascinée par les images violentes, l’asocial Chema (Fele Martinez, vu depuis chez Pedro Almodovar) comme coéquipier boutonneux et gavé aux films gore, l’inquiétant Bosco (Eduardo Noriega) comme beau gosse ténébreux et indiscernable, sans parler d’un professeur très antipathique pour qui faire du cinéma consiste à montrer au public ce qu’il veut voir (« C’est une industrie, c’est de l’argent, sans communication possible entre le créateur et le public »).
Sur le plan du thriller, Amenabar assume pleinement la dimension de rollercoaster flippant que peut susciter une telle disposition de pions, jouant à plein régime sur les montées d’angoisse et les retournements de situation, jusqu’à un final qui glace littéralement le sang. Pour susciter l’effroi, le jeune cinéaste tire sans cesse profit de son petit budget en optant pour une approche économe de la terreur, assez similaire à celle d’un film comme Ring : un voyant rouge dans l’obscurité (celui d’une caméra qui enregistre ?), des doigts stressés qui tapent sur un bureau, une poignée de porte qui bouge, une coupure totale de courant dans un couloir souterrain, une bande-son atmosphérique que l’on doit au cinéaste lui-même, ou plus simplement le regard perçant d’un acteur, idéal pour susciter l’ambiguïté et le trouble (Eduardo Noriega reste un cador dans ce registre). Tout ceci, couplé à une montée graduelle de l’horreur et du rythme (les poursuites dans les couloirs sont d’une intensité folle), suffit déjà à mettre le spectateur échec et mat, totalement largué entre jouissance et malaise.


Pour autant, comme on l’évoquait plus haut, Amenabar ne se contente pas juste d’un tour de train fantôme parfaitement exécuté de A à Z. Son approche théorique sur la violence, et plus spécifiquement le snuff, prend racine dans l’un de ses premiers courts-métrages, intitulé Himenoptero, dans lequel il se filmait en train d’écraser une fourmi en gros plan. Son postulat était le suivant : le fait de tuer un insecte peut passer pour un acte désintéressé, surtout dans la mesure où l’on ne s’en aperçoit pas, mais dès que l’insecte manifeste un bruit précis pour signaler son agonie, c’est toute notre perception de l’acte qui se retrouve inversée. Rien d’étonnant à ce que Tesis soit à des kilomètres d’un thriller hypocrite sur les images violentes, qui finirait par tirer parti de ce qu’il dénonce : en effet, le film ne contient aucune image gore et le sang y coule à doses homéopathiques. Dans son ensemble, la grande subtilité du film réside autant dans l’identification absolue avec l’héroïne (la mise en scène prend soin d’épouser chaque variation de son point de vue) que dans un découpage d’une maîtrise dingue, plaçant le spectateur au cœur des enjeux par un équilibre magistral entre ce que l’on perçoit (surtout par le son) et ce que l’on croit avoir vu (et pas forcément par l’image). C’est là que le thème du snuff, loin de donner du grain à moudre à on ne sait quelle dénonciation scolaire des images violentes, sert au contraire à Amenabar d’outil pour théoriser de façon sensorielle sur le pouvoir des images.

Tout le film se révèle alors bâti comme un gigantesque échiquier, où chaque pion avancé, en général un effet sonore ou une idée narrative, peut servir autant à briser une pièce établie, à savoir notre perception, qu’à susciter le doute sur son impact et sa fonction. Le cinéaste joue d’ailleurs sur les mises en parallèles pour illustrer ce trouble, parfois à des fins narratives (le montage sonore présente ici Chema et Angela au travers de leurs goûts musicaux), souvent pour dévier notre perception d’un événement sordide. Début du film : dans une rame de métro, un policier indique l’arrêt du véhicule à cause d’un suicide sur la ligne. Fin du film : une journaliste condamne l’horreur du snuff avant d’annoncer son visionnage dans le journal télévisé, soi-disant par souci documentaire. Dans le premier cas, Angela s’intéresse au cadavre sur la rame, mais on l’empêche de le voir. Dans le deuxième cas, elle s’en désintéresse, laissant l’obscénité derrière elle. Mais à chaque fois, Amenabar renoue avec la cruauté intrinsèque du cinéma d’Hitchcock, utilisant le montage pour mieux interroger notre voyeurisme, titillant aussi bien notre attente que notre dégoût.
Filmer la violence, ici marquée par le hors-champ visuel et l’omniprésence du son, relève chez lui du même principe. Lorsqu’Angela regarde le snuff chez elle, l’écran reste noir, seul le son est activé. Tout ce qui fixe notre attention, c’est son propre regard, réceptacle de sa fascination. Quant aux rares instants où le snuff est « visible », Amenabar le laisse à l’état de flashs furtifs ou triturés (voir ce plan subjectif où les doigts d’Angela tranchent littéralement l’écran) quand ce n’est pas une voix externe qui en détaille le contenu. Et on adoptera sans cesse le regard de l’héroïne, horrifié par ce que l’on (sous-)entend, effrayé à l’idée de devoir ouvrir un peu les yeux pour « voir ». Ici, un regard furtif chez l’actrice = un plan furtif dans le montage, signe de la subjectivité implacable d’Amenabar.

Pour autant, du propre aveu du cinéaste, le sujet central du film réside dans l’idée de voir des personnages en train de « toucher la mort ». Ce qui se traduit dans le film par un autre parallèle, qui cimente en soi la structure du scénario, de son début (Angela touche le visage de son professeur décédé) jusqu’à sa fin (le méchant touche presque la main d’Angela, laquelle s’apprête à le tuer). On notera que, si les personnages puisent leur énergie interne dans leur quête de l’interdit, c’est seulement lorsqu’ils se retrouvent en danger ou dans l’inconfort que leur vérité intérieure voit le jour. Il suffit de revoir la scène où Bosco interroge Angela en la filmant : il ne la voit qu’au travers du média, lequel, par extension, saurait percer l’âme du sujet filmé. Dès qu’Angela est filmée par un objectif, il y a chez elle un mensonge (elle feint de savoir de quelle couleur sont les yeux de Bosco) ou un danger de mort (elle est attachée à une chaise, face au bourreau qui s’apprête à la torturer). Et lorsqu’elle examine le contenu d’une vidéo trouvée chez Chema, se met-elle à pleurer parce qu’elle a été espionnée ou parce que ce qu’elle voit réveille en elle des sentiments secrets ? Dans Tesis, ce que révèle l’image est davantage l’inavouable que l’immontrable, ce dernier étant hors cadre, coincé dans le hors-champ, parce que d’une vérité crue qu’il est inutile de « montrer ». D’où le choc de la scène finale, révélant par le montage l’hypocrisie de la télévision et la fascination immobile de son public. A peine le signal envoyé (« Voici ces images »), Amenabar coupe le film et envoie le générique de fin. Notre voyeurisme n’est pas puni, mais simplement bloqué dans une zone qui lui échappe. Ne plus confondre la thèse et l’antithèse, mais rester fidèle à la thèse elle-même. Et, au final, récolter la plus élevée des mentions.
Test Blu-Ray
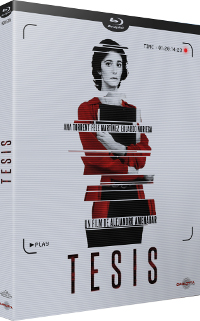 La précédente édition DVD du premier film d’Alejandro Amenabar, supervisée par StudioCanal, n’avait pas donné de réelle satisfaction, surtout en raison d’une qualité d’image plus que discutable (le grain de l’image gâchait bon nombre de scènes). En prenant le relais pour le passage en Blu-Ray, l’éditeur Carlotta bichonne Tesis à plus d’un titre, dévoilant une qualité d’image et de son tout bonnement idyllique, digne d’un ravalement de façade radical. On sera étonné de ne trouver aucune version française, mais comme un tel film ne se savoure qu’en version originale, on ne s’en plaindra pas. Du côté des bonus, une petite déception s’impose : si la galette numérique récupère la plupart des bonus de la précédente édition (quatre scènes coupées et un très bon making-of d’époque), pourquoi avoir fait disparaître l’excellent commentaire audio du réalisateur ? Pour compenser cette absence, Carlotta propose deux nouveaux suppléments : une rapide introduction d’Amenabar, et surtout une passionnante interview de 40 minutes où le réalisateur revient sur sa passion pour le cinéma, l’écriture du scénario, le tournage du film et son regard mélancolique sur le résultat final. Assez brillant pour rendre cette édition Blu-Ray indispensable, d’autant que jamais Tesis n’aura été aussi beau à voir sur un écran de télévision.
La précédente édition DVD du premier film d’Alejandro Amenabar, supervisée par StudioCanal, n’avait pas donné de réelle satisfaction, surtout en raison d’une qualité d’image plus que discutable (le grain de l’image gâchait bon nombre de scènes). En prenant le relais pour le passage en Blu-Ray, l’éditeur Carlotta bichonne Tesis à plus d’un titre, dévoilant une qualité d’image et de son tout bonnement idyllique, digne d’un ravalement de façade radical. On sera étonné de ne trouver aucune version française, mais comme un tel film ne se savoure qu’en version originale, on ne s’en plaindra pas. Du côté des bonus, une petite déception s’impose : si la galette numérique récupère la plupart des bonus de la précédente édition (quatre scènes coupées et un très bon making-of d’époque), pourquoi avoir fait disparaître l’excellent commentaire audio du réalisateur ? Pour compenser cette absence, Carlotta propose deux nouveaux suppléments : une rapide introduction d’Amenabar, et surtout une passionnante interview de 40 minutes où le réalisateur revient sur sa passion pour le cinéma, l’écriture du scénario, le tournage du film et son regard mélancolique sur le résultat final. Assez brillant pour rendre cette édition Blu-Ray indispensable, d’autant que jamais Tesis n’aura été aussi beau à voir sur un écran de télévision.
