
Un chômeur qui se réveille un matin à 7h60 (!) pour s’apercevoir que son chien a disparu, son voisin joggeur qui soutient fermement qu’il n’a jamais pratiqué de jogging, une livreuse de pizza qui veut à tout prix construire un foyer avec quelqu’un (peu importe s’il change de visage), un jardinier pseudo-artiste qui décède d’un arrêt cardiaque pour ressusciter juste après, un flic qui interrompt les gens juste pour leur faire perdre leur temps, un détective animalier qui enquête en fouillant l’inconscient d’un excrément de chien, des employés de bureau qui bossent dans une pièce sous un déluge de pluie, et surtout, un gourou tellement fan des animaux domestiques qu’il les kidnappe pour mieux apprécier le visage de leurs propriétaires lorsqu’ils les retrouvent… A priori, Wrong porte très bien son titre. Sauf qu’en voyant Quentin Dupieux à la réalisation, le point d’interrogation devient un point d’exclamation, et on est tout de suite un peu rassuré. Quoique… Après avoir fortement développé son style et ses ambitions artistiques dans Steak et Rubber, Dupieux pouvait dès lors prendre son envol au risque de devenir un peu conventionnel, mais c’est finalement tout l’inverse : en effet, le paradoxe suprême de Wrong est d’avoir poussé encore plus loin les frontières de l’absurde, sans pour autant hausser d’un cran dans la mise en scène de l’insondable. Comprenons par là que, si le film multiplie les idées loufoques jusqu’à plus soif, la méthode Dupieux montre cette fois-ci ses limites en évacuant le non-sens au profit d’une banlieue quasi-lynchienne dans laquelle se produit une suite de dérèglements bizarroïdes. L’erreur aura peut-être été de lorgner un peu trop vers la sensibilité du cinéaste de Lost highway, en reprenant la plupart de ses idées visuelles (dont la séquence repassée à l’envers) et en bâtissant le tableau d’une Amérique décalée. Chaque plan, bien que parfaitement cadré et élaboré, semble aller dans ce sens, et on se surprendrait presque à ne pas y retrouver les autochtones de Twin Peaks au détour d’une rue. Pour autant, le film reste une leçon de mise en scène bluffante (Dupieux a encore progressé de ce côté-là) et son plan final, où l’on suit une voiture qui roule sans raison et sans fin à travers un vaste désert, peut se lire comme l’analogie avec le parcours personnel de Quentin Dupieux : ce type ne sait pas forcément où il va, mais il y va, désireux de quitter les frontières du réel, fonçant tout droit dès qu’une idée loufoque lui traverse l’esprit, et se laissant porter sans savoir de quoi l’horizon sera fait. Une démarche punk que trop peu de cinéastes osent adopter aujourd’hui.
– Guillaume Gas –
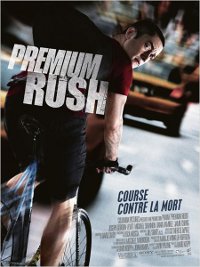
Après avoir servi la soupe à Ricky Gervais dans le transparent La Ville Fantôme, il est assez heureux de retrouver le David Koepp réalisateur sur un projet comme Premium Rush. En fait, il est heureux de retrouver David Koepp tout court. Si sa précédente réalisation était fort peu mémorable, son travail premier de scénariste n’a pas non plus connu de grands moments. Avec Anges Et Démons et Indiana Jones Et Le Royaume Du Crâne De Cristal, le bonhomme était loin de signer ses meilleurs travaux. Certes, tous les défauts de ceux-ci ne lui incombent pas forcément (le premier part d’un roman exécrable, le second est sous le commandement d’un producteur à l’ouest) mais on regrette le temps où il était aux fourneaux de projets comme Jurassic Park et Spiderman. Premium Rush n’a pas la prétention de s’affilier à de telles œuvres mais offrait la parfaite opportunité d’une remise en jambes par la simplicité de son concept. Un coursier (le brillant Joseph Gordon-Levitt) transporte une enveloppe convoitée par un flic ripou (Michael Shannon toujours à deux doigts de péter une durite). Voilà tout est là. Il n’y a pas de grand propos à tenir ou de grande dramaturgie à développer. Il y a juste un pitch minimaliste par lequel Koepp doit maintenir l’attention de son spectateur sur quatre-vingts dix minutes. La surprise (pas forcément la plus agréable) est de voir que le réalisateur/scénariste rejette la linéarité de la course poursuite au profit d’un récit à la chronologie éclatée. Au lieu de l’attachement entier au personnage principal, Koepp joue sur des retours en arrière et des changements de points de vue. L’expérience s’en retrouve quelque peu amoindrie puisqu’ôtant le sentiment d’implication auprès du personnage. Mais étrangement cela n’est pas forcément trop dommageable à la qualité divertissante de l’objet. Par ce gimmick, l’intrigue devrait normalement connaître des décélérations et relâcher la pression. Or, Koepp reste fidèle aux préceptes de son héros pour qui « les freins c’est la mort ». Malgré l’éparpillement certain de la méthode, Koepp arrive à maintenir le rythme et donc l’intérêt. Plus qu’une dynamique narrative finalement bien utilisée, c’est sa mise en scène qui en est le principal acteur. Le découpage est percutant, délivre ses informations avec efficacité et favorise constamment le mouvement. Evidemment, les scènes de poursuite sont les plus brillantes en ce sens. Prompt à dépeindre un New York sous forme de jungle urbaine où la moindre erreur est fatale, Koepp fait preuve d’un esprit alerte pour trouver les meilleures prises de vue immersives. Sans avoir le génie de ses maîtres, il reste un élève appliqué à l’affut de la moindre idée pour rendre l’entreprise plus attrayante. Ainsi transforme-t-il le traditionnel carton casse-couilles « faites pas ça chez vous » par un plan pris d’un téléphone portable où Gordon-Levitt exhibe le résultat d’une cascade ratée. Par ce genre de petites touches, Koepp assure un certain degré de sympathie à son film. Reste plus maintenant à ce qu’il arrive à se remettre sur des entreprises un brin plus ambitieuses.
– Matthieu Ruard –
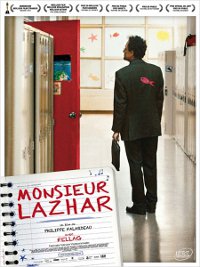
Après l’attachant Starbuck en juin, c’est au tour de Monsieur Lazhar de nous arriver du Québec avec comme principale réputation d’y avoir lui aussi cartonné l’an dernier. Autant dire que ce film de Philippe Falardeau est une preuve de plus que non, un succès public à l’étranger n’est pas la garantie d’une œuvre de qualité. On voit à peu près ce qui a pu susciter tant d’engouement : le Québec est depuis des années en proie à des débats sur les « accommodements raisonnables » mis en avant par les institutions canadiennes. Cette notion juridique consiste à assouplir une norme afin qu’elle aille le moins possible à l’encontre des convictions religieuses de tel ou tel individu ou groupe. Une tendance à fuir les différences dont le film souhaite prendre le contre-pied en prônant l’approche décomplexée de l’Autre. Cet Autre, c’est ici Bachir Lazhar, réfugié algérien, qu’ont comme remplaçant les élèves d’une classe de primaire dont l’institutrice s’est pendue, un soir, dans la salle de cours. Il suffit de dire que Monsieur Lazhar a, lui aussi, un deuil à gérer de son côté pour entrevoir déjà le déroulement bien balisé du film et comment celui-ci esquive une question en en posant une autre. Le thème de l’intégration de l’immigré sera bien vite réglé : en parallèle d’une procédure de demande d’asile sur laquelle le film aurait pu passer moins de temps, les scènes à l’école ne sont prétextes qu’à des bribes de questionnement. Et encore, avec des enfants sur-dirigés pour jouer des figures-types (la petite péteuse aux parents conservateurs, le torturé, la délaissée), autant dire qu’on est à des lieues de l’entrechoquement des cultures et des égos que parvenait à saisir Entre les Murs (2008). Là où le film parvient malgré tout à se faire un peu touchant, notamment grâce à l’interprétation très honnête de Mohamed Fellaq, c’est dans son évocation d’un travail de deuil qu’il est bien difficile d’imposer de manière universelle à tout un chacun. Les frontières se déplacent discrètement : de celles culturelles à celles qui séparent les superficiels des profonds, les fuyants des courageux.
– Gustave Shaïmi –
